Entre foi et communication
Après l’échec historique du Parti québécois et
tout le bavardage médiatique sur l’affaiblissement du mouvement souverainiste,
la première erreur serait de renoncer au projet d’indépendance, ou de le mettre
en veilleuse quelques années pour s’adapter aux humeurs changeantes d’un peuple
qui ne croit plus en son avenir politique. Il ne s’agit pas ici de nier le fait
que l’appui populaire à l’idée de souveraineté nationale est largement
insuffisant, et qu’il faudrait simplement redoubler de ferveur souverainiste
pour renverser la situation. La ferveur renvoie au zèle, à la dévotion, à un
sentiment religieux intense, et l’une des raisons de l’essoufflement du projet
souverainiste réside probablement dans le fait qu’il repose largement sur une
foi sans contenu, déclinant progressivement avec le vieillissement des fidèles.
Si toute idéologie politique ressemble jusqu’à un certain degré à une religion,
l’Église souverainiste est devenue moribonde et doit faire appel à la jeunesse
pour espérer de reprendre vie.
Or, ce renouvellement ne peut se limiter au
recrutement de jeunes militant.e.s volontaristes qui souhaitent réanimer comme
tel le rêve des fondateurs, reprenant sans remettre en question le discours de
Lévesque, Parizeau et compagnie. Ce n’est pas tant les porteurs du discours
souverainiste qui vieillissent, mais le discours lui-même. Et le discours n’est
pas d’abord une affaire de rhétorique, une technique de communication qui sert
à montrer par des arguments économiques et des petits clips médiatiques le
caractère « cool » de l’indépendance. La meilleure agence de
communication et de marketing n’arrivera pas à « vendre » une idée
politique au-delà d’un public cible ; c’est probablement une raison qui
explique la grande popularité d’Option nationale auprès d’une certaine branche
de la jeunesse, et l’indifférence générale auprès de ceux et celles qui ne sont
pas « intuitivement » attachés à l’indépendance. Ce parti a fait un excellent travail de vulgarisation qu'il faut souligner, mais il faut replacer la pédagogie indépendantiste dans une perspective politique plus large. L’efficacité d’une
image est souvent proportionnelle au caractère ciblé d’un groupe donné, et
c’est pourquoi la stratégie communicationnelle doit toujours être subordonnée à
une vision globale de société, à un projet politique capable d’intégrer les
multiples enjeux et contradictions qui traversent la communauté nationale. Le
projet d’indépendance ne doit pas être mieux véhiculé, mais ré-inventé. Comme
le rappelle Deleuze, « nous ne manquons pas de communication, au contraire nous en
avons trop, nous manquons de création, nous manquons de résistance au
présent. »
L’indépendance
populaire
La principale innovation stratégique du projet
indépendantiste des dernières années n’est pas issue du mouvement souverainiste
classique, mais de la gauche politique. Elle consiste à faire reposer la souveraineté
nationale sur le principe de souveraineté populaire, notion complexe située au
carrefour de la société civile, de la démocratie participative et du droit
d’auto-détermination des peuples. En gros, il s’agit de faire reposer la
stratégie d’accession à l’indépendance sur une démarche constituante, une
assemblée citoyenne qui serait chargée de rédiger la constitution du Québec.
L’initiative ne vient donc plus d’une élite parlementaire qui s’engage à négocier
la souveraineté du Québec avec l’État canadien à la suite d’une victoire du Oui
lors de la consultation référendaire, mais d’un processus indépendant de
l’Assemblée nationale qui serait chargé d’élaborer, par la participation et la
délibération populaire, l’architecture institutionnelle du Québec :
valeurs, droits, principes, institutions, distribution des pouvoirs, etc. La constitution
devra ensuite être ratifiée par la population lors d’un référendum, la totalité
des citoyens et citoyennes du Québec pouvant dès lors adopter ou rejeter le
projet proposé.
Toute la difficulté réside dans l’articulation
de la question du statut politique du Québec à l’intérieur du processus
constituant. Normalement, un référendum sur l’indépendance nationale devrait
précéder la rédaction d’une constitution afin d’éviter de brouiller les cartes.
Or, la stratégie de l’assemblée constituante consiste précisément à rejeter la
perspective référendaire classique en permettant au peuple québécois de rédiger
un projet de pays qu’il aura lui-même construit, afin de lui donner une vision
positive et déterminée d’une nouvelle société qui pourra le motiver à faire le
saut nécessaire et assumer ce grand changement politique. Il s’agit en quelque
sorte d’asseoir l’indépendance sur l’empowerment
du peuple québécois, c’est-à-dire l’auto-organisation citoyenne qui pourra
prendre elle-même en charge son avenir politique, l’État venant seulement
appuyer financièrement et soutenir légalement une initiative issue de la base.
Cette stratégie d’indépendance populaire représente un renversement conceptuel
par rapport à l’approche élitiste, qui consistait à donner un chèque en blanc à
la classe politique pour qu’elle fasse la souveraineté à la place du peuple.
Le dilemme de l’assemblée constituante
Si nous acceptons que l’épineuse question du
statut politique du Québec devra être résolue à l’intérieur d’un processus
constituant afin que le projet d’indépendance repose sur une démarche
pleinement efficace, légitime, inclusive et démocratique, alors nous devons répondre
à la question suivante : le mandat de l’assemblée constituante sera-t-il
de rédiger la constitution d’un Québec indépendant ? Si nous affirmons, à
la manière de Québec solidaire et différents acteurs du mouvement
souverainiste, qu’il s’agit avant tout de rédiger une constitution et que ce
sera à l’assemblée citoyenne de décider si elle doit inclure ou non
l’indépendance du Québec dans son projet, alors nous ouvrons la possibilité que
le peuple québécois ne pourra pas exercer son droit d’auto-détermination lors
du référendum qui conclura le processus. Si nous affirmons au contraire que
l’assemblée constituante devra rédiger la constitution d’un Québec indépendant,
alors celle-ci s’expose au risque qu’elle ne pourra pas rallier les personnes
qui n’étaient pas convaincues au départ, limitant ainsi son caractère inclusif.
Nous soutiendrons ici que la première option est inconsistante du point de vue
démocratique, et qu’elle présente d’importantes lacunes en termes d’efficacité
avant et pendant le processus constituant. Nous argumenterons ensuite en faveur
de la deuxième option, en réfutant l’objection selon laquelle la précision du
mandat de l’assemblée constituante limiterait son potentiel démocratique et
mobilisateur.
Tout d’abord, le mandat « ouvert » de
l’assemblée constituante traite la question du statut politique du Québec
(indépendance ou provincialisme) comme une question parmi d’autres qui se
retrouvera dans une liste de propositions lors du référendum. Le parti qui sera
alors au pouvoir à l’assemblée nationale, Québec solidaire par exemple,
pourrait faire valoir sa perspective indépendantiste comme une option parmi
d’autres aux côtés de ses valeurs progressistes afin de préserver l’autonomie
de l’assemblée constituante. « Celle-ci aura pour mandat d’élaborer une ou des
propositions sur le statut politique du Québec, sur les valeurs, les droits et
les principes sur lesquels doit reposer la vie commune, ainsi que la définition
de ses institutions, les pouvoirs, les responsabilités et les ressources qui
leur sont délégués. […] Les propositions issues de l’Assemblée constituante, y
compris celle sur le statut politique du Québec, seront soumises au choix de la
population par référendum, ce qui marquera la fin du processus. Tout au long de
la démarche d’Assemblée constituante, Québec solidaire défendra son option sur
la question nationale québécoise et fera la promotion de ses valeurs
écologistes, égalitaires, féministes, démocratiques, pluralistes et pacifistes,
sans toutefois présumer de l’issue des
débats. »
Bien que cette position semble manifester
une grande ouverture à la pluralité des positions et donc une certaine
neutralité quant aux divergences de perspective sur la question nationale,
celle-ci cache le fait que le but implicite de la démarche n’est pas de rédiger
une constitution pour le simple plaisir de la délibération, mais de faire
l’indépendance. Évidemment, la stratégie consiste à ouvrir la démarche au plus
grand nombre de personnes et de convaincre ensuite une majorité en cours de
route. On fait alors le pari que le débat démocratique pourra créer un
« consensus » sur la question nationale, celui-ci n’étant pas réglé
d’avance mais le résultat spontané d’une réflexion collective. On croit alors
que l’indépendance émergera d’elle-même en ne donnant aucune orientation
initiale au processus, afin de ne pas faire peur à ceux et celles qui ne sont
pas d’emblée convaincus par la pertinence de la souveraineté mais changeront
probablement d’idées en participant.
L’analogie de la grève générale
Or, cette perspective spontanéiste repose
sur une prémisse fausse qui stipule que l’objet du débat étant prédéterminé,
les personnes hésitantes ou opposées au projet ne participeront pas à la
délibération. Au contraire, le fait de préciser clairement un enjeu controversé
d’intérêt général dans le but de convaincre une assemblée permet d’éclaircir
l’objectif de la démarche, de mobiliser les membres à participer, et d’assurer
la transparence du processus délibératif. Prenons l’exemple d’une association
étudiante dans laquelle le comité exécutif décide de convoquer une assemblée
dans le but de déclencher une grève générale. Celle-ci a deux options : a)
convoquer une assemblée générale avec plusieurs points à l’ordre du jour, dont
l’un traite de la question « grève » afin de ne pas faire peur
aux membres réticents ; b) convoquer une assemblée générale extraordinaire
dont le point principal est « grève générale illimitée », dans
laquelle les membres pourront discuter des modalités de cette grève, ses raisons,
ses revendications et ses objectifs, et voter en faveur ou en défaveur de son
déclenchement.
Dans la première option, le comité exécutif
espère que le point grève sera traité comme une question parmi d’autres,
l’assemblée ne devant pas être monopolisée par ce débat controversé. Néanmoins,
cet enjeu fera irruption et prendra la plus grande place dans la discussion,
laissant peu d’espace pour les autres points qui seront alors traités comme des
questions secondaires. Certaines personnes pourraient également souligner les
intentions cachées du comité exécutif qui, sous couvert de neutralité, voulait
en fait déclencher une grève sans soulever de tollé. Dans la deuxième option,
le comité exécutif assume l’objectif de la démarche en convoquant l’assemblée à
cette fin, en confiant aux membres la tâche de délibérer de la nature du
projet, des grandes lignes et même des détails, tout en leur laissant la
liberté d’adopter ou de rejeter le projet lors de la décision finale. Certaines
personnes pourraient certes reprocher au comité exécutif de vouloir orienter le
processus, mais celui-ci serait clair sur ses intentions tout en laissant la
possibilité à l’assemblée de s’emparer pleinement de cette question. Les
membres farouchement convaincus ou opposés à la grève se mobiliseraient pour
faire valoir leur point de vue, de même que les personnes indécises qui
voudraient entendre les différents arguments et avoir leur mot à dire. Enfin,
les membres pourraient établir collectivement les raisons, principes et
modalités qui encadreront cet événement perturbateur pour l’association
étudiante, afin d’expliciter clairement les pour et les contre d’une telle
décision.
Souverainisme complexé et
double constitution
Cette expérience de pensée permet
d’illustrer à plus petite échelle deux perspectives divergentes sur une question
litigieuse qui touche l’ensemble de la communauté politique. La première
approche traite la question nationale de manière complexée, car elle affirme
son soutien à l’indépendance sur le plan théorique tout en laissant la
stratégie d’accession à l’indépendance indéterminée sur le plan pratique. Le
souverainisme complexé, pour se démarquer politiquement des autres approches
souverainistes, met de l’avant un processus constituant ouvert et inclusif,
mais qui a tendance à occulter l’objectif de la démarche. L’accent est mis sur
la souveraineté populaire au moment de la délibération, et non sur la
souveraineté nationale qui est pourtant nécessaire à l’exercice de la
souveraineté populaire après le référendum. Autrement dit, la souveraineté
populaire est fondamentale durant le processus, tandis que la souveraineté
nationale est optionnelle.
La souveraineté populaire est alors traitée
comme un moyen, un outil stratégique, et non comme une fin, une forme de
société. Autrement dit, l’assemblée constituante n’est plus l’instrument de la
souveraineté populaire, c’est la souveraineté populaire qui devient
l’instrument de l’assemblée constituante. Tout se passe comme si l’obsession de
la souveraineté nationale au sein du mouvement indépendantiste avait provoqué
la réaction opposée chez la gauche, qui revendique alors le primat de la
souveraineté populaire (à juste titre) sans l’articuler pour autant au cadre
national-étatique qui la rendra effective. Comment un peuple peut-il se
gouverner lui-même sans des institutions politiques qu’il peut créer, modifier
et destituer à sa guise ? Comment peut-il être souverain à l’intérieur
d’institutions d’origine coloniale et banalisées par la routine parlementaire,
qui sont elles-mêmes assujetties à une constitution qui n’a jamais fait l’objet
d’une ratification populaire ? Même une constitution provinciale élaborée
démocratiquement par le peuple québécois serait limitée a priori par le cadre constitutionnel canadien, officialisant ainsi
l’autonomie relative accordée de facto
à l’État québécois depuis 250 ans.
Le souverainisme complexé se retrouve
également dans la stratégie de la « double constitution », qui vise à
trouver un terrain d’entente entre les camps souverainistes et fédéralistes
pour un combat équitable et éclairé qui laisserait place à deux projets lors du
référendum. Le projet de pays serait mis côte à côte d’un projet provincial qui
laisserait miroiter la possibilité d’un « fédéralisme renouvelé ». Or,
à quoi peut bien servir la rédaction d’une constitution qui ne serait pas celle
d’un Québec indépendant ? Nous pouvons certes donner l’exemple de la
constitution de la Colombie-Britannique, qui réunit dans un même texte
l’ensemble des règles de droit qui organisent les institutions de la province.
Mais il y a tout de même des constitutions implicites dans l’ensemble des
provinces, dans la mesure où celles-ci sont organisées par un ensemble de
chartes et de lois fondamentales (Charte des droits et libertés de la personne
du Québec, Charte de la langue française, etc.) à valeur
quasi-constitutionnelle.
La principale fonction d’une constitution
provinciale serait d’expliciter le statu quo, de montrer ce que nous ne pouvons pas faire à l’intérieur
du carcan canadien, mais il n’est pas nécessaire de présenter cette possibilité
comme une « alternative politique » devant obligatoirement faire
partie du processus constituant. Une constitution provinciale provisoire
pourrait même être adoptée par un gouvernement solidaire au début de son
mandat, à titre de manœuvre pédagogique pour montrer les limites juridiques,
politiques et économiques d’une telle approche. Le fait de rassembler les
chartes et textes de lois existants, en ajoutant l’égalité homme-femmes et la
laïcité n’aurait rien de problématique sur le plan démocratique. Autrement dit,
il ne s’agit pas de présenter la constitution provinciale comme une option
réelle, mais de la réaliser pour montrer ce qu’elle est en fait, soit un
cul-de-sac politique, un changement cosmétique.
Vers une grève nationale
illimitée
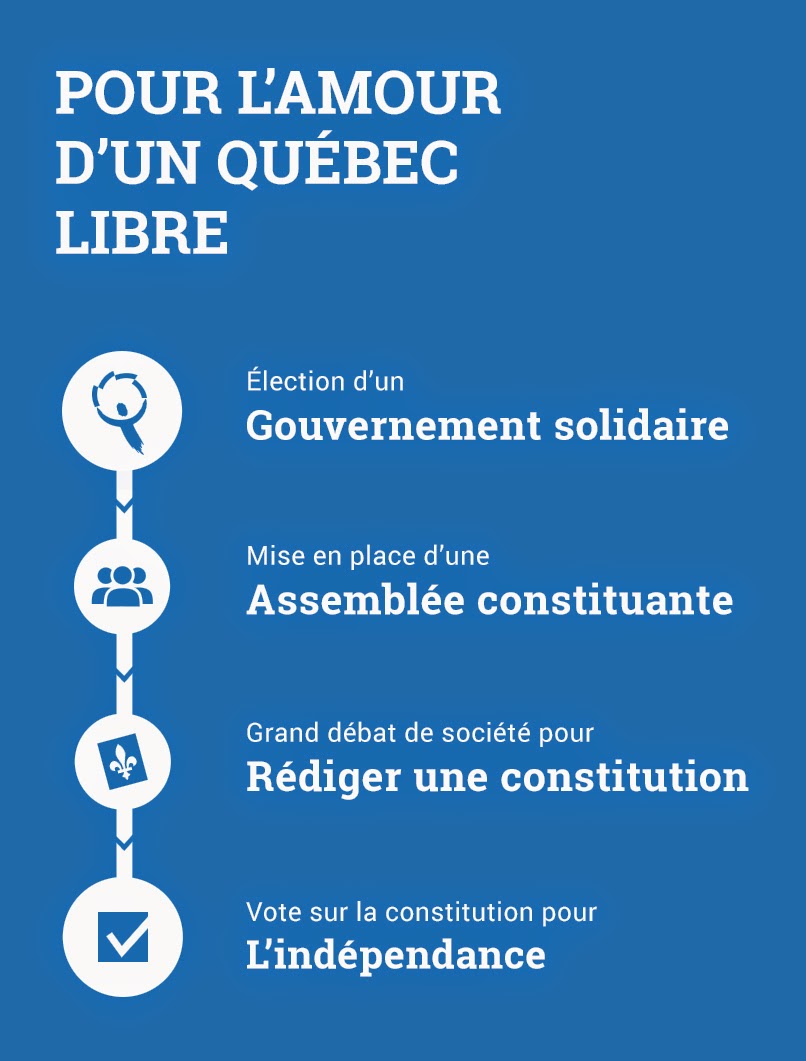 Le principal avantage de la stratégie de la
double constitution, qui consiste à comparer systématiquement une constitution
provinciale rachitique et une constitution républicaine musclée, peut donc être
reprise de la manière suivante : 1) adoption d’une constitution
provinciale par l’Assemblée nationale ; 2) déclenchement d’une assemblée
constituante devant rédiger la constitution d’un Québec indépendant. Les
fédéralistes pourront certes se plaindre que le processus constituant est déjà
« pipé d’avance » en faveur du projet de pays, mais leur option de
réforme constitutionnelle intra-canadienne aura déjà été réalisée à l’Assemblée
nationale. Ils ne pourront pas accuser l’assemblée constituante de vouloir
« tromper le peuple » sous prétexte de neutralité, car sa fonction,
le but explicite de cette démarche sera d’élaborer démocratiquement un projet
de pays pour convaincre une majorité populaire de sa désirabilité et sa
nécessité. Il n’y a nul trucage ici : le gouvernement solidaire agirait à
titre de comité exécutif convoquant une grève nationale illimitée, qui sera
débattue non pas dans l’enceinte étroite du parlementarisme, mais directement
dans la société civile, la rue et les assemblées citoyennes.
Le principal avantage de la stratégie de la
double constitution, qui consiste à comparer systématiquement une constitution
provinciale rachitique et une constitution républicaine musclée, peut donc être
reprise de la manière suivante : 1) adoption d’une constitution
provinciale par l’Assemblée nationale ; 2) déclenchement d’une assemblée
constituante devant rédiger la constitution d’un Québec indépendant. Les
fédéralistes pourront certes se plaindre que le processus constituant est déjà
« pipé d’avance » en faveur du projet de pays, mais leur option de
réforme constitutionnelle intra-canadienne aura déjà été réalisée à l’Assemblée
nationale. Ils ne pourront pas accuser l’assemblée constituante de vouloir
« tromper le peuple » sous prétexte de neutralité, car sa fonction,
le but explicite de cette démarche sera d’élaborer démocratiquement un projet
de pays pour convaincre une majorité populaire de sa désirabilité et sa
nécessité. Il n’y a nul trucage ici : le gouvernement solidaire agirait à
titre de comité exécutif convoquant une grève nationale illimitée, qui sera
débattue non pas dans l’enceinte étroite du parlementarisme, mais directement
dans la société civile, la rue et les assemblées citoyennes.
Le processus constituant serait alors
dirigé par un « gouvernement parallèle » populaire, élu ou tiré au
sort idéalement, qui aurait pour fonction de créer le pays qui appelle à
naître. Nulle ambiguïté, pure simplicité, l’assemblée constituante aura pour
fonction de recueillir les témoignages et les propositions citoyennes pour
former les contours d’une nouvelle société. Telle est la tâche d’un
gouvernement révolutionnaire, c’est-à-dire d’un parti qui se veut l’outil
effectif de la souveraineté populaire, qui laissera pleinement au peuple la
capacité de forger librement les institutions qui lui tiennent à cœur. Celui-ci
doit rompre avec le carcan juridique suprême, la loi canadienne qui empêche
l’expression de la pleine souveraineté populaire, par la mise en place d’un
processus qui invite à renverser l’ordre politique actuel. L’indépendance, même
si elle se fait pacifiquement, démocratiquement et demeure
« tranquille », n’en demeure pas moins une révolution au sens strict.
« L’élection
d’une Assemblée constituante est donc un acte démocratique par excellence, un
acte à la fois de rupture avec le statu quo du régime fédéral canadien et un
acte réellement fondateur. En ce sens, c’est une suspension des mécanismes de
la réforme constitutionnelle prévue par l’Acte de l’Amérique du Nord
britannique. »[1]
Cette deuxième approche, que nous pouvons
qualifié de « gauche indépendantiste », est décomplexée dans la
mesure où elle n’a pas peur d’affirmer que l’indépendance n’est pas une option,
mais une nécessité vitale pour la réalisation d’une souveraineté populaire qui
ne reste pas dans le monde des abstractions. Contrairement au souverainisme
complexé qui conçoit d’abord l’indépendance comme un instrument au service d’un
projet de société, l’indépendantisme décomplexé considère l’indépendance comme
un projet de société, comme une libération nationale qui sera elle-même vectrice
de transformation sociale. Nous passons alors d’un « pays de
projets » indéterminés à un « projet de pays » déterminé.
L’emploi de mots vagues comme « projet
de société » est souvent le symptôme d’une incapacité à nommer directement
les choses de peur d’offusquer les gens avec des termes connotés péjorativement
par l’histoire et le discours dominant. Or, nous n’arriverons pas à convaincre
une majorité en évoquant des termes généraux mais inoffensifs et en laissant
nos adversaires définir à notre place les mots qui permettent de définir nos
idées politiques. C’est à nous de donner un nouveau sens, de nouvelles images,
de nouveaux contenus aux idées émancipatrices de nos ancêtres. Si le projet de
société alternatif au capitalisme néolibéral et autoritaire peut être désigné
par l’expression « écosocialisme démocratique », « social-démocratie libertaire » ou « société conviviale », le nom du projet de
pays est « indépendance populaire » ou « République du Québec ». Nous
pouvons employer les expressions « révolution citoyenne »,
« révolution fiscale » ou « révolution verte » pour marquer
la rupture sans employer la rhétorique marxiste, mais il n’en demeure pas moins
que l’horizon est celui d’une transformation radicale du monde dans lequel nous
vivons.









