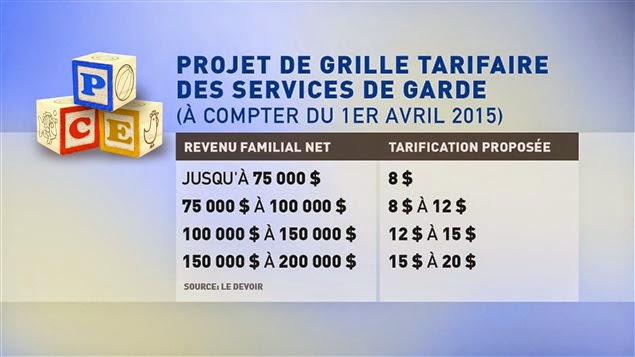Le point aveugle de la gauche
La gauche a le défaut de ses qualités :
critiquant à juste titre la rationalité néolibérale qui détourne les
institutions publiques de leur finalité en favorisant la dissémination des
valeurs de marché sur l’ensemble de la société, l’appauvrissement des classes
moyennes et populaires et la concentration de la richesse dans les mains d’une
minorité, la gauche s'oppose à ce phénomène en préconisant des politiques publiques
interventionnistes et une meilleure redistribution de la richesse collective.
Musclée dans sa critique de l’austérité, car soucieuse de la justice fiscale et
sociale, elle reste beaucoup plus timide et malhabile quand vient le temps
d’aborder la question constitutionnelle et la critique du système politique,
car elle convoite précisément le pouvoir parlementaire pour établir ses
réformes par la voie de la légalité démocratique. Autrement dit, sa
perspicacité dans le domaine socioéconomique s’accompagne d’une myopie dans la
compréhension de la nature et des limites du régime politique.
Le régime politique désigne la manière dont le
pouvoir est organisé et exercé dans une communauté politique, c’est-à-dire la
forme institutionnelle d’un État et les pratiques qui découlent de celle-ci. Quel
est le fondement de l’autorité des gouvernants, quels sont les droits et les
devoirs des citoyens, comment ceux-ci choisissent-ils leurs représentants et
limitent-ils leur pouvoir ? Quelles différences y a-t-il entre un régime
totalitaire, autoritaire, libéral, républicain, socialiste, etc. ? Pourquoi
observe-t-on une désaffection grandissante de la population à l’égard des
institutions et une perte de confiance envers les possibilités de la démocratie
à l’heure où la corruption est toujours plus généralisée ? Comment un
parti de gauche pourrait-il prendre le pouvoir dans un contexte où non
seulement le discours de la gauche, mais l’existence même des partis politiques
sont largement discrédités ? Est-il possible de réformer le système de
l’intérieur et prétendre former un « bon gouvernement » responsable,
tout en essayant de mettre en échec les règles du jeu économique ? Ces
multiples questions relatives au régime politique ne touchent pas seulement le cadre dans lequel l’action politique de
la gauche doit s’inscrire, mais son identité
même, ses référents symboliques, son discours, son sujet collectif, sa
stratégie et sa forme organisationnelle.
Il ne sera jamais possible de convaincre une
majorité populaire de mettre fin aux politiques d’austérité si celle-ci ne
croit pas à la capacité de l’action
politique de changer quoi que ce soit. À l’heure où les élites édictent leur
agenda et n’hésitent pas à recourir à tous les moyens de l’État (propagande,
forces policières) pour réprimer toute dissidence citoyenne moindrement
menaçante, à l’heure où une frange importante de la jeunesse radicalisée par le
printemps québécois oppose toujours plus la démocratie directe et le
gouvernement représentatif en répudiant toute forme d’action électorale, à
l’heure où une bonne partie des classes moyennes et populaires confondent allègrement
la Coalition Avenir Québec et Québec solidaire, parce que la distinction
gauche/droite ne veut pas dire grand-chose dans l’imaginaire québécois, comment
opérer un changement de fond qui pourrait changer les institutions pour de
bon ?
La gauche n’a pas seulement à accompagner les
mouvements sociaux dans la rue et attendre que les contestations citoyennes se
transforment magiquement dans les urnes, car il n’y a pas de lien mécanique
entre le mécontentement et l’adhésion à un projet de société. De plus, celui-ci
ne peut être résumé dans une plateforme électorale, se comprendre par la
lecture attentive d’un programme politique, ni consister en l’addition de
thématiques particulières (dix paliers d’impositions, investissement dans les
transports publics, réforme du mode de scrutin, etc.). Ce qu’il faut, ce n’est
plus un programme, mais un nouveau récit, une reconflictuation de la situation
politique qui puisse dégager dans la conscience populaire les grands
antagonismes qui travaillent la société. Il faut un discours radicalement
novateur qui va au-delà des revendications particulières de la société civile
et dégage un ennemi commun. Ce qui fait peur au pouvoir économique et au régime
politique, ce n’est pas le débat gauche/droite ; c’est la souveraineté
populaire, l’organisation de ceux d’en bas contre ceux d’en haut, le pouvoir
des gens contre les nantis, du peuple qui veut être libre contre les grands qui
veulent dominer.
Qu’est-ce que la caste politique ?
La gauche ne pourra jamais triompher et espérer
devenir la porte-parole du peuple si elle cherche à se tailler une place dans
la classe politique. Son rôle n’est pas de représenter
les exclus, les citoyens et la classe moyenne, mais de permettre aux gens de
s’organiser eux-mêmes, et de se présenter eux-mêmes dans les institutions
politiques qu’ils sont appelés à transformer pour exercer leur pouvoir directement.
Pour l’instant, la nature du régime politique est farouchement hostile à tout
pouvoir citoyen, à toute capacité du peuple à prendre part aux grandes
décisions qui touchent la vie collective. Le peuple est exclu des institutions
qui lui font face et exercent leur domination de l’extérieur, parce qu’il sent
qu’il ne les a pas créées et se trouve par le fait même dépossédé de son
pouvoir d’agir. Il n’est pas étonnant qu’une majorité soit indifférente au
saccage des services publics, des institutions communes et des programmes
sociaux dont elle se sent aliénée et étrangère. La réponse ici n’est pas de
faire comme l’élite qui s’accommode très bien du démantèlement du modèle
québécois, contre lequel elle a réussi à développer une haine dans l’imaginaire
collectif, et qu’elle s’attache maintenant à détruire par coups de compressions
budgétaires et de réformes. Au contraire, il s’agit de s’opposer directement à
cette classe politique, à cette caste qui gouverne sans scrupules au profit des
intérêts étrangers. Que faire ?
Tout d’abord, il faut favoriser l’auto-organisation
populaire et générer un large mouvement qui déborde le cadre de
l’action politique traditionnelle. Québec solidaire demeure un parti qui
rassemble les forces de gauche et un certain pourcentage des électeurs progressistes
qui se sentent interpellés par son projet. Il n’est pas à l’heure actuelle un véritable
mouvement, et il ne pourra pas transformer une majorité sociale en majorité
électorale s’il ne change pas la ligne de son discours politique. Le Québec ne
deviendra pas « de gauche » du jour au lendemain, et il s’avère au
mieux naïf, au pire dangereux de miser sur de supposées « valeurs
progressistes » du peuple québécois, qui attendraient simplement d’être
célébrées ou retrouvées pour changer l’ordre des choses. La question demeure
surtout que le peuple n’a pas la capacité de se prononcer lui-même sur les
valeurs qui l’animent, sur sa vision du système politique, sur le genre de
société dans lequel il souhaite habiter. Tous les partis cherchent à lui faire
dire ce qu’il pense vraiment, à lui mettre des slogans et des idées creuses
dans la bouche durant la campagne électorale, alors que le gouvernement se fout
éperdument de ce qu’il pense le reste du temps. Le peuple est méprisé non
seulement par les élites financières et industrielles qui détruisent l’économie
réelle et le territoire québécois, mais par la classe politique au grand
complet qui ne le représente pas et lui ment à longueur d’année à travers des
médias qui sont devenus des courroies de transmission des mots d’ordre du
système (ce que nous nommons par euphémisme les relations publiques).

La seule façon de développer une majorité
populaire dans un contexte d’austérité est de miser sur un discours
anti-système, qui oppose le peuple à l’establishment,
les gens aux politiciens bouffons et aux nantis, qui discutent à portes closes
dans le club 357c[1],
club privé des politiciens, élus municipaux, riches et entrepreneurs corrompus
mentionnés dans la Commission Charbonneau. PQ, PLQ, CAQ, Lisée, PKP, Marceau,
Legault, Beauchamp, Charest, Couillard, Desmarais, Fournier, Catania, Tomassi,
toute cette mafia politicienne, cette clique de privilégiés qui se réunissent
secrètement pour discuter des « vraies affaires » en privé, doit être
pourfendue avec la même virulence que Pierre Falardeau dans Le temps des bouffons. Il faut ainsi
dégager clairement cet antagonisme entre le peuple et le 1%, afin d’opposer une
majorité aux partis dominants et éviter l’identification à des figures
messianiques comme PKP sous prétexte qu’il serait « souverainiste ».
PKP est un citoyen québécois, il a sa nationalité et le droit de faire de la
politique, mais il ne fait pas partie du peuple
au sens fort du terme. Il est un membre de la caste, de l’establishment, des élites économiques, politiques et médiatiques,
au même titre que son parti, le PLQ et la CAQ qui aspirent tous à gouverner le
peuple à sa place, à maintenir le régime politique en place afin de préserver
leur pouvoir.
La crise du régime
représentatif
Comment redonner le pouvoir au peuple sur
sa destinée ? Au-delà d’une redistribution de la richesse et de la
création d’emplois dans l’économie verte qui représentent des conditions
importantes de l’égalité sociale et de la transition écologique, il faut
dépasser la critique étroite et obsessionnelle du néolibéralisme (l’idéologie
du capitalisme) et miser sur la critique systématique du régime politique. Comment
celui-ci est-il constitué ? D’un État canadien qui ne reconnaît point la
souveraineté du peuple. Il ne s’agit pas seulement de la nation québécoise,
dont il reconnaît symboliquement l’existence dans le cadre fédéral actuel. Mais il s’agit du peuple canadien,
québécois et des Premières Nations qui n’ont aucun pouvoir réel, car l’autorité
reste la prérogative du Parlement. Nous vivons dans une monarchie
constitutionnelle, soi-disant démocratique, qui ne laisse aucune place pour
l’initiative populaire, la capacité pour le peuple de destituer ses élus en
dehors du moment électoral. Ce problème ne concerne pas seulement l’État
fédéral, mais l’État québécois qui reste prisonnier d’un système parlementaire
hérité du régime britannique. Nos propres institutions sont profondément
coloniales, elles ne sont pas démocratiques, car le gouvernement représentatif
repose précisément sur l’exclusion a
priori de la vraie démocratie, la participation citoyenne dotée de pouvoirs
décisionnels.
Qui plus est, le Canada ne respecte même
plus les principes minimaux du gouvernement représentatif (autre terme pour
désigner l’État de droit ou la démocratie libérale). « Quatre principes
ont toujours été observés dans les régimes représentatifs depuis que cette forme
de gouvernement a été inventée :
1 – les gouvernants sont désignés par élection
à intervalles réguliers.
2 – Les gouvernants conservent, dans leurs
décisions, une certaine indépendance vis-à-vis des volontés des électeurs.
3 – Les gouvernés peuvent exprimer leurs
opinions et leurs volontés politiques sans que celles-ci soient soumises au
contrôle des gouvernants.
4 – Les décisions publiques sont soumises à
l’épreuve de la discussion. »[2]
Le gouvernement canadien, depuis l’ère Harper,
préserve les principes 1 et 2, soit l’élément démocratique (sélection des
représentants au suffrage universel) et aristocratique (l’élection consiste à
choisir les « meilleurs » décideurs qui auront le monopole des décisions
durant l’ensemble de leur mandat, les gouvernés n’ayant aucun pouvoir réel).
Pour ce qui est de 3, disons brièvement que le gouvernement canadien démantèle
le principal média public (Radio-Canada), musèle les scientifiques, criminalise
la contestation et mise sur une propagande massive, réduisant ainsi considérablement
la sphère d’autonomie de la société civile et de l’opinion publique. Pour ce
qui est de 4, il bafoue les règles parlementaires et la culture politique libérale
avec des projets de lois mammouths, ne répond pas aux questions de l’opposition
et fait donc abstraction de toute mise à l’épreuve des décisions de l’exécutif
par la rationalité délibérative.
Malheureusement, l’héritage du gouvernement
Harper ne disparaîtra pas spontanément par l’arrivée au pouvoir des libéraux ou
des néo-démocrates, car il aura laissé de profondes séquelles sur la forme
institutionnelle de l’État canadien. Autrement dit, nous sommes littéralement
passés d’un régime représentatif à un régime
autoritaire qui conserve le principe électif tout en amputant toute forme
de délibération et de contre-pouvoir qui permet habituellement de limiter le
pouvoir du gouvernement. Il ne s’agit pas ici de se limiter à la critique du
conservatisme autoritaire au profit d’un retour grandiose à l’âge d’or du
libéralisme multiculturaliste et des Casques bleus, car le régime représentatif
lui-même évacue la souveraineté populaire et renforce le sentiment d’aliénation
politique qui peut prendre différentes formes.
« En premier
lieu, l’aliénation politique dans le temps résulte de la tension existant entre
élections et décisions. Le mandat que les électeurs accordent au corps
législatif s’étend sur une longue période pendant laquelle seront prises des
décisions dont la nature et le contenu sont tout à fait inconnus au moment du
vote, et sur lesquelles, par conséquent, les électeurs n’auront aucun contrôle
; ce problème est accentué par le « déficit de mémoire collective »
qui résulte de l’action des médias et des stratégies de communication. En
deuxième lieu, la dimension sociale du mécanisme d’aliénation est l’effet de ce
qui peut apparaître comme un paradoxe : au fur et à mesure que la
participation politique s’étend à des catégories plus larges et plus
hétérogènes de la population, la classe politique des législateurs
professionnels et des hauts fonctionnaires devient homogène du point de vue de
sa formation et de son origine sociale, créant ainsi un hiatus croissant entre
les citoyens et les politiciens. Enfin, et en relation étroite avec les deux
modalités précédentes de l’aliénation, il se crée également une distance
croissante entre le savoir, les valeurs et l’expérience quotidienne des
citoyens ordinaires d’une part, et l’expertise des politiciens professionnels
d’autre part. Ces divers aspects de l’aliénation politique peuvent engendrer
deux effets aussi probables l’un que l’autre. Soit un comportement opportuniste
et à courte vue des élites politiques qui ne se sentent plus obligées de se
soumettre à des critères de rationalité politique et de responsabilité
suffisamment exigeante. Soit une « déqualification » morale et
politique de l’électorat et la diffusion d’attitudes cyniques à l’égard de la
chose publique et de l’idée du bien public. Il n’est pas difficile de se rendre
compte que ces deux effets, celui qui affecte l’élite et celui qui affecte les
masses, sont susceptibles de se renforcer mutuellement. »[3]
La vérité populiste
Face à cette crise de légitimité de l’État, la
gauche ne peut plus défendre le régime représentatif et militer simplement pour
une réforme du mode de scrutin qui « laisserait en place les piliers de la
maison », c’est-à-dire le monopole de la représentation et de l’élection
comme unique moyen pour le peuple de gouverner. Qu’on le veuille ou non, nous
sommes bien à l’ère des populismes, et il est temps pour la gauche d’arrêter de
considérer ce phénomène comme une pathologie de la démocratie libérale, idée
qui sous-tend une sorte de « normalité » du régime représentatif.
Quel est le dénominateur commun du « populisme », au-delà de
l’étiquette péjorative qu’on utilise aussitôt pour discréditer l’adversaire en
le qualifiant de nationaliste, conservateur, fasciste, etc. ?
« Les configurations
historico-culturelles susceptibles à tort ou à raison de tomber sous
l’étiquette « populiste » possèdent au moins le trait commun d’une
référence au « peuple », un peuple qui, au travers de discours
mobilisateurs, se voyait opposé comme source de légitimité à une multitude de
figures antagonistes potentielles : les élites en place, le
« système », le statu quo institutionnel du régime représentatif, la
classe politique corrompue, la bureaucratie envahissante, la technocratie
toute-puissante, les financiers avides, le pouvoir central, etc. Appel au
peuple, dénonciation des médiations et crise de légitimité politique semblent
bien constituer les trois conditions de possibilité fondamentales de
l’expression même d’une orientation populiste, laquelle peut, ainsi que la
distingué Taguieff, recouvrir six domaines de significations différents, sous
la forme d’un mouvement (comportant une fonction tribunitienne de mobilisation
des classes moyennes et populaires), d’un régime (souvent de nature autoritaire
ou plébiscitaire, à l’exemple du bonapartisme ou du péronisme), d’une idéologie
(qui fonde une tradition politico-culturelle arrimée à la défense d’un peuple
sain et authentique par opposition aux élites), d’une attitude (l’idéalisation
du « populaire » comme porteur d’une mentalité, d’une culture ou
d’une moralité exemplaires), d’une rhétorique (qui fonctionne peu ou prou par
des discours flatteurs à l’égard des masses, selon une logique de canalisation
du ressentiment) ou encore d’un type de légitimation (qui associe souveraineté
populaire et légitimité charismatique, par l’intermédiaire du chef ou du
sauveur). »[4]
Selon Stéphane Vibert, le populisme ne serait
pas une déformation de la démocratie, mais un pôle fondamental et largement
occulté de ce système politique, et dont la manifestation représenterait une
réponse aux excès du constitutionnalisme libéral qui empêche le peuple de
s’exprimer. Il s’agit « de comprendre la nature du populisme en
s’attachant à le définir comme l’un des deux piliers irréductibles d’un système
démocratique bipolaire qui, depuis une trentaine d’années, paraît reposer
excessivement sur son autre pilier, à savoir le constitutionnalisme libéral et
juridique. Si la démocratie, ainsi que l’estime Canovan, prend la figure d’un
Janus qui porte une face de vocation rédemptrice et d’ambition de changer le
monde, et une autre face de conciliation pragmatique et de gestion raisonnée
des conflits, on peut alors poser l’hypothèse que le destin de la pratique
démocratique consiste à osciller constamment entre une autorité totale accordée
au peuple souverain (« populisme ») et une limitation des pouvoirs
par des règles et des procédures légales (« constitutionnalisme »).
En accord avec cette binarité fondamentale, il s’agirait donc de penser la
vérité populiste de la démocratie. Ce populisme inhérent à l’expérience
démocratique ne deviendrait, dans ce cas, problématique et menaçant non pas du
fait de sa seule existence, mais bien en raison d’une exacerbation unilatérale
nuisant à l’équilibre des institutions. »[5]
La réalité grimaçante de l’irritation
populaire vis-à-vis les « accommodements raisonnables » ne doit pas
être interprétée comme un relent de xénophobie d’un peuple attardé, ni par
rapport à l’objet particulier qui fut au cœur des débats houleux dans l’espace
public (les minorités culturelles, l’intégrisme religieux, les étrangers, etc.), mais comme une
réaction collective vis-à-vis une approche abstraite, libérale et juridique de
ces phénomènes, bref, contre un excès de « constitutionnalisme
libéral ». Dans ce contexte populiste, la gauche ne doit pas se placer
dans le camp de la gestion pragmatique des conflits, de l’inclusion, de la
tolérance inter- ou multiculturaliste, non pas parce que le pluralisme serait
mauvais en soi, mais parce qu’elle devient alors associée à l’élite
bien-pensante et vertueuse qui mépriserait le « bon sens populaire ».
Elle est perçue comme faisant partie du cadre institutionnel dominant cherchant
à étouffer le « malaise identitaire » de la majorité et l’expression
d’une « volonté populaire ».
Il ne s’agit pas ici d’affirmer que la
majorité a la vérité infuse et que le populisme a toujours raison, mais qu’il
faut justement canaliser ce ressentiment populaire contre le constitutionnalisme
libéral, le régime représentatif qui consolide les droits individuels au
détriment de la souveraineté populaire, en recadrant le débat afin que l’ennemi
du peuple soit effectivement celui qui brime ses intérêts : caste
politique, système financier et élites de l’industrie pétrolière et minière.
Tant que la gauche n’aura pas réussi à développer un discours
contre-hégémonique, c’est-à-dire à former un bloc historique et populaire formé
par « ceux d’en bas » contre « ceux d’en haut », elle
restera inoffensive, inaudible dans l’espace public et ultra-minoritaire dans
l’arène parlementaire. Le discours populaire ne doit pas seulement s’opposer à
l’austérité et au virage pétrolier, mais intégrer la lutte anti-corruption en
renversant le mot d’ordre « il faut faire un grand ménage ! »
par la question « qui doit faire le ménage, des technocrates ou le peuple
lui-même ? ». « Recourir [au
populisme] est comme lancer une allumette dans une poudrière. Cela fait
exploser la scène entière. »[6]
Principes de la démocratie participative
Au-delà du discours populiste qui remet au
goût du jour la pleine autorité du peuple, il s’agit de présenter les grandes
lignes d’un régime politique alternatif au gouvernement représentatif. Si la
corruption nourrit généralement le sentiment d’impuissance et la volonté de
recourir à des figures fortes pour ramener l’ordre et l’autorité dans la
maison, il faut opposer un approfondissement de la démocratie par lequel le
peuple sera appelé à véritablement diriger la vie collective. Ce modèle est nul
autre que celui de la démocratie
participative, qu’il faut éviter d’associer trop rapidement aux dispositifs
bidon de consultation publique et d’autres institutions pauvres qui ne
possèdent aucune autorité décisionnelle. La participation citoyenne ne doit pas
être conçue comme le complément inoffensif d’un système qui consacre la
toute-puissance des élus, des hauts fonctionnaires et des élites économiques,
mais un régime politique en soi.
La démocratie
participative n’implique pas le rejet de la représentation politique comme
telle, car celle-ci est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement des
institutions publiques à différentes échelles. Mais elle est incompatible avec
le modèle du « gouvernement représentatif » tel que décrit par
Bernard Manin, qui consacre la séparation institutionnelle du pouvoir
décisionnel entre les gouvernants et les gouvernés. Cette perspective remet
donc en question le monopole du « mandat représentatif » comme
principale forme de délégation du pouvoir politique, mais elle ne se réduit pas
pour autant à l’absolutisation du « mandat impératif » à tous les
niveaux. La démocratie participative désigne un régime politique hybride, qui articule la représentation
avec des procédures de démocratie directe et semi-directe.
« Cette
perspective conceptualise ainsi l’émergence embryonnaire d’un quatrième
pouvoir, celui des citoyens lorsqu’ils participent à la prise de décision,
directement (en assemblée générale ou à travers des référendums), à travers des
petits groupes tirés au sort (jurys berlinois), ou à travers des délégués
étroitement contrôlés (budgets participatifs, structures de développement
communautaire) – plutôt que de s’en remettre à des représentants classiques. Ce
quatrième pouvoir viendrait s’articuler aux trois pouvoirs classiques (le
législatif, l’exécutif et le judiciaire), aboutissant à une forme mixte. Dans
cette optique, l’institutionnalisation de la « participation » est
loin de correspondre à chaque fois à l’émergence d’une réelle « démocratie
participative », mais elle doit dans certains cas être analysée à l’aide
de cette notion. »[7] Pour
préciser la forme concrète de la démocratie participative, nous pouvons dégager
brièvement quelques principes devant guider le modèle d’un régime politique
appeler à remplacer le cadre institutionnel du gouvernement représentatif.
1 – Participation : Le cœur de la
démocratie participative réside dans la création de nouveaux canaux
institutionnels de participation bottom-up
permettant aux personnes directement affectées par divers problèmes de mettre
en œuvre leur connaissance, intelligence et intérêts dans la formulation
de solutions pratiques :
référendums d’initiative populaire, conseils de quartier décisionnels, deuxième
chambre citoyenne tirée au sort, etc.
2 – Délibération : Le principe
délibératif désigne le fait que les décisions découlant du processus
participatif doivent être basées sur un échange d’arguments permettant de
formuler des choix collectifs par des raisons considérées. Contre le régime
représentatif qui privilégie l’agrégation anonyme des préférences individuelles
par le vote, la démocratie participative et délibérative favorise la formation
rationnelle (critique et réflexive) de la volonté générale par les discussions
publiques et le peuple assemblé à différentes échelles.
3 – Décentralisation : La participation
délibérative nécessite une décentralisation
politique et administrative du pouvoir vers des unités locales, et non une
simple déconcentration bureaucratique
qui préserve une subordination au gouvernement central. Cette distinction
conceptuelle est illustrée par deux formules élégantes de l’homme politique
français Odilon Barrot : dans le premier cas « on
peut gouverner de loin, mais on n'administre bien que de près », alors que
dans le second, « c'est le même marteau qui frappe, mais on en a raccourci
le manche. »
4 – Coordination : Bien que la
décentralisation implique que les unités locales doivent jouir de pouvoirs
substantiels et d’une certaine autonomie, ceux-ci n’opèrent pas en vase clos
comme des micro-États ou des corps politiques souverains. Il faut donc une
décentralisation coordonnée, qui se
distingue à la fois de la décentralisation pure et du centralisme démocratique,
grâce à des mécanismes de communication et de reddition de comptes qui donnent
un rôle significatif aux échelons supérieurs sans miner l’autorité des unités
locales.
5 – Transformation
politique : La démocratie participative se distingue de
l’auto-organisation citoyenne et des mouvements sociaux qui cherchent à
influencer le pouvoir de l’extérieur, car elle requiert l’institutionnalisation
de la participation et de la délibération afin que l’État puisse fournir un
égal accès aux moyens politiques permettant de participer de manière
significative aux décisions collectives qui affectent la vie des citoyens. Ce
dernier principe implique qu’il n’y a pas une différence de degré entre
la démocratie participative et le gouvernement représentatif, un simple ajout
de dispositifs participatifs dans une structure institutionnelle inchangée,
mais une différence qualitative qui
caractérise un nouveau régime politique par la mise en place d’institutions qui
préfigurent une autre société.
Comment peut-on mettre en place un tel
régime participatif ? Comment provoquer une véritable crise du régime
politique actuel ? Telle est l’épineuse question qui sera abordée dans le
prochain texte.
 La course à la chefferie du Parti
québécois aura un impact considérable sur l’avenir du mouvement souverainiste
et de la gauche québécoise dans les prochaines années. Les six candidat(e)s à
la course peuvent être répartis grossièrement en deux catégories : 1) le
camp « progressiste et indépendantiste » composé par Martine Ouellet,
Alexandre Cloutier et Pierre Céré ; 2) le camp « conservateur et
autonomiste » représenté par le tandem Bernard Drainville et Pierre Karl
Péladeau, Jean-François Lisée se trouvant dans un no man’s land opportuniste caractéristique de sa « gauche
efficace ».
La course à la chefferie du Parti
québécois aura un impact considérable sur l’avenir du mouvement souverainiste
et de la gauche québécoise dans les prochaines années. Les six candidat(e)s à
la course peuvent être répartis grossièrement en deux catégories : 1) le
camp « progressiste et indépendantiste » composé par Martine Ouellet,
Alexandre Cloutier et Pierre Céré ; 2) le camp « conservateur et
autonomiste » représenté par le tandem Bernard Drainville et Pierre Karl
Péladeau, Jean-François Lisée se trouvant dans un no man’s land opportuniste caractéristique de sa « gauche
efficace ».