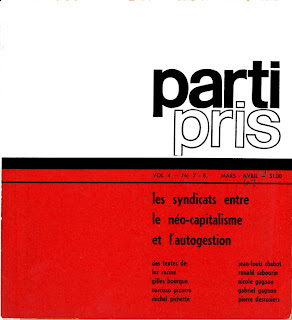Bilan critique de
l’ASSÉ
Entre l’ébullition sociale du
printemps érable et le dernier Sommet sur l’enseignement supérieur, de grandes
fluctuations au sein de la mobilisation étudiante témoignent d’un décalage important
entre le mode d’action des organisations et le contexte institutionnel dans
lequel elles sont situées. C’est pourquoi un bilan critique devient tout à fait
nécessaire pour expliquer à la fois le succès de la grève de 2012 et l’échec du
mouvement étudiant en ce qui concerne la récente indexation des frais de
scolarité. Cela ne tient pas seulement au fait que le Parti québécois avait
déjà pris sa décision et que la non-participation de l’ASSÉ au Sommet n’aurait
rien changé ; c’est bien la faible mobilisation du mois de février 2013 et
les difficultés stratégiques du principal syndicat étudiant qui doivent être
éclairées.
Pour examiner cette délicate
question, nous utiliserons un cadre théorique élaboré par Archon Fung et Erik
Olin Wright, dans leur article Le
contre-pouvoir dans la démocratie participative et délibérative.
À mi-chemin entre la sociologie des mouvements sociaux et la théorie politique
démocratique, l’intérêt de ce cadre d’analyse réside dans le fait qu’il articule
à la fois les nouveaux mécanismes de prise de décision et de gestion publique
qui tentent d’inclure les parties prenantes dans des processus de gouvernance
(le Sommet), et l’approche traditionnelle qui oppose généralement un
gouvernement autoritaire à des « groupes d’intérêts agonistiques »,
c’est-à-dire des organisations qui privilégient l’affrontement comme l’ASSÉ (syndicalisme
de combat). Bien que les adeptes de la gouvernance délibérative soulignent ses
avantages en matière d’innovation, d’efficacité, de transparence et d’équité,
plusieurs demeurent sceptiques de cette approche et soulignent ses nombreux
pièges : érosion du bien commun, faux consensus, maintien des rapports de
domination économique et politique, etc.

Il est donc essentiel de dégager
« les conditions sociales et politiques susceptibles de contrer les
tendances à la confiscation du pouvoir et à la domination qui peuvent émerger
au sein des structures participatives. Notre analyse tournera autour du concept
de contre-pouvoir – à savoir une série de mécanismes capables d’affaiblir,
voire de neutraliser le pouvoir et les prérogatives politiques des acteurs
sociaux normalement dominants. Nous chercherons à montrer que la gouvernance
délibérative requiert presque toujours l’existence d’un contre-pouvoir
significatif si elle doit vraiment engendrer les bénéfices démocratiques que
ses partisans lui attribuent. » (Fung et Wright, 2005 : 50).
Entre gouvernance agonistique
et délibération participative
Pour ce faire, il faut d’abord
distinguer le caractère du processus décisionnel (agonistique ou délibératif),
et la structure de gouvernance (verticale-hiérarchique ou participative).
|
Approche
agonistique
|
Approche
délibérative
|
Gouvernance
verticale-hiérarchique
|
Politique des groupes d’intérêts
traditionnels
|
Résolution des problèmes par les élites
et les experts
|
Gouvernance participative
|
Assemblées générales locales
traditionnelles
|
Diffusion du pouvoir et gouvernance
participative
|
La gouvernance verticale
agonistique (case en haut à gauche) représente le contexte du printemps 2012,
où la structure fermée et hiérarchique du gouvernement provincial faisait face
à un puissant mouvement étudiant qui ne craignait pas la conflictualité. La « participation
agonistique » (case en bas à gauche) représente quant à elle l’extension
de la démocratie participative à la base, comme dans le cas des mouvements
d’occupation des Indignés et les Assemblées populaires autonomes de quartier.
Ensuite, la gouvernance verticale délibérative (case en haut à droite) renvoie
au contexte du printemps 2013 (Sommet sur l’enseignement supérieur), tandis que
« la délibération participative » (case en bas à droite) n’existe pas
encore, car elle suppose une redéfinition du pouvoir à l’échelle de la
société !

Pourquoi des organisations comme
l’ASSÉ ne militent-elles pas pour l’instauration d’une gouvernance
participative-délibérative, qui permettrait de renforcer l’égalité et la démocratie
à tous les niveaux ? « Premièrement, là où le contre-pouvoir est déjà
bien organisé sous des formes agonistiques [lutte syndicale et écologiste], les
organisations concernées risquent de s’opposer à toute évolution
institutionnelle vers la gouvernance délibérative. Leurs compétences et leurs
perspectives sont en effet beaucoup plus adaptées à une dynamique agonistique
et elles tendront à percevoir le passage à la délibération comme risqué,
coûteux et démobilisateur. Deuxièmement, le profil spécifique des institutions
délibératives est généralement le résultat de processus politiques endogènes.
Là où le contre-pouvoir est faible ou inexistant, les règles de délibération
ont tendance à favoriser des intérêts établis, déjà organisés ou fortement
concentrés. Cela peut passer par une limitation ou une prédétermination étroite
des questions ouvertes à la délibération, par la restriction de la gamme des
participants à un petit club d’élus ou par la réduction de l’influence du
dispositif à un simple rôle consultatif. » (Fung et Wright, 2005 :
54)
La question du
contre-pouvoir
C’est pourquoi il faut raffiner
le schéma précédent en distinguant les institutions de gouvernance (gestion
hiérarchique ou délibération participative) et le degré de contre-pouvoir
(faible ou fort).
|
Faible
contre-pouvoir
|
Fort
contre-pouvoir
|
Gestion
hiérarchique
|
I. Mainmise sur les sous-systèmes de
gouvernement
|
II. Pluralisme agonistique
|
Délibération
participative
|
III. Cooptation et simulation de la
participation
|
IV. Diffusion du pouvoir et gouvernance
participative
|
Cette représentation simple des
types d’interactions politiques permet d’illustrer les controverses entre les
partisans de la contestation et de la délibération. La case II représente les
espaces politiques conflictuels où différents mouvements sociaux (ouvriers,
féministes, antiracistes, écologistes, étudiants) ont tenté de faire valoir
leurs revendications auprès de l’État. La case I renvoie de son côté à un
contexte de faible mobilisation sociale, où les groupes dominants exercent une
grande influence sur les décisions publiques. Pour contrer cette tendance à
l’aliénation politique inhérente à la gestion hiérarchique, qui amène la crise
de confiance, le cynisme et la perte de légitimité des institutions
démocratiques que l’on connaît, plusieurs suggèrent d’implanter la
délibération participative. Cependant, il ne faut pas oublier qu’un tel
changement est risqué, ce que n’a pas manqué de souligner l’ASSÉ.

« Pour aller vite, en
l’absence de contre-pouvoir ou de capacité de contre-expertise, on peut
craindre que le passage de la gouvernance agonistique verticale à la
gouvernance délibérative revienne dans la pratique à une réduction des
compétences de l’État et de dérégulation et de déréglementation qui favorise la
cooptation et la neutralisation des forces oppositionnelles par le biais d’un
simulacre de participation délibérative. » (Fung et Wright, 2005 :
56) Ce scénario qui rappelle assez bien le « concertationnisme » du
Parti québécois (case III) doit néanmoins être distingué de la case IV, qui suppose un
élargissement des processus de décision aux citoyens ordinaires, une
décentralisation réelle des pouvoirs et une égalité robuste dans la société.
Pourquoi l’ASSÉ
est-elle inflexible ?
Cependant, il ne faut pas inférer
que le passage de la case II (pluralisme agonistique) à la case IV (gouvernance
participative) soit automatique ou naturel, c’est-à-dire que les
contre-pouvoirs déjà organisés dans les espaces agonistiques soient propices au
développement d’institutions délibératives et participatives. Alors que l’ASSÉ
possède un ensemble de compétences, méthodes, principes organisationnels et
stratégies de mobilisation qui visent à remporter la victoire sur un adversaire
(par la grève générale illimitée notamment), « la délibération
participative suppose une tout autre dynamique organisationnelle, avec des
compétences fort différentes, d’autres sources de légitimité et d’autres
mécanismes de solidarité. » (Fung et Wright, 2005 : 58). Cela
explique pourquoi cette organisation syndicale a été prise au dépourvu dans la
conjoncture du Sommet, de nombreuses associations étudiantes n’ayant pas été
convaincues de boycotter l’événement malgré un apparent simulacre de
participation.

Ainsi, un contre-pouvoir de grève
générale illimitée peut difficilement se redéployer dans un contexte de
gouvernance délibérative. « La stratégie de certains mouvements
revendicatifs monothématiques a souvent des effets pervers de blocage des
solutions politiques […]. Pour ces mouvements, en effet, le conflit est la
meilleure façon d’aborder les problèmes et de mobiliser le soutien à leur
cause. Entrer dans un processus de délibération avec d’autres participants ne
peut que dénaturer la mission du groupe, qui est de pousser la défense de ses
revendications aussi loin que possible face à ses adversaires, et ce dans le
contexte d’un jeu à somme nulle […]. Si un groupe d’intérêt coopère avec ses
adversaires pour résoudre un problème, il perd la pureté de son positionnement ;
il cesse d’être le représentant d’une cause et devient un simple comité. »
(Sagoff, 1999 : 161)
En d’autres termes, devant la délibération, la simple contestation se trouve
désarmée.
Trois obstacles
Face à ce constat, il semble
nécessaire de redéployer le contre-pouvoir agonistique dans les contextes
délibératifs. L’ASSÉ ne devrait pas rester isolée, mais entrer avec sa verve combative
dans un contexte de gouvernance participative pour défendre les intérêts des dominés. Cependant, Fung et Wright soulignent trois obstacles fondamentaux au
passage de la contestation (case II) à la démocratie délibérative (case
IV) : problème d’échelle, de compétences et de cadre cognitif. Tout
d’abord, les groupes agonistiques sont généralement organisés pour influencer
les décisions au niveau central (Assemblée nationale), alors que les institutions
de contre-pouvoir délibératif doivent également opérer à une échelle très
localisée en mobilisant une pluralité d’acteurs. Ensuite, l’ASSÉ
utilise « des stratégies de communication, de diffusion d’information et
de persuasion étroitement ciblées. […] Alors que ces stratégies requièrent toute une gamme de compétences permettant de peser sur les orientations des décideurs, la délibération participative exige
plutôt des compétences en matière de résolution des problèmes et de mise en
œuvre de projets. » (Fung et Wright, 2005 : 72)
 Enfin, le « cadrage de
problèmes » (issue framing) des mouvements sociaux contestataires repose souvent
sur des constructions narratives, des perceptions de l’injustice, des cadres
diagnostics et des raisons motivationnelles qui se prêtent mal à la résolution
délibérative des problèmes, car ils sont trop rigides pour le simple dialogue.
« Ces cadres opèrent des attributions de culpabilité dépourvues
d’ambiguïté […], dépeignent des oppositions manichéennes entre protagonistes
[…] et préconisent des solutions politiques simples et directes. » (Fung
et Wright, 2005 : 73) Il n’est guère étonnant que l’ASSÉ résiste à toute
forme de discussion ou de compromis, car elle devrait alors poser les problèmes
à une autre échelle, développer de nouvelles compétences et transformer radicalement
son cadre cognitif, ce qui risquerait d’éroder sa base de mobilisation,
remettre en question ses motivations profondes et même ses raisons
d’exister !
Enfin, le « cadrage de
problèmes » (issue framing) des mouvements sociaux contestataires repose souvent
sur des constructions narratives, des perceptions de l’injustice, des cadres
diagnostics et des raisons motivationnelles qui se prêtent mal à la résolution
délibérative des problèmes, car ils sont trop rigides pour le simple dialogue.
« Ces cadres opèrent des attributions de culpabilité dépourvues
d’ambiguïté […], dépeignent des oppositions manichéennes entre protagonistes
[…] et préconisent des solutions politiques simples et directes. » (Fung
et Wright, 2005 : 73) Il n’est guère étonnant que l’ASSÉ résiste à toute
forme de discussion ou de compromis, car elle devrait alors poser les problèmes
à une autre échelle, développer de nouvelles compétences et transformer radicalement
son cadre cognitif, ce qui risquerait d’éroder sa base de mobilisation,
remettre en question ses motivations profondes et même ses raisons
d’exister !
Vers un
contre-pouvoir délibératif
Cela ne veut pas dire qu’il
faille abandonner la contestation et se ranger à l’impuissance d’une
délibération simulée. Le mot d’ordre est le suivant : pas de
délibération sans contestation, c’est-à-dire sans contre-pouvoir effectif
capable de remettre en question les termes du débat et d’établir un rapport de
force pour mitiger la domination des intérêts puissants. Ainsi, loin de se
limiter à une seule stratégie (la grève), il faut envisager les modalités
d’émergence d’un contre-pouvoir délibératif. À ce titre, Fung et Wright soulignent
trois pistes, qui ne sont pas mutuellement exclusives : A) la multiplication d’organisations agonistiques
locales ; B) l’initiative de partis politiques ; C) l’impulsion de
mouvements sociaux organisés plus amples.

Premièrement, les principales
formes de contre-pouvoir délibératif sont généralement enracinées au niveau local : réseaux écologistes, associations de quartier, groupes
communautaires, organisations de mères au niveau municipal, etc. Ces
organisations ont plus de facilité à passer d’un mode agonistique à la
délibération, parce qu’elles sont déjà situées au niveau sociopolitique
approprié pour une résolution décentralisée des problèmes. Les groupes
agonistiques locaux ne sont donc pas confrontés à des problèmes d’échelle, de compétence
ou de cadre cognitif qui bloquent habituellement le passage de la lutte à
la délibération. « Ils connaissent intimement les problèmes économiques,
écologiques ou scolaires de leurs collectivités. Nombre d’entre eux
fonctionnent déjà de fait comme fournisseurs directs de services à la
communauté et sont familiarisés avec les particularités et les difficultés de
la mise en œuvre de programmes ad hoc. »
(Fung et Wright, 2005 : 75).
Deuxièmement, l’implantation
systématique de contre-pouvoirs délibératifs pourrait se faire par le biais
d’un parti politique de gauche comme Québec solidaire, qui propose de
démocratiser les institutions verticales, d’accroître la participation
populaire et de faire en sorte que la résolution délibérative de conflits ne se
fasse pas d’abord au profit des riches et des puissants, mais au bénéfice des
groupes dominés. « Ce faisant, ils favorisent la constitution de groupes
de bénéficiaires de ces politiques, lesquels soutiendront en retour les
initiateurs de telles réformes. L’action de ce type d’acteur politique risque
sans doute l’hostilité de l’administration et des intérêts établis, mais c’est
là le prix à payer pour conquérir le soutien et la participation des
masses. » (Fung et Wright, 2005 : 76). On peut penser au Left
Democratic Front conduit par le Parti communiste d’Inde au Kerala, ou au Parti
des travailleurs brésilien qui a implanté le budget participatif dans la ville
de Porto Alegre.
Troisièmement, on pourrait
imaginer une lente transformation d’organisations agonistiques comme l’ASSÉ,
qui donnerait une autonomie accrue à ses sections locales et chercherait à
créer des coalitions durables avec d’autres syndicats et groupes
environnementaux afin d’élargir le spectre de leurs revendications. Bien qu’on
parle souvent de convergence des luttes et de grève sociale, la réalisation
pratique de cette unité théorique ne pourra se faire qu’en créant des alliances
entre différents mouvements sociaux, organisations locales et groupes
d’intérêts capables de délibérer entre eux. Les nombreux obstacles (échelles,
compétences, cadres cognitifs) ne doivent pas être négligés, mais un élargissement
du « cadrage des enjeux », le partage des connaissances entre
mouvements et la pluralité organisationnelle laissent entrevoir l’émergence de
nouvelles possibilités stratégiques que nous n’avons pas encore imaginées.
Pour la suite du
monde
Une hypothétique coalescence
entre les groupes de défense des chômeurs et précaires contre la réforme de
l’assurance-emploi, les coalitions contre l’exploitation des hydrocarbures et
le Plan nord, le mouvement étudiant, Idle no more, etc., doit maintenant être
sérieusement envisagée afin que les entraves aux alliances soient surmontées
par une délibération critique et constructive. Le nouveau Réseau écosocialiste
de Québec solidaire, ouvert aux non-membres du parti (mais en solidarité
politique avec lui), est déjà un bon départ pour entreprendre de telles
connexions entre les mouvements sociaux.
 Cela permettrait de fédérer un
grand nombre d’acteurs et d’organisations sans tomber dans le piège du « concertationnisme
de la société civile », comme le montre la plus récente coalition que Dominic
Champagne essaie de mettre sur pied. Celle-ci prône une « gestion
démocratique des ressources naturelles », qui se résume à
« développer pour que ça profite à tous ». Une délibération
participative sans contre-pouvoir réel, l’obsession du consensus qui neutralise
la combativité des mouvements sociaux, une simple recommandation déposée
gentiment devant le gouvernement, tout cela ne remet pas en question les
rapports de domination économique et politique qui sévissent entre l’État, les
industries et les citoyen(ne)s !
Cela permettrait de fédérer un
grand nombre d’acteurs et d’organisations sans tomber dans le piège du « concertationnisme
de la société civile », comme le montre la plus récente coalition que Dominic
Champagne essaie de mettre sur pied. Celle-ci prône une « gestion
démocratique des ressources naturelles », qui se résume à
« développer pour que ça profite à tous ». Une délibération
participative sans contre-pouvoir réel, l’obsession du consensus qui neutralise
la combativité des mouvements sociaux, une simple recommandation déposée
gentiment devant le gouvernement, tout cela ne remet pas en question les
rapports de domination économique et politique qui sévissent entre l’État, les
industries et les citoyen(ne)s !
D’autre part, l’ASSÉ ne peut pas
se contenter de reprendre machinalement une grève générale illimitée à
l’automne 2013 ou l’hiver 2014, qui risque de ne pas fonctionner si elle ne
déborde pas le cadre du syndicalisme étudiant. Les organisations agonistiques
doivent redéployer de nouvelles stratégies capables de tenir compte du contexte
de la « gouvernance délibérative », celui-ci étant beaucoup plus efficace que la fermeture du gouvernement libéral pour
bloquer les mouvements sociaux. Un
simple refus de la concertation et de la cooptation ne pourra malheureusement
pas faire le poids si les autres acteurs embarquent dans la « simulation
participative » sans créer en même temps un contre-pouvoir délibératif.
 Somme toute, l’échec du printemps
2013 ne découle pas de décisions particulières des membres ou dirigeant(e)s de
l’ASSÉ, mais de la nature même de cette organisation. Celle-ci est avant tout basée
sur une participation agonistique adaptée pour affronter la gouvernance hiérarchique, mais beaucoup moins efficace dans un contexte de gouvernance délibérative.
Heureusement, les organisations agonistiques nationales peuvent évoluer, mais
elles doivent pour cela être prêtes à cadrer différemment les enjeux, acquérir
des compétences discursives, multiplier les alliances avec d’autres groupes non
étudiants et agir à plusieurs échelles simultanément afin de déployer un
contre-pouvoir délibératif nécessaire à l’émergence d’une authentique
démocratie participative à l’échelle de la société.
Somme toute, l’échec du printemps
2013 ne découle pas de décisions particulières des membres ou dirigeant(e)s de
l’ASSÉ, mais de la nature même de cette organisation. Celle-ci est avant tout basée
sur une participation agonistique adaptée pour affronter la gouvernance hiérarchique, mais beaucoup moins efficace dans un contexte de gouvernance délibérative.
Heureusement, les organisations agonistiques nationales peuvent évoluer, mais
elles doivent pour cela être prêtes à cadrer différemment les enjeux, acquérir
des compétences discursives, multiplier les alliances avec d’autres groupes non
étudiants et agir à plusieurs échelles simultanément afin de déployer un
contre-pouvoir délibératif nécessaire à l’émergence d’une authentique
démocratie participative à l’échelle de la société.
|
Faible
contre-pouvoir
|
Fort
contre-pouvoir
|
Gestion
hiérarchique
|
Société québécoise en général,
démocratie représentative élitiste
|
Printemps érable, ASSÉ, mouvements
sociaux actuels
|
Délibération
participative
|
Sommet sur l’enseignement supérieur,
concertationnisme, bonne gouvernance, syndicalisme corporatiste, coalition
environnementaliste à la Dominique Champagne
|
Démocratie participative à venir,
syndicalisme de combat articulé à la gauche politique, Réseau écosocialiste
et nouvelles alliances entre mouvements sociaux
|