D’abord publié dans la revue Nouvelles pratiques sociales, vol.26,
no.1, 2013, p.215-229
Introduction
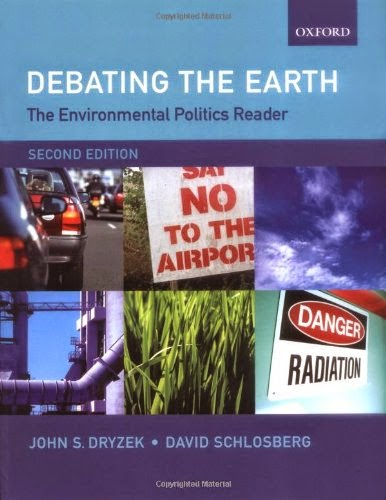 De manière générale, l’écologie
politique étudie les relations entre les facteurs économiques, sociaux et
politiques qui tentent de répondre aux enjeux de la crise écologique. Derrière
cette définition large se cache néanmoins une pluralité de discours, allant des
limites de la croissance à l’économie environnementale, du développement
durable à l’écologie profonde, de la modernisation écologique au mouvement pour
la justice environnementale, etc. (Dryzek, Schlosberg, 2005) Si la crise
écologique est devenue aujourd’hui un enjeu incontournable disséminé dans
l’ensemble de l’espace public mondial, reste-t-il encore quelque chose de
spécifique à l’écologie politique, en tant que théorie normative et projet
social? Selon Philippe Van Parijs, « cette doctrine s’articule sur la
critique de la société industrielle et prétend, sur cette base, offrir un
projet global de société, comparable et opposable aux deux grandes idéologies
de l’ère industrielle : le libéralisme et le socialisme » (Van
Parijs, 2009a : 14).
De manière générale, l’écologie
politique étudie les relations entre les facteurs économiques, sociaux et
politiques qui tentent de répondre aux enjeux de la crise écologique. Derrière
cette définition large se cache néanmoins une pluralité de discours, allant des
limites de la croissance à l’économie environnementale, du développement
durable à l’écologie profonde, de la modernisation écologique au mouvement pour
la justice environnementale, etc. (Dryzek, Schlosberg, 2005) Si la crise
écologique est devenue aujourd’hui un enjeu incontournable disséminé dans
l’ensemble de l’espace public mondial, reste-t-il encore quelque chose de
spécifique à l’écologie politique, en tant que théorie normative et projet
social? Selon Philippe Van Parijs, « cette doctrine s’articule sur la
critique de la société industrielle et prétend, sur cette base, offrir un
projet global de société, comparable et opposable aux deux grandes idéologies
de l’ère industrielle : le libéralisme et le socialisme » (Van
Parijs, 2009a : 14).
Par ailleurs, bien que nous
soyons maintenant rendus à la « troisième vague » de l’écologie
politique, caractérisée par une approche explicitement interdisciplinaire et
appliquée (Barry, 2012), il semble que celle-ci ait oublié un élément essentiel
du monde contemporain : la réalité urbaine. Or, plus de la moitié de la
population mondiale habite maintenant dans les villes, ce qui n’est pas sans
conséquence sur l’environnement (Verron, 2007). Évidemment, toute une
littérature florissante sur la « ville durable » tente d’intégrer les
dimensions économiques, sociales et écologiques du développement urbain. Les
villes compactes, l’efficience écoénergétique, la mixité sociale et la gouvernance
participative sont devenues des lieux communs en urbanisme et en aménagement du
territoire.
Néanmoins, ces initiatives
tombent souvent dans le registre de l’environnementalisme,
c’est-à-dire une approche managériale des problèmes environnementaux qui croit
pouvoir les résoudre sans changer en profondeur les valeurs, les institutions,
les modes de production et de consommation actuels (Dobson, 2000). Le discours
environnemental dominant reste attaché à la croissance économique et à une
conception faible de la durabilité, qui suppose que la destruction du capital
naturel peut être compensée par du capital artificiel. Les plans de
compensation de gaz à effet de serre servant à mitiger les effets de
l’étalement urbain constituent un bon exemple.
À l’inverse, l’écologie
politique ne se limite pas à un remaniement superficiel des institutions
sociales, économiques et politiques. Elle met plutôt à l’avant-plan un domaine
trop souvent ignoré : la sphère autonome. Voisine des notions de société
civile et d’économie sociale, la sphère autonome fait écho aux organismes sans
but lucratif, aux activités d’autoproduction, au milieu communautaire, aux
engagements citoyens et aux interactions au sein de l’espace public qui
permettent de tisser des liens de solidarité et des réseaux de proximité,
favorables à la cohésion sociale et à la préservation de l’environnement. La
sphère autonome permet d’éclairer autrement la question urbaine, en insistant
sur le rôle particulier des activités non marchandes et citoyennes dans la
construction d’une ville juste et écologique. Or, les activités autonomes au
sein de l’espace urbain ne peuvent se généraliser dans un monde contraint par
l’insécurité économique, la précarité de l’emploi et la monopolisation du temps
par le travail.
 La thèse principale de cet
article se formule donc comme suit : une politique de la ville, tournée
vers l’aménagement d’espaces d’autonomie, nécessite une politique du temps,
ayant pour cœur l’implantation d’un revenu suffisant garanti. La coopération
locale et les activités citoyennes ont besoin de lieux spécifiques, mais
ceux-ci ne peuvent être investis sans une sortie progressive de la société du
travail, et donc d’une limitation de la rationalité économique via
l’accroissement du temps libre. L’écologie politique de la ville sera analysée
en trois moments. Premièrement, le projet social de l’écologie politique sera
précisé par la description de la sphère autonome, de même que sa pertinence
pour la transformation écologique de la ville. Deuxièmement, une analyse du régime
postfordiste et de la précarité grandissante fera ressortir la nécessité de
libérer le temps du carcan du travail salarié. Une défense du revenu suffisant
garanti sera alors présentée à partir de la perspective du pionnier de
l’écologie politique, André Gorz. Troisièmement, l’aménagement d’espaces
publics favorables à l’émergence d’activités autonomes et citoyennes visera à
concrétiser « spatialement » une politique globale du temps,
permettant une sortie progressive du capitalisme vers une société de multiactivité.
La thèse principale de cet
article se formule donc comme suit : une politique de la ville, tournée
vers l’aménagement d’espaces d’autonomie, nécessite une politique du temps,
ayant pour cœur l’implantation d’un revenu suffisant garanti. La coopération
locale et les activités citoyennes ont besoin de lieux spécifiques, mais
ceux-ci ne peuvent être investis sans une sortie progressive de la société du
travail, et donc d’une limitation de la rationalité économique via
l’accroissement du temps libre. L’écologie politique de la ville sera analysée
en trois moments. Premièrement, le projet social de l’écologie politique sera
précisé par la description de la sphère autonome, de même que sa pertinence
pour la transformation écologique de la ville. Deuxièmement, une analyse du régime
postfordiste et de la précarité grandissante fera ressortir la nécessité de
libérer le temps du carcan du travail salarié. Une défense du revenu suffisant
garanti sera alors présentée à partir de la perspective du pionnier de
l’écologie politique, André Gorz. Troisièmement, l’aménagement d’espaces
publics favorables à l’émergence d’activités autonomes et citoyennes visera à
concrétiser « spatialement » une politique globale du temps,
permettant une sortie progressive du capitalisme vers une société de multiactivité.
Par ailleurs, il faut noter que
cette esquisse d’une écologie politique urbaine ne fait aucunement référence à
l’écologie sociale du célèbre penseur et militant anarchiste Murray Bookchin (2010).
Bien que celle-ci permette d’approfondir la critique du capitalisme et des
diverses hiérarchies en proposant un projet politique de démocratie radicale,
le municipalisme libertaire (Biehl, 1998), cette perspective originale ne
sera pas abordée. Comme le cœur de l’article repose sur la question du revenu
suffisant garanti et que cette « réforme révolutionnaire » ne fut pas
adoptée par Bookchin, nous miserons davantage sur l’écosocialisme gorzien, qui
demeure encore largement méconnu dans les milieux universitaires et
associatifs.
Qu’est-ce que l’écologie
politique?
Selon une idée largement
répandue, l’écologie politique ne serait ni de droite ni de gauche. Elle ne se
laisserait pas réduire au débat qui oppose la droite extrême du marché pur
(néolibéralisme) à l’extrême gauche de l’État total (socialisme autoritaire).
Néanmoins, il serait excessif d’affirmer que les conflits entre les impératifs
d’accumulation et de redistribution, de libéralisation et de régulation
économique, seraient dépassés et que l’écologie se trouverait au centre, dans
un juste milieu anodin. L’axe gauche/droite demeure tout à fait pertinent, mais
il faut lui ajouter une nouvelle dimension, celle de l’autonomie. L’espace
bipolaire qui opposait les libéraux fervents du marché aux socialistes
défenseurs de l’État fait maintenant place à un triangle, dont le sommet est
occupé par les écologistes, promoteurs de la sphère autonome (Van Parijs,
2009a : 15).
Définie de manière négative, la
sphère autonome se caractérise par l’ensemble des activités productives dont le
produit n’est ni vendu sur le marché ni commandé par une autorité publique. Il
s’agit en quelque sorte de l’auto-organisation des rapports sociaux en dehors
du marché et de l’État. Il existe évidemment une foule d’activités
intermédiaires comme des entreprises publiques (entre l’État et le marché), des
organismes civiques et politiques (entre l’État et l’autonomie) et les
coopératives (entre l’autonomie et le marché).
« C’est dans cette sphère
qu’on se meut, par exemple, lorsqu’on tond sa pelouse et lorsqu’on accouche,
lorsqu’on organise une fête de rue comme lorsqu’on corrige un article de
Wikipédia, lorsqu’on se met en quête d’une maison de repos pas trop chère pour
une vieille voisine comme lorsqu’on colle des affiches pour Écolo, lorsqu’on
tance un vandale dans le métro comme lorsqu’on apprend à ses enfants à couper
un potimarron. » (Van Paris, 2009b : 87-88)
Cette caractérisation des
activités sociales possède plusieurs implications éthiques et politiques, comme
la critique de la croissance économique et de son principal indicateur, le PIB,
qui n’est rien d’autre que le calcul des biens et services produits et échangés
dans la sphère hétéronome du marché et de l’État. C’est pourquoi l’écologie
politique entre en forte résonnance avec la théorie de la décroissance
conviviale (Latouche, 2006, Ariès, 2009), qui vise à trouver dans les
limites objectives et écologiques de la croissance économique la nécessité de
multiplier les activités subjectivement désirables au sein de la « sphère
chaude » de la réciprocité et des relations de voisinage. Le sens de
l’écologie politique devient manifeste par sa promotion systématique de la
sphère autonome, qui favorise la satisfaction immédiate des besoins par
l’autoproduction et la délibération démocratique, par opposition aux mécanismes
du libre marché ou à l’économie centralement planifiée qui augmentent
l’hétéronomie des individus et des communautés.
La critique radicale de la
raison économique développée par le philosophe André Gorz permet de
dépasser l’horizon de l’État-providence libéral en traçant les contours d’un
projet « écosocialiste ». Dans l’esprit de Karl Polanyi (2009), il
s’agit de critiquer l’utopie libérale du marché autorégulé, qui rend la
rationalité économique totalement autonome de la société. Dans cette société de
marché, l’économie est « désencastrée » des normes culturelles et
politiques, ce qui lui permet de « coloniser le monde vécu ». Pour
défendre une « culture du quotidien », réduire les inégalités
sociales et limiter l’exploitation de la nature, il est nécessaire de
« réencastrer » l’économie dans la société, ou plus spécifiquement la
sphère autonome. Les activités productives doivent être limitées par des normes
sociétales et écologiques déterminées par la société civile.
 « Il ne s’agit pas de supprimer tout ce par quoi la société
est un système dont le fonctionnement
n’est pas entièrement contrôlable par les individus ni réductible à leur
volonté commune. Il s’agit plutôt de réduire l’empire du système et de le
soumettre au contrôle et au service des formes d’activité sociale et
individuelle autodéterminées. Il s’agit de transformer la société en un
ensemble d’espaces où des formes multiples d’association et de coopération
puissent s’épanouir, et d’illustrer la possibilité concrète de réappropriation
et d’auto-organisation de la vie en société par des formes rénovées de
pratiques politique, syndicale et culturelle. » (Gorz, 1991 :
105-106)
« Il ne s’agit pas de supprimer tout ce par quoi la société
est un système dont le fonctionnement
n’est pas entièrement contrôlable par les individus ni réductible à leur
volonté commune. Il s’agit plutôt de réduire l’empire du système et de le
soumettre au contrôle et au service des formes d’activité sociale et
individuelle autodéterminées. Il s’agit de transformer la société en un
ensemble d’espaces où des formes multiples d’association et de coopération
puissent s’épanouir, et d’illustrer la possibilité concrète de réappropriation
et d’auto-organisation de la vie en société par des formes rénovées de
pratiques politique, syndicale et culturelle. » (Gorz, 1991 :
105-106)
Ce paradigme n’implique pas la
disparition totale du marché et de l’État, mais la complémentarité des trois
sphères, chapeautée par la prédominance des activités autonomes, dans ce qu’on
appelle parfois une « économie plurielle » (Laville et al., 1997). Le marché et l’État
doivent être subordonnés au pouvoir citoyen et démocratique de la société
civile, sans quoi celle-ci restera prisonnière de la logique compétitive et
administrative dominante. Même si elles ne peuvent se passer complètement de la
sphère hétéronome, les activités autonomes favorisent la satisfaction directe
des besoins, le renforcement des capacités d’action (empowerment), la préservation de la nature et la coopération
sociale. Autrement dit, l’écologie politique vise à maximiser le pouvoir des
individus et des communautés, afin qu’ils deviennent moins dépendants du
gouvernement et des entreprises privées.
Ce cadre théorique permet
d’éclairer à nouveaux frais la question de la ville écologique. Au lieu
d’insister uniquement sur « l’évangile de l’éco-efficience »
(Martinez-Alier, 2002 : 5) largement présent dans le discours de
l’urbanisme durable, l’économie sociale et solidaire permet de favoriser le
développement local, l’enracinement communautaire et la démocratie de proximité
(Dahhri, Zaoual, 2007). La relocalisation économique, la résilience
socioécologique[1],
la descente énergétique et les expérimentations communautaires sont des
dimensions indissociables d’un mode de développement qui tient compte des
limites de la croissance comme les changements climatiques et le pic pétrolier.
Le mouvement des « villes en transition » est probablement l’un des
meilleurs exemples de nouvelles pratiques sociales amorçant dès maintenant une
transition écologique à partir de la sphère autonome (Hopkins, 2010).
 Par ailleurs, le sociologue et
philosophe Henri Lefebvre souligne que la ville est le lieu par excellence de
la contradiction entre la valeur d’échange (argent) et la valeur d’usage
(richesse non monétaire) (Lefebvre, 2009 : 4). C’est l’espace où se
déroule la lutte pour la liberté et la participation active dans la communauté,
contre le pouvoir omniprésent de l’argent qui cherche à déposséder les
individus de leur droit d’habiter leur milieu. Ainsi, le droit à la ville doit
s’entendre comme un droit collectif à la réappropriation du monde vécu,
par-delà la sphère économique qui transforme toute chose en marchandise.
Par ailleurs, le sociologue et
philosophe Henri Lefebvre souligne que la ville est le lieu par excellence de
la contradiction entre la valeur d’échange (argent) et la valeur d’usage
(richesse non monétaire) (Lefebvre, 2009 : 4). C’est l’espace où se
déroule la lutte pour la liberté et la participation active dans la communauté,
contre le pouvoir omniprésent de l’argent qui cherche à déposséder les
individus de leur droit d’habiter leur milieu. Ainsi, le droit à la ville doit
s’entendre comme un droit collectif à la réappropriation du monde vécu,
par-delà la sphère économique qui transforme toute chose en marchandise.
« Les besoins urbains spécifiques
ne seraient-ils pas besoins de lieux qualifiés, lieux de simultanéité et de
rencontres, lieux où l'échange ne passerait pas par la valeur d'échange, le
commerce et le profit? Ne serait-ce pas aussi le besoin d'un temps de ces rencontres, de ces échanges? »
(Lefebvre, 2009 : 96)
La question du temps apparaît
donc en filigrane de la question urbaine, les espaces d’autonomie nécessitant
du temps libre pour être investis. Ainsi, comment un citoyen pourrait-il
s’épanouir à travers ses relations de voisinage, s’impliquer dans sa
coopérative d’habitation, embellir son quartier, participer au conseil
municipal ou occuper un espace public sans du temps libéré des exigences du
travail salarié? Avant de s’attaquer aux dimensions spatiales du droit à la
ville, il faut donc remonter à une analyse globale de la société, afin de
s’attarder aux conditions temporelles de l’autonomie.
Libérer le temps
par le revenu suffisant garanti
André Gorz a été l’un des
premiers philosophes marxiens[2] à
analyser les transformations du travail et les nombreuses implications de la
société postindustrielle, tant au niveau des nouvelles formes d’aliénation que
des possibilités d’émancipation. Pour lui, le postfordisme[3]
constitue le régime socioéconomique du capitalisme avancé, lequel est
étroitement associé à la mondialisation néolibérale, le déclin de
l’État-providence, les nouvelles technologies de l’information et des
communications, l’économie du savoir, le la flexibilisation du travail, etc.
Gorz constata très tôt le déclin
rapide de la classe ouvrière au profit de ce qu’il appelle un prolétariat
postindustriel, constitué de chômeurs, précaires, intérims, travailleurs
clandestins, étudiants, temps-partiels, etc. (Gorz, 1980) « Le précariat est à la firme
postindustrielle ce que le prolétariat fut à l’entreprise industrielle »
(Schreuer, 2006). Cette nouvelle situation, où la productivité augmente sans
cesse, conduit à une suppression croissante des emplois, la flexibilisation des
horaires, l’individualisation des salaires, etc. Il en résulte qu’une économie
de travail à grande échelle ne peut donner un revenu suffisant à une masse
croissante de précaires, surtout si le revenu dépend du temps de travail
fourni. Nous sortons donc progressivement de la société du travail sans savoir
vers quoi nous nous dirigeons; la croissance économique persiste sans offrir
les moyens à tous de jouir de ses fruits.
 « Parce que la production
[…] exige de moins en moins de « travail » et distribue de moins en
moins de salaires, il devient de plus en plus difficile de se procurer un
revenu suffisant et stable au moyen d’un travail payé. Dans le discours du
capital, on attribue cette difficulté au fait que « le travail
manque ». On occulte ainsi la situation réelle; car ce qui manque n’est
évidemment pas le « travail », mais la distribution des richesses
pour la production desquelles le capital emploie un nombre de plus en plus
réduit de travailleurs. Le remède à cette situation n’est évidemment pas de
« créer du travail »; mais de répartir au mieux tout le travail
socialement nécessaire et toute la richesse socialement produite. » (Gorz,
1997 : 123-124)
« Parce que la production
[…] exige de moins en moins de « travail » et distribue de moins en
moins de salaires, il devient de plus en plus difficile de se procurer un
revenu suffisant et stable au moyen d’un travail payé. Dans le discours du
capital, on attribue cette difficulté au fait que « le travail
manque ». On occulte ainsi la situation réelle; car ce qui manque n’est
évidemment pas le « travail », mais la distribution des richesses
pour la production desquelles le capital emploie un nombre de plus en plus
réduit de travailleurs. Le remède à cette situation n’est évidemment pas de
« créer du travail »; mais de répartir au mieux tout le travail
socialement nécessaire et toute la richesse socialement produite. » (Gorz,
1997 : 123-124)
C’est ici que Gorz fait allusion
aux questions de justice distributive, tout en élargissant ses considérations;
loin de se limiter à la redistribution des ressources produites, il inclut
également le processus de production, dont la réduction du temps de travail via
la répartition équitable du travail et l’autogestion du temps. L’enjeu
principal devient la maîtrise du temps; il s’agit de transformer la flexibilité
subie en droit de travailler de façon intermittente, offrant ainsi la
possibilité aux individus de mener une vie multiactive où les activités
rémunérées (hétéronomes) et non rémunérées (autonomes) peuvent se relayer et se
compléter mutuellement.
« Pour le prolétariat
postindustriel, il s’agit essentiellement de transformer les fréquentes
interruptions du rapport salarial en une liberté nouvelle : d’avoir droit
à des périodes de non-travail au lieu d’y être condamnés; et donc d’avoir droit
à un revenu social suffisant leur permettant de nouveaux styles et de nouvelles
formes d’activités librement choisies. » (Gorz, 1991 : 150)
L’introduction du revenu
suffisant garanti permettrait donc de sortir progressivement de la société
salariale (où le temps de travail représente le temps social dominant), pour
entrer dans une société de multiactivité, intimement liée au développement de
la sphère autonome. Si le capitalisme représente une société où les valeurs
marchandes sont prépondérantes (société de marché), l’écologie politique
propose son dépassement par la multiplication des activités non marchandes et
citoyennes par l’extension maximale de la sphère autonome, où l’État et le
marché ne joueraient plus un rôle central dans l’organisation de la vie
sociale.
Par ailleurs, il faut préciser
que le revenu garanti existe sous deux principales versions : un revenu
minimum de subsistance (néolibéral), et un revenu suffisant garanti, également
nommé revenu de citoyenneté ou allocation universelle inconditionnelle. D’une part, si l’allocation est insuffisante pour
protéger contre la misère, elle subventionnera des emplois peu qualifiés via le
cumul d’un revenu minimum et d’un salaire faible. La logique néolibérale vise à
transformer la plupart des allocations (familiale, assurance-emploi, etc.) en
un revenu unique, pour inciter les chômeurs à travailler même pour des emplois
peu considérés. Par exemple, le workfare
américain lie le revenu minimum à une obligation de fournir un travail
« d’utilité publique » (comme des services d’entretien), en
sous-payant ce travail par rapport à des emplois normalement syndiqués. Cette interprétation néolibérale du revenu garanti
stigmatise et culpabilise les chômeurs, ceux-ci étant considérés comme
responsables de leur condition (plutôt que le système économique qui élimine
massivement le travail), tout en subventionnant les employeurs. « Le
revenu d’existence permet dès lors de donner un formidable coup d’accélérateur
à la dérèglementation, à la précarisation, à la flexibilisation du rapport salarial,
à son remplacement par un rapport commercial. » (Gorz, 1997 : 137)
 À l’inverse, une allocation
universelle inconditionnelle permet de contrer les effets pervers du revenu
minimum en affranchissant les individus des contraintes du marché du travail.
Loin de représenter une sorte d’assistance sociale généralisée (les individus
étant mis sous la tutelle de l’État-providence), elle est d’abord et avant tout
une politique générative (Giddens, 1994), c’est-à-dire une manière d’inciter
les individus à se prendre en charge par des activités autonomes, où la valeur
d’usage (temps libre) prédomine sur la valeur d’échange (travail salarié).
À l’inverse, une allocation
universelle inconditionnelle permet de contrer les effets pervers du revenu
minimum en affranchissant les individus des contraintes du marché du travail.
Loin de représenter une sorte d’assistance sociale généralisée (les individus
étant mis sous la tutelle de l’État-providence), elle est d’abord et avant tout
une politique générative (Giddens, 1994), c’est-à-dire une manière d’inciter
les individus à se prendre en charge par des activités autonomes, où la valeur
d’usage (temps libre) prédomine sur la valeur d’échange (travail salarié).
« Le revenu social de base
doit leur permettre de refuser le travail et les conditions de travail
indignes; et il doit se situer dans un environnement social qui permette à
chacun d’arbitrer en permanence entre la valeur d’usage de son temps et sa
valeur d’échange : c’est-à-dire entre les utilités qu’il peut acheter en
vendant du temps de travail et celles qu’il produit par l’autovalorisation de
ce temps. » (Gorz, 1997 : 137)
Or, l’inconditionnalité du
revenu suffisant garanti rencontre une objection majeure. Cette politique ne
va-t-elle pas créer une masse de personnes paresseuses vivant aux crochets de
la société? Les travailleurs ne vont-ils pas se révolter contre cette
« non-classe de non-travailleurs », en les marginalisant comme des
parasites du système? Autrement dit, l’allocation universelle ne risque-t-elle
pas de favoriser les passagers clandestins (free
riders), les oisifs et profiteurs du système? La meilleure réponse à cette
objection consiste à renverser le fardeau de la preuve : comment
déterminer le contenu de la contrepartie obligatoire du revenu garanti? Comment
la définir, la calculer, et éviter que le workfare
détruise les emplois publics bien rémunérés? Comment éviter que cette
obligation de travailler multiplie les agences de placement d’une main-d'œuvre
bon marché, servant les firmes postindustrielles qui sous-traitent la majeure
partie de leur production, augmentant ainsi la paupérisation du précariat? Une
réponse élégante à cette contre-objection consiste à situer la contrepartie
obligatoire du revenu garanti dans la sphère autonome.
« Une allocation
universelle permettant de vivre sans travailler doit être liée à l’obligation
faite à tout adulte valide d’accomplir du travail domestique, de soins et
d’approvisionnement pour les personnes dépendantes. Les personnes qui prennent
déjà soin d’un enfant, d’un malade ou d’une personne handicapée seront
dispensées. » (Rifkin, Offe
et Elson, 1993 : 91-92)
Loin de concurrencer les emplois
dans la sphère marchande ou publique, les activités promues seraient
directement investies dans la sphère des activités autonomes. Or, Gorz remarque
à juste titre que cette stratégie comporte des effets pernicieux, car elle fait
se côtoyer de vrais bénévoles et des bénévoles forcés au travail, les seconds
pouvant être rapidement marginalisés. De plus, le travail bénévole obligatoire
est presque un oxymore, car il nie le caractère privé et désintéressé de ce
type d’activités.
« L’obligation du parent
devant son enfant, de l’adulte envers ses parents âgés, est posée comme une
obligation sociale et placée sous contrôle public. Des conduites relationnelles
spontanées – et dont la spontanéité fait la valeur affective – sont
administrativement contrôlées et normalisées. » (Gorz, 1997 : 142)
La sphère autonome serait ainsi
dirigée par une logique administrative et productiviste, tout en transformant
les activités « désintéressées » en moyens de gagner sa vie. C’est
pourquoi le revenu suffisant à inconditionnalité forte (Caillé, Insel,
1996 : 13), est le meilleur moyen de rendre accessibles les activités
autonomes, tout en protégeant leur intégrité. Pour ce qui
est du financement du revenu garanti, plusieurs solutions existent et sont
explorées par des auteurs comme François Blais (2001). Il faut souligner que
cette mesure est défendue par plusieurs économistes, mouvements citoyens et
groupes politiques, de gauche comme de droite, et que les écologistes la défendent
surtout pour ses vertus démocratiques et sa promotion des activités non marchandes.
Libérer l’espace
 Si la question du temps et du
revenu suffisant garanti nous ont temporairement éloignés de la ville, c’était
pour mieux y revenir. L’extension du temps libre permet non pas d’être oisif,
mais de multiplier les activités autonomes, communautaires et citoyennes au
sein de la ville. Un réseau de groupes, d’organisations et de lieux peut dès
lors accroître la valeur d’usage de la vie citadine, et diminuer l’emprise de
la valeur d’échange sur les sphères de production, de loisir et de
participation démocratique.
Si la question du temps et du
revenu suffisant garanti nous ont temporairement éloignés de la ville, c’était
pour mieux y revenir. L’extension du temps libre permet non pas d’être oisif,
mais de multiplier les activités autonomes, communautaires et citoyennes au
sein de la ville. Un réseau de groupes, d’organisations et de lieux peut dès
lors accroître la valeur d’usage de la vie citadine, et diminuer l’emprise de
la valeur d’échange sur les sphères de production, de loisir et de
participation démocratique.
« Il faut que chacun, dès
l'enfance, soit entraîné dans et sollicité par le foisonnement tout autour de
lui de groupes, groupements, équipes, ateliers, clubs, coopératives,
associations, réseaux cherchant à le gagner à leurs activités et projets.
Activités artistiques, politiques, scientifiques, écosophiques, sportives,
artisanales, relationnelles; travaux d'autoproduction, de réparation, de
restauration du patrimoine naturel et culturel, d'aménagement du cadre de vie,
d'économie d'énergie; boutiques d'enfants, boutiques de santé, réseaux
d'échange de services, d'entraide et d'assistance mutuelle, etc. » (Gorz,
1997 : 161-162)
Une politique de la ville peut
justement donner un élan décisif à la sphère autonome, via l’aménagement
d’espaces, d’équipements et d’autres infrastructures matérielles qui
encouragent la coopération, l’éducation et la participation citoyenne. Les
citadins.es auraient la possibilité de développer leurs capacités et leur
créativité, de reprendre possession de leurs quartiers, villes et institutions
pour les façonner à leur image. L’individu passerait alors du statut
d’employé-consommateur à celui d’artisan-citoyen, capable de donner sens, et
transformer le monde dans lequel il vit. Au lieu de réprimer les
expérimentations locales ou la subversion de l’espace public (du mouvement Occupy à l’insurrection de la place
Taksim à Istanbul en mai 2013), la ville pourrait ainsi soutenir les initiatives
et activités autogérées en leur donnant des lieux accessibles et des outils
nécessaires à leur rayonnement.
Les pays scandinaves et la ville
de Copenhague en particulier ont créé des politiques urbaines exemplaires.
Cette réussite est probablement due à la convergence d’une pluralité de
facteurs : urbanisme et architecture, densité du tissu social, transports
collectifs efficaces, politiques sociales favorisant la réduction des
inégalités économiques, etc. Un autre fait majeur, mais souvent oublié réside
dans une particularité culturelle intéressante : les Danois apprécient
davantage le travail à temps partiel, même si leur salaire s’en trouve affecté.
Autrement dit, ils préfèrent améliorer leur « qualité de vie » au
prix d’une baisse de leur « niveau de vie ». « Qu'est-ce qui
fait que la valeur d'usage du temps
libéré du travail est à leurs yeux plus grande que la valeur d'échange du temps de travail rémunéré
(c'est-à-dire que l'argent qu'ils pourraient gagner en plus)? » (Gorz,
1997 : 162-163) Poser la question, c’est déjà y répondre.
Par ailleurs, un revenu
suffisant garanti pourrait être versé sous forme de monnaies locales,
favorisant « le recours aux ressources, aux productions et aux prestations
locales. Puisqu’elle n’est échangeable que dans un rayon limité, elle dynamise
et développe l’économie locale, accroît le degré d’autosuffisance et le pouvoir
que la population peut exercer sur les orientations et les priorités
économiques » (Gorz, 1997 : 169). À l’opposé du libre marché de l’économie
mondiale néolibérale (sphère marchande) et de l’économie nationale
centralisatrice (sphère publique), l’économie sociale et solidaire privilégie
la planification démocratique de l’économie; elle permet de faire l’inventaire
des besoins sociaux collectifs (eau, énergie, nourriture, transports, vêtements
d’usage courant, gestion des déchets, etc.), et de favoriser leur satisfaction
efficace par des systèmes autonomes et participatifs, situés à différents
endroits de la ville.
Par exemple, la gratuité des
transports en commun et de l’accès à Internet (financés par des taxes
municipales), des systèmes énergétiques autonomes (éoliennes communautaires),
des jardins collectifs et d’autres formes d’agriculture urbaine, des centres de
production et de distribution de biens essentiels, sont toutes des manières de
favoriser la résilience écologique et communautaire à l’échelle de la ville. De
plus, il ne faut pas considérer ces mesures de manière isolée, à l’unique
intention des pauvres et des exclus, en préconisant le dogme du
« localisme » contre les méfaits du globalisme marchand. L’économie
sociale ne se veut pas un pis-aller ou un retour à l’économie villageoise
médiévale; il s’agit avant tout d’une économie plurielle qui laisse une place
circonscrite au marché et à l’État, afin que ceux-ci n’empiètent pas sur les
droits de la sphère autonome. L’écologie politique valorise à la fois les
relations de voisinage et l’ouverture sur le monde, en les considérant comme
les deux faces d’une même médaille.
Conclusion
C’est tout un rapport au monde
qui est transformé lorsque nous sortons du paradigme productiviste et
consumériste pour entrer dans le domaine de l’écologie politique et du droit à
la ville. Le droit à l’habitat (comme le droit au logement) ne peut être
dissocié du droit à l’habiter (Lefebvre, 2009). L’« habiter » est une
attitude complexe, un rapport existentiel, social et culturel qui nous lie à
notre environnement humain et naturel. Le droit d’habiter fait donc référence à
la défense du monde vécu, à la résistance contre domination de la valeur
d’échange sur la société. En protégeant notre milieu et sa valeur d’usage, par
des espaces d’autonomie et des moments de rencontre, le monde vécu pourra être
reconstruit par-delà les lambeaux de la société de consommation.
« En changeant la ville,
nous fournirons un levier au changement de société et au changement de la
manière dont les personnes vivent leur rapport et leur inhérence au monde. La
reconstitution d'un monde vécu et vivable suppose des villes polycentriques,
intelligibles, où chaque quartier ou voisinage offre une gamme de lieux
accessibles à tous, à toute heure, pour les auto-activités, les
autoproductions, les auto-apprentissages, les échanges de services et de
savoirs. » (Gorz, 1997 : 163)
Cette reconstruction de la
sphère autonome peut-elle se limiter à la sphère locale? A-t-elle besoin d’un
État, ne serait-ce que pour financer le revenu suffisant garanti, donner
davantage de ressources et compétences aux villes, et limiter l’emprise de
l’industrie de la construction et des marchés immobiliers sur la politique
municipale? Bien qu’il ne soit pas possible d’approfondir ces questions ici,
l’écologie politique de la ville peut être résumée de la manière
suivante : une ville juste et écologique requiert d’abord une libération
du temps, en implantant une allocation universelle inconditionnelle, que ce
soit sous la forme d’un revenu ou d’un accès gratuit aux services publics. Mais
le temps libre doit surtout servir à promouvoir des activités autonomes, qui
nécessitent l’aménagement d’espaces de création, d’éducation, de réflexion et
de participation. Ainsi, la question du temps relève d’abord de la sphère
politique (étatique ou municipale), alors que l’appropriation de l’espace
renvoie à la sphère autonome et culturelle (société civile).
La transformation des
institutions et le changement de mentalités sont bien sûr interconnectés, et
c’est pourquoi nous ne pouvons les dissocier dans le développement de nouvelles
pratiques sociales. Heureusement, une couche grandissante de la population des
pays capitalistes avancés, qualifiée de créatifs culturels (Ray, Anderson,
2000), réinvente déjà le monde à petite échelle dans la sphère autonome, via le
partage de connaissances pratiques (do-it-yourself), les logiciels libres,
l’éducation alternative, l’écocitoyenneté, etc. (Carlsson, 2008) Il s’agit d’un
groupe social émergent, recoupant à certains égards le précariat postindustriel
et la jeunesse scolarisée prisonnière du chômage, qui est particulièrement
présent dans les nouveaux mouvements sociaux et les plus récentes
manifestations contre l’austérité. Néanmoins, ce groupe social hétérogène
demeurera marginal et diffus aussi longtemps que ces initiatives ne seront pas
traduites politiquement; il lui faudra forger un projet de société capable de
former une unité populaire qui pourra réaliser pratiquement ces revendications
culturelles sur le terrain institutionnel.
« En fait, les mentalités
ou, plutôt, les sensibilités changent déjà et avec elles le système des
valeurs. Mais ce changement culturel reste pour chacun une affaire personnelle,
privée, aussi longtemps qu'il n'est pas traduit par une nouvelle organisation
de l'espace social qui en porte la marque et qui lui permet de s'exprimer, de
s'objectiver dans de nouveaux modes d'agir et de vivre en société. Il s'agit de
changer la ville pour que la « nouvelle subjectivité » cesse d'être
un changement qui s'opère seulement « dans ma tête » ou « dans
mon cœur » et que le discours social dominant nie et réprime; pour que ce
changement puisse prendre corps dans les choses, les pratiques et les discours,
développer une dynamique qui le porte au-delà de ses intentions initiales et en
fasse un projet commun à tous, leur volonté générale. » (Gorz, 1997 :
164-165)
Bibliographie
Ariès, P. (2009). Désobéir et
grandir – Vers une société de décroissance, Montréal, Écosociété.
Barry, J. (2012). The Politics of Actually Existing Unsustainability, Oxford, Oxford
University Press.
Biehl, J. (1998). Le
municipalisme libertaire, Montréal, Écosociété.
Blais, F. (2001). Un revenu garanti pour tous. Introduction aux principes de l’allocation
universelle, Montréal, Boréal.
Bookchin, M. (2010). Une société à
refaire. Vers une écologie de la liberté, Montréal, Écosociété.
Caillé, A et A. Insel (1996). « Note sur
le revenu minimum garanti », La
revue du Mauss, no 7,
158-168.
Carlsson, C. (2008). Nowtopia: How Pirate Programmers, Outlaw Bicyclists, and Vacant-lot
Gardeners are Inventing the Future Today, New York, AK Press.
Dahhri, T et H. Zaoual (sous la dir.)
(2007). Économie solidaire et
développement local : vers une démocratie de proximité, Paris,
L’Harmattan.
Dobson, A. (2000). Green Political Thought, 3rd edition, New York, Routledge.
Dryzek, J. S. et D. Schlosberg
(2005). Debating
the Earth, The Environmental Politics Reader, 2nd edition, Oxford, Oxford University Press.
Giddens, A. (1994). Beyond Left and Right. The Future of Radical Politics, Cambridge,
Polity Press.
Gorz, A. (1980). Adieux au prolétariat. Au-delà du socialisme, Paris, Galilée.
Gorz, A. (1991). Capitalisme, socialisme, écologie,
Paris, Galilée.
Gorz, A. (1997). Misères du présent, richesse du possible,
Paris, Galilée.
Latouche, S. (2006). Le pari de la décroissance, Paris,
Fayard.
Laville, J.-L. et al. (1997). Vers une
économie plurielle, Paris, Syros, Alternatives économiques.
Lefebvre, H. (2009). Le droit à la ville, 3e édition, Paris, Anthropos.
Lipietz, A. (1997). « The Post Fordist World: Labor
Relations, International Hierarchy and Global Ecology », Review of
International Political Economy, vol. 4, no 1, 1-41
Martinez-Alier, A.
(2002). The environmentalism of the poor.
A study of ecological conflicts and valuation, Northampton, Edward Elgar.
Polanyi, K. (2009). La grande transformation : aux origines politiques et économiques
de notre temps, Paris, Gallimard.
Ray, P. H. et S.H. Anderson (2000). The Cultural Creatives: How 50 Million People are Changing the World,
New York, Harmony Books.
Rifkin, J., Offe, C. D. et Elson (1993).
« Market Socialism or Socialisation of the Market? », dans Actuel Marx, no 14,
3-44.
Schreuer, F. (2006). « Qu’est-ce
que le précariat? », Politique,
no 46, Bruxelles, 2006.
Van Parijs, P. (2009a). « Impasses et
promesses de l’écologie politique », Étopia,
vol. 3, 11-30.
Van Parijs, P. (2009b). « Post-scriptum : l’écologie
politique comme promotion de l’autonomie et poursuite de la justice
libérale-égalitaire », Étopia,
vol. 3, 85-94.
Verron, J. (juin 2007). « La moitié de la population mondiale vit
en ville », Population et sociétés,
no 435, 1-4.
[1] La résilience socioécologique
désigne la capacité des systèmes sociaux et naturels à s’adapter à
d’importantes perturbations (politiques, économiques ou climatiques). Elle
renvoie à la fois aux conditions de persistance à travers le temps (stabilité),
aux capacités de transformation adaptative, et au maintien des interactions
causales entre les êtres vivants humains et non humains. La résilience
socioécologique constitue un aspect important « d’écologie sociale et
urbaine », qui assure la connexion entre un écosystème humain (comme une
ville) et un écosystème plus large (environnement naturel).
[2] L’adjectif
marxien sert à désigner les auteurs qui se réclament de l’esprit de Marx contre
les marxistes orthodoxes qui l’auraient trahi, comme Cornelius Castoriadis, Guy
Debord, Robert Kurz, Moishe
Postone, Anselm Jappe et Michel Henry.
[3] Le
postfordisme fait suite au fordisme, qui était un régime socioéconomique fondé
sur la production industrielle de masse (taylorisme), des salaires élevés pour
favoriser la consommation, l’État-providence, l’étalement urbain, etc. (Lipietz, 1997)







