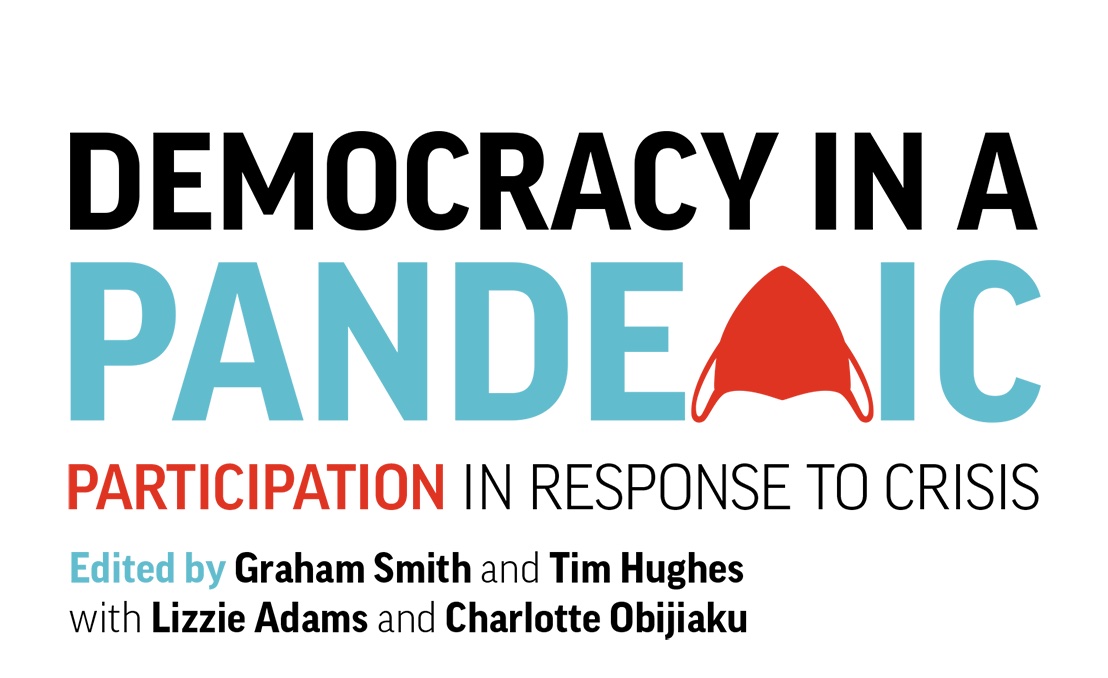*Ce texte est une traduction d'un appel lancé en italien par un collectif de chercheur.e.s en sciences sociales le 1er février 2022. Nous avons utilisé le logiciel DeepL pour produire rapidement une version francophone de ce texte clair et percutant qui propose une réflexion critique de la gestion néolibérale et autoritaire de la pandémie de COVID-19, et interroge le rôle de la recherche universitaire dans le débat public sur cet enjeu central de notre époque.
Scienze sociali e gestione pandemica: un invito al dibattito
Nous sommes un groupe de chercheurs en sciences sociales, appartenant à différentes disciplines, indépendants ou diversement encadrés dans des universités italiennes ou étrangères. Chacun d'entre nous est donc professionnellement habitué à de longues périodes de recherche, à la vérification des données et des sources, à la responsabilité d'auteur, à la rigueur argumentative et à la comparaison avec les collègues. Nous sommes également habitués à reconnaître les limites, les erreurs, les distorsions et la platitude des récits fondés sur l'utilisation opportuniste des données, sur la réduction de la complexité et sur des oppositions manichéennes - qu'il s'agisse de la version dominante ou des récits de conspiration.
Précisément en raison de la valeur critique et anti-hégémonique de nos disciplines, nous pensons que ceux qui les pratiquent aujourd'hui ne peuvent éviter au moins une discussion ouverte et franche sur les politiques autoritaires, discriminatoires et arbitraires avec lesquelles le gouvernement italien, et d'autres, traite la diffusion du Covid-19. Nous sommes conscients que la plupart de nos collègues, implicitement ou explicitement, n'ont pas considéré comme un problème le fait que le gouvernement se soit concentré exclusivement sur la campagne de vaccination comme moyen de sortir de la pandémie. Les vaccins anti-Covid sont utiles pour réduire l'incidence des décès et des maladies graves chez les personnes âgées et/ou les personnes les plus exposées ; mais la plupart des choix politiques effectués au cours des deux dernières années ont ignoré les effets sociaux, politiques et culturels des mesures prises au nom de la santé publique.
L'imbrication de la pandémie et de la gestion de la pandémie érode profondément le monde qui nous entoure, raidit la structure des subjectivités qui l'habitent et déchire le tissu relationnel entre les humains, ainsi qu'entre les humains et les non-humains, et les relations de confiance et de reconnaissance mutuelle que nous appelons "société". Cette désintégration survient à un moment où l'énormité de l'effondrement du climat exigerait que l'humanité entière mette de côté ses différences, ses conflits et ses intérêts particuliers pour tenter d'éviter ensemble une catastrophe écologique. Ne pas s'exprimer à ce sujet serait être de connivence avec la destruction en cours.
Le discours médiatique et la planification des mesures visant à contenir la pandémie se sont exclusivement basés sur les recommandations d'un petit groupe restreint de spécialistes des sciences médicales et biologiques, alors qu'il va de soi que de telles mesures n'auraient dû être prises qu'après une analyse minutieuse de leur impact sur le tissu social. Le poids écrasant accordé aux sciences biologiques, qui sont toujours présentées comme possédant des "vérités" indiscutables, a réduit le débat sur les décisions politiques à un conflit imaginaire entre les secteurs "pro-science" et "anti-science". Depuis les années 1960, une branche entière de notre discipline, l'anthropologie médicale, étudie la construction sociale de la science médicale, les définitions de la maladie et de la santé, les effets pathogènes et pathoplastiques des cultures, montrant par des ethnographies détaillées comment la médecine est un champ de débat et d'affrontement entre des visions culturelles et politiques divergentes, souvent soumises à de fortes pressions commerciales et habituées à légitimer leurs propres rationalités opposées par l'utilisation de données.
C'est précisément la conscience de l'origine et de la destination humaine des faits culturels, comme l'appelait Ernesto de Martino, qui exige que chaque découverte et chaque progrès scientifique, comme le développement rapide des vaccins Covid-19, soit soumis à l'examen de la communauté par la promotion d'un débat social étendu au-delà du cercle étroit des techniciens. La politique et le débat public sont des déterminants structurels de la santé ; les politiques de santé et la gestion de la santé publique doivent être constamment soumises à une critique sociale qui revendique le droit à l'interaction entre médecins et patients, le droit à l'autodétermination du corps, de la santé et des traitements - comme la critique culturelle féministe nous l'a appris - et le droit de demander aux décideurs de rendre compte de leurs choix.
Une autre histoire
Nous, les abonnés de ce texte, avons choisi de pratiquer les sciences sociales aussi et surtout pour leur capacité à produire des connaissances critiques et à mettre à nu les conséquences néfastes des stratégies hégémoniques. Ce que nous avons longtemps étudié, toutes les connaissances produites par nos disciplines depuis un siècle et demi, nous a construit dans notre esprit et dans notre corps. Aujourd'hui, nous ressentons une contradiction flagrante entre le potentiel des sciences sociales à déconstruire le récit émergent, et leur incapacité à l'appliquer à ce que nous vivons comme un tournant répressif de proportions historiques.
Il semble désormais évident que la gestion de la pandémie a été marquée dès le départ par la primauté du profit et le recours systématique à la violence matérielle et symbolique - notamment médiatique et institutionnelle, mais aussi militaire - à l'encontre de la population. La gouvernementalité pandémique s'est déployée à travers l'utilisation politique des sentiments de peur et d'angoisse, avec l'abandon des malades et des soins de santé locaux, l'incertitude existentielle due à un paysage réglementaire en constante évolution, la spectacularisation de la mort, la militarisation du territoire, l'élargissement de la violence structurelle et de l'inégalité économique, la concentration accrue du pouvoir militaire et financier, et la propagation de formes odieuses et pernicieuses de contrôle et de discrimination.
Face aux transformations radicales induites par ces politiques dans les relations sociales et dans la vie quotidienne des individus, la machine administrative et bureaucratique de la gouvernance néolibérale n'a jamais ralenti, au contraire, elle est devenue encore plus écrasante. Une avalanche de règlements, de circulaires, de remplissages, de demandes, de formulaires, s'est déversée sur toutes les sphères de la vie publique, y compris l'université, augmentant encore le quota de travaux décrits par David Graber comme des "bullshit jobs". En Italie, cette gestion autoritaire a atteint son apogée avec l'introduction du passeport vert et la généralisation progressive de la vaccination obligatoire, face aux doutes que des millions de citoyens avaient et ont sur ces vaccins. La critique et la dissidence ont disparu face à une rhétorique morale insistante dans laquelle le politiquement correct et l'appel d'urgence à l'unité nationale ont remplacé la raison et la dialectique.
Cependant, avec le début d'une nouvelle vague de restrictions en février 2022, il serait important de reconnaître publiquement que les politiques menées jusqu'à présent (lockdowns sélectifs, contrôles armés, zones de couleur, traçabilité, laissez-passer verts, vaccination obligatoire) n'ont pas eu l'effet annoncé de contenir la contagion - les données officielles placent l'Italie parmi les nations ayant le plus haut pourcentage de décès attribués à Covid-19 depuis le début de la pandémie - mais ont plutôt eu des conséquences dévastatrices sur le tissu social et politique du pays. L'hypothèse de la gestion des pandémies qui n'a pas de précédent dans l'histoire de l'humanité, à savoir l'idée que l'humanité hyper-technologique du troisième millénaire dispose des outils nécessaires pour traquer et éradiquer un virus contagieux, s'est avérée être une illusion fallacieuse de superbe omnipotence.
Aujourd'hui, alors que les contagions sont totalement hors de contrôle, maintenir les mesures adoptées ces deux dernières années, voire expérimenter des formes inédites de ségrégation sociale pour les non-vaccinés, comme cela a été fait ces derniers mois, est injustifié et dangereux, le résultat d'un acharnement pervers sans aucune raison sanitaire. L'échec des objectifs annoncés est dissimulé par la reproduction de la logique du bouc émissaire : Avant, c'était les coureurs, les enfants, les asymptomatiques, les Chinois, les migrants, les sans-masque, les "négationnistes" ; aujourd'hui, c'est, pour tous, les no-vax, une catégorie stéréotypée et générique, dans laquelle on inclut même ceux qui n'ont pas mis à jour leurs vaccinations à temps, toujours variables, et contre laquelle se sont déchaînées de véritables campagnes de haine médiatiquement promues institutionnellement, qui produisent des divisions profondes et une douleur infinie dans le corps social.
Une véritable sorcellerie épistémologique semble être à l'œuvre, capable d'une part de déformer les mots, les chiffres et les analyses pour continuer à défendre aveuglément une approche coercitive qui a été poussée jusqu'à ne plus pouvoir être repensée, et d'autre part de transformer toute critique - aussi autorisée et disciplinée soit-elle - en conspiration, en ignorance, en "analphabétisme fonctionnel", voire en fascisme. L'accusation d'être fasciste a été construite pour dépeindre toute personne qui s'y oppose ou même la remet en question de manière désobligeante et en dehors du registre moral de la nation. Au contraire, nous pensons que les droits défendus par la constitution antifasciste ont été et sont mis en danger par ces mêmes personnes qui ont abdiqué le doute et crié des avertissements antifascistes. Le régime autoritaire n'est certainement pas représenté par des places composites et peuplées, mais par un gouvernement d'union nationale directement nommé par les élites financières mondiales, qui brise progressivement mais violemment toutes les libertés civiles et s'insinue ensuite dans le corps social avec le virus du contrôle mutuel, de la méfiance, de la suspicion, de la pensée unique et de l'illusion. En bref, c'est une autre histoire.
Les représentants politiques ont évoqué le massacre à maintes reprises, fomentant intentionnellement la peur comme moyen d'obtenir un consensus. Cette nécro-narration a été utilisée par le président Draghi lui-même, qui, le 22 juillet 2021, a soutenu la campagne de vaccination en déclarant que l'appel à ne pas vacciner est un appel à la mort ; on ne vaccine pas, on infecte, on meurt, ou on est infecté et on meurt. Il est surprenant que parmi les nombreux collègues qui travaillent depuis des décennies sur la biopolitique et la nécropolitique, peu les aient associés à des dispositifs terroristes ayant une forte emprise sur l'inconscient collectif, comme le " code noir ", la limite d'occupation des unités de soins intensifs, au-delà de laquelle les médecins seraient contraints de décider qui soigner et qui laisser mourir. Sa mise en œuvre a été diffusée en décembre 2021, alors que le taux d'occupation des soins intensifs était bien inférieur aux seuils d'urgence.
Il nous semble clair que le débat public a été systématiquement et intentionnellement bloqué par la reconstitution continuelle du traumatisme collectif vécu en mars 2020, dont l'icône est constituée par les camions de la protection civile de la région de Bergame chargés de cadavres. Si l'objectif des politiques avait été le bien-être de la population, la douleur et la peur collectives produites alors auraient dû être intégrées, diluées et compensées par une communication publique attentive. La violence verbale des représentants des institutions a plutôt visé à masquer des décennies de politiques néolibérales qui ont amplifié la crise des fondements sociaux du monde actuel.
Maladie de la société ou société malade?
L'anthropologie médicale enseigne que tout processus de gestion des maladies, dès sa définition, a une implication idéologique, ancrée dans le système cosmologique et les hypothèses culturelles de référence. La gestion de Covid-19 n'a pas été différente. Indépendamment de sa réalité phénoménale et quantitative, il s'est avéré être l'occasion d'une restructuration d'époque des relations de production et d'un remodelage des relations sociales par une accélération des torsions autoritaires avec lesquelles le capitalisme a progressé au cours des quatre dernières décennies. Cela se traduit à la fois par la manière dont les restrictions de mouvement ont été gérées et par la manière dont la campagne de vaccination a été menée, dans le but premier et ultime de relancer la production et la consommation.
L'objectif poursuivi n'était pas d'arrêter la machine, ni de porter atteinte au profit privé à grande échelle : au plus fort de l'urgence, lorsque les coureurs étaient harcelés par des drones en direct à la télévision et que les petits commerçants étaient contraints de fermer, ils n'ont jamais fermé les portes des grandes usines du nord liées à la Confindustria, qui était déjà la principale responsable de la non-fermeture des usines du Val Seriana, l'un des foyers initiaux de la Covid-19. Mais le fait que le laissez-passer vert avait un rôle immédiat à jouer dans la régulation des rapports entre les classes est apparu clairement dès qu'un représentant de la principale organisation patronale italienne a déclaré que les non-vaccinés étaient les déserteurs d'une guerre que seule la résistance démocratique pouvait empêcher d'être tirée au cordeau. Sur le plan matériel, le passeport vert a permis d'éviter des poursuites judiciaires en cas de contagion. Sur un plan plus général et politique, elle a produit un dispositif dystopique qui accroît le contrôle sur la vie des travailleurs et des travailleuses, offrant un instrument de menace supplémentaire aux mains des employeurs. Qui et quand décidera que la phase d'urgence est terminée ? Les politiques d'urgence, en particulier le passeport vert, seront-elles retirées ou fonctionneront-elles comme un dispositif de contrôle et de gouvernance qui sera réactivé périodiquement ?
De nombreuses organisations et mouvements de gauche se sont engagés à élaborer des manifestes, des programmes et des propositions, afin que la propagation du Covid-19, avec le chagrin et la souffrance qu'elle a entraînés, puisse servir de leçon : la dangerosité de la maladie, en effet, est liée non seulement aux caractéristiques du virus, mais aussi à l'état de santé de nos sociétés occidentales, et aurait permis de repenser toute la gestion de la santé publique dans une clé collective. Tout d'abord, il était clair dès le départ que le Covid-19 a des effets beaucoup plus graves chez les personnes souffrant de maladies non transmissibles telles que l'hypertension, l'obésité, le diabète, les maladies chroniques cardiovasculaires, respiratoires et cancéreuses, qui sont particulièrement répandues dans les pays du Nord. Deuxièmement, l'action du virus est renforcée par la pollution et en particulier par l'exposition aux particules ultrafines présentes dans l'atmosphère. Troisièmement, le transfert colossal de ressources des soins de santé publics vers les soins de santé privés, accéléré par la pandémie, a rendu l'accès à la santé et la protection de celle-ci beaucoup plus difficiles, notamment pour les sections les plus vulnérables de la population.
L'illusion était que les classes dirigeantes - politiques, entrepreneuriales, médias - allaient enfin réparer les dommages causés par des décennies de pollution légale et de réduction des dépenses publiques, ainsi qu'en confiant des tranches croissantes de bien-être au secteur privé, par exemple en rendant les écoles capables de fonctionner dans le nouveau contexte, en augmentant les équipements de transport public et en réduisant la pollution atmosphérique. Deux ans plus tard, cette illusion s'est avérée fallacieuse. Les politiques ont pris une direction complètement différente ; les dépenses publiques italiennes en matière de santé sont toujours très inférieures à la moyenne européenne, le PNRR prévoit qu'elles vont encore baisser après l'augmentation de 2021, tandis que le processus de privatisation devient de plus en plus structurel.
Ce qui nous intéresse ici est une autre contradiction : si le système national de santé est né - surtout dans ses expériences les plus avancées et les plus conscientes - avec l'idée qu'un élément essentiel de la santé était la démocratie et la participation communautaire, ainsi que (et plus que) l'utilisation massive de médicaments, l'approche gouvernementale pour contenir la crise sanitaire a eu des caractéristiques opposées. L'accent n'a pas été mis sur l'"implication" participative des territoires, et aucune attention n'a été accordée aux inégalités sociales. Au contraire, avec l'introduction du passeport vert, la promotion de la "santé" a été poursuivie exclusivement par des mesures censées limiter la circulation du virus par la compression du droit à la mobilité et au travail pour des millions de personnes : exactement le contraire de l'idée de la santé comme participation démocratique et lutte contre les inégalités sociales. Il existe des liens à la fois théoriques et concrets entre le désengagement du système de santé publique et l'utilisation d'instruments de contrôle social tels que le pass vert : d'une part, les difficultés du système de santé publique - également dues à des années de coupes budgétaires - justifient l'utilisation d'instruments de contrôle ("il faut éviter d'engorger les unités de soins intensifs") ; d'autre part, le pass vert fait porter la responsabilité de la propagation de la contagion aux citoyens plutôt que de remettre en question les choix thérapeutiques nationaux et l'efficacité des hôpitaux.
Les mesures de gestion Covid-19 parviennent à conserver leur légitimité parce qu'elles ne sont jamais contrebalancées par une analyse exhaustive de leur iatrogénèse, c'est-à-dire de leurs effets secondaires néfastes : médicaux (retards chroniques dans les tests de diagnostic, les interventions chirurgicales, complications dues à la peur d'aller à l'hôpital, effets secondaires des vaccins, etc.) ; psychologiques (augmentation vertigineuse des cas de dépression et d'anxiété, surtout chez les plus jeunes, propagation de la perception de l'entourage comme source potentielle de contagion, etc.) ; sociaux (production de chômage et d'exclusion sociale, etc.). ) ; sociale (production de chômage et de pauvreté, étranglement des petites activités productives et commerciales, haine et discrimination sociales) ; politique (suspension arbitraire continue des droits constitutionnels, introduction de systèmes numériques de contrôle de masse sans précédent, stigmatisation de la dissidence) ; épistémologique (loyauté obligatoire des chercheurs et des universitaires, dérision publique de toute position critique, etc.)
L'utilisation intentionnelle de la violence brise la résistance psychophysique des sujets et produit une adhésion à la cosmovision du tortionnaire. En tant que société, nous avons été violés à tel point qu'il semble désormais impossible d'imaginer un modèle de gestion des crises sanitaires différent de celui de Covid-19. Pourtant, des réponses intelligentes et viables à la crise pandémique ont été proposées par de nombreuses réalités (de recherche, d'action sociale, d'activisme politique) depuis la fin du printemps 2020. Une gestion différente de la crise - une gestion non-violente - était possible dès le départ et aurait eu des résultats bien différents.
Autres perspectives sur la pandémie. Pour un modèle non-violent de santé publique
En tant qu'ethnographes, nous avons dû, durant ces deux années, nous tenir à l'écart des populations que beaucoup d'entre nous ont côtoyées, aux quatre coins du monde. Qu'est-il advenu d'eux dans cette situation ? Dans 70 pays du monde, 370 millions de personnes appartenant à des populations dites "indigènes" ont été soumises au même modèle que celui qui nous a été imposé à nous, majorités occidentales : l'onde de choc du récit pandémique a été mondiale. Les mesures d'isolement et d'éloignement des personnes pratiquant la socialité de groupe ont entraîné une fragilité et une dépendance accrues ; la violence de la gestion de la pandémie a accéléré la désorganisation des systèmes alimentaires et l'écrasement des médicaments locaux ; elle a provoqué la désorganisation des emplois (souvent constitués de services informels et personnels) et la difficulté de recevoir et de mettre à jour des informations culturellement appropriées et dans les langues locales ; elle a induit l'isolement et l'aliénation. Les disparités en matière de santé liées à la race, au statut économique et à l'impact de la colonisation s'en trouvaient exacerbées, tandis que la "mauvaise surveillance" était exacerbée par des passages à tabac, des amendes excessives et des emprisonnements. L'attention des gouvernements n'étant focalisée que sur la pandémie, divers acteurs en ont profité pour mener des activités qui menacent de nombreuses populations, notamment la désinstitutionnalisation des réserves, l'occupation des terres indigènes, l'intensification des activités minières, les mauvais traitements infligés aux migrants et l'accaparement accru des terres.
Cependant, dans de nombreux endroits, les populations se sont auto-organisées et ont trouvé des solutions autonomes à la crise : de l'autoproduction d'équipements de protection à l'utilisation de remèdes médicinaux locaux pour renforcer l'immunité des individus et des communautés. Au Chiapas, la réponse à la pandémie a consisté en une déclaration d'alerte rouge de certaines communautés sous le commandement de l'Armée zapatiste de libération nationale, où personne ne pouvait entrer ni sortir, et où les personnes revenant dans leur communauté depuis les zones touristiques étaient obligées d'observer une période de quarantaine avant de rejoindre leur famille. Cependant, cela ne s'est pas traduit par une gestion individualisée de la maladie : aucun malade n'a été isolé chez lui, mais les médecins et les promoteurs de santé sont allés de maison en maison là où il y avait des signes de Covid-19. Les populations ont souvent résisté au simple transfert vers les hôpitaux "gouvernementaux". Des protocoles simples ont été construits et les diagnostics ont été établis sur une base clinique, c'est-à-dire à partir de l'étude des symptômes (les écouvillons ne sont disponibles à des prix exorbitants que dans les centres urbains éloignés). Les gens ont été traités à l'aide de médicaments facilement disponibles et abordables, sans pour autant nier la validité des traditions locales de guérison liées aux connaissances traditionnelles, à l'utilisation de plantes et à des rituels spécifiques.
Il est impossible de comprendre la méfiance actuelle à l'égard des campagnes de vaccination sans tenir compte des crimes très graves que les entreprises pharmaceutiques ont déjà commis à l'encontre des peuples autochtones. En 1996, Pfizer a testé un médicament antiméningite non homologué sur la population haoussa du Nigeria, tuant et rendant invalides des dizaines de garçons et de filles de la région. La réaction d'indignation collective face à cette infamie néolibérale, également documentée par les ethnographes (surtout locaux), a conduit au renforcement des protocoles de consentement éclairé qui font désormais partie des exigences éthiques scientifiques fondamentales. Ce n'est pas l'entreprise pharmaceutique, mais le débat public sur ses actions, qui a fait progresser la science. Les luttes pour l'accès universel à la santé doivent également tenir compte de cette méfiance justifiée à l'égard de la biomédecine dans les contextes colonisés : la revendication incontestable de libéraliser les brevets des vaccins afin de garantir un choix universel doit s'accompagner d'un rejet absolu des projets de vaccination de masse obligatoire dont l'Italie semble être le chef de file, afin de ne pas transformer une juste revendication d'égalité en une rhétorique qui légitime les mêmes pratiques économiques néocoloniales promues par des groupes de réflexion financés par les entreprises pharmaceutiques.
Appliqué à nos latitudes, un modèle non-violent de gestion de la pandémie aurait impliqué, au minimum, une communication médiatique basée sur la raison, le calme et l'information ; le renforcement des soins de santé locaux et, à travers eux, le test des protocoles de soins primaires contre le Covid-19 bien au-delà de l'"attente vigilante" encore recommandée aujourd'hui ; la liberté de choix thérapeutique ; l'évaluation de toutes les alternatives thérapeutiques sur la base de leur efficacité, et pas seulement in vitro ; la promotion des ressources de santé des individus et des groupes (amélioration de l'alimentation, promotion de l'activité physique, diffusion maximale des compétences de base en matière d'autothérapie, mise en place de réseaux de soutien et d'entraide) ; et, bien sûr, des mesures structurelles visant à promouvoir la construction d'écoles, les transports publics, la retraite anticipée et la réhabilitation de l'environnement.
La liberté de recherche et le rôle social de l'université
En Italie - le seul pays au monde - la liberté de recherche et l'enseignement universitaire sont également soumis au chantage de la vaccination obligatoire : celle-ci discipline le corps enseignant en éliminant des universités toute dissidence sur la gestion de la pandémie. L'alternative entre la prise d'un médicament ou la perte de son emploi suite à l'introduction du pass-vaccin met en jeu des questions fondamentales concernant la relation entre l'État et la société, entre les sphères publique et privée, entre les corps individuels et le corps social, entre le droit et la légitimité, entre la production de connaissances et l'exercice du pouvoir. Ce sont toutes des questions sur lesquelles l'anthropologie travaille depuis des décennies, et c'est précisément sur la base des connaissances accumulées par la discipline que nous nous sentons maintenant en droit, et donc en devoir, de prendre position.
Tout d'abord, au-delà de nos visions spécifiques et de nos décisions personnelles sur la question des vaccins, notre solidarité va à ceux qui, ces derniers mois, ont subi des pressions intolérables à cause de choix liés à leur santé, au point de se retrouver dans certains cas obligés de quitter leur travail ou leurs recherches (le libre choix du traitement, rappelons-le, est garanti par la Constitution italienne et également sanctionné par le Parlement européen). Pour une communauté scientifique qui repose presque entièrement sur le partage et la comparaison des résultats des recherches individuelles, la démission d'un collègue représente un dommage irréparable pour tous. Aucune justification épidémiologique ou d'urgence raisonnable ne peut compenser ces pertes et ces injustices. Nous pensons surtout que l'université doit réaffirmer son indépendance, en tant qu'institution, vis-à-vis des choix gouvernementaux ; pour le bien-être réel du tissu démocratique d'un pays, on ne peut pas promouvoir la loyauté forcée de toute sa classe intellectuelle. L'esprit critique, le doute, la confrontation et la dialectique sont l'essence de la démocratie, et sont indispensables au bien-être de tout corps social.
Pour cette raison, nous demandons à tous les collègues (à l'intérieur et à l'extérieur de l'université, structurés et précaires) qui sont prêts à discuter à partir des considérations exprimées ici de frapper un grand coup, d'échapper à la criminalisation de la dissidence qui nous paralyse et d'essayer d'appliquer à notre présent les outils sur lesquels nous nous sommes longtemps formés ailleurs.
Pour conclure, nous lançons un appel pour un séminaire ouvert sur ces questions, qui se tiendra au printemps. Nous demandons aux personnes intéressées par une contribution au débat, une expérience ou un exemple précis, d'envoyer un résumé de 200 mots et une courte notice biographique par courriel à contatti@tuttaunaltrastoria.info. Nous ferons bientôt connaître le lieu et la date du séminaire, qui aura lieu en mars ou avril 2022 et en Italie. Les thèmes que nous entendons aborder reprennent tous les points traités dans ce document.
Diverses régions d'Italie, 1er février 2022.
Stefano Boni
Nadia Breda
Maddalena Gretel Cammelli
Duccio Canestrini
Stefania Consigliere
Osvaldo Costantini
Mimmo Perrotta
Stefano Portelli
Cecilia Vergnano
Cristina Zavaroni
http://tuttaunaltrastoria.info/