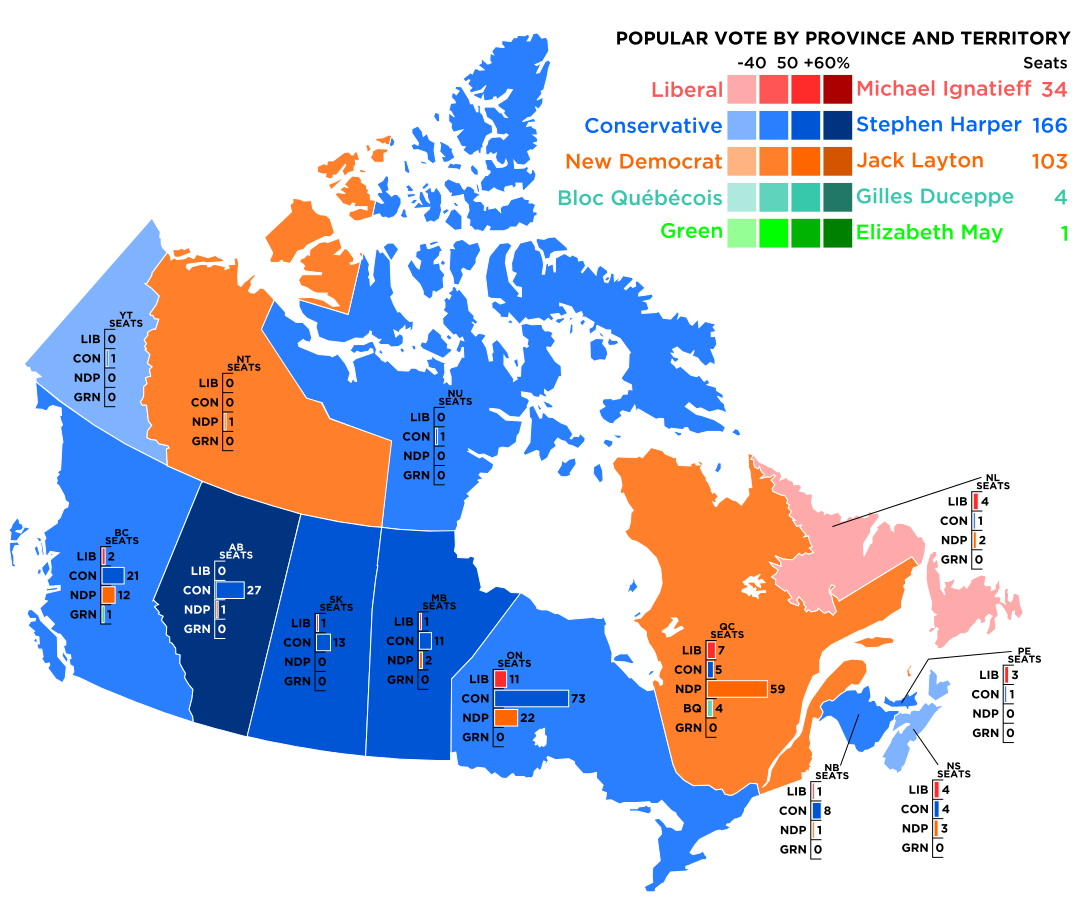Partie II : pour une gauche multiscalaire
La création d’une alternative politique à
l’échelle pancanadienne, ou plutôt transcanadienne,
suppose un double mouvement théorique : une remise en question de la
forme parti, puis une nouvelle articulation entre la question nationale et
internationale. Sur le plan pratique, il serait absurde de vouloir créer une
autre organisation politique traditionnelle et verticale qui devrait unifier,
par le haut, les multiples revendications et idéologies des mouvements sociaux
inscrites dans des cultures et des contextes socioéconomiques fort différents.
Ainsi, une réflexion sérieuse sur les modalités d’organisation qui dépassent le
cadre national amène une transformation de notre manière d’envisager l’action
politique, qui pourrait ensuite se concrétiser à plusieurs niveaux. Il est
temps pour la gauche de penser en géographe, c’est-à-dire d’adopter une
démarche multiscalaire qui a pour fonction de comprendre la construction et l’aménagement d’un territoire en l’étudiant à
différentes échelles : mondiale, continentale, fédérale, nationale,
régionale et locale.
Cette nouvelle perspective, qui opère un
décentrement de la gauche par rapport au foyer national, sans y renoncer pour
autant, doit également prendre acte de l’épuisement de la forme parti qui devra
devenir plus expérimentale et flexible pour reprendre vie. La crise du
parlementarisme, qui amène avec elle l’affaiblissement de la démocratie
représentative et le rejet des partis politiques, ne devrait pas être attribuée
uniquement à des facteurs idéologiques et économiques extérieurs : les
institutions elles-mêmes, par leur corruption, suscitent une méfiance
croissante de la population. Il ne faut pas pour autant entrer dans la logique du
populisme conservateur qui attribue tous les problèmes sociaux à l’État obèse
et appelle à son démantèlement pour préserver la liberté individuelle, ni
tomber dans le piège inverse qui consiste à défendre la classe politique
et nier les problèmes de centralisation et de bureaucratisation. Il faut saisir
l’élément de « bon sens » dans la conscience populaire, et l’amener à
transformer le système qui l’opprime en l’attachant aux réformes radicales qui
pourront réaliser ses aspirations.
Critique de l’antipartisme
L’« antipartisme » du sens commun
est très bien exprimée dans le dernier ouvrage de Roméo Bouchard, Constituer le Québec. Pistes de solution
pour une véritable démocratie (2014). Celui-ci mène une critique radicale,
voire un peu réductrice, du système des partis qui étouffe la vie démocratique.
« Notre système politique repose sur des partis qui se battent entre eux
pour le pouvoir. En principe, ils sont censés permettre l’expression de la
diversité des attentes de la population par rapport à son gouvernement; dans
les faits, ce sont des machines de guerre dont l’objectif premier est de
permettre à un groupe de s’emparer du pouvoir. Intermédiaires quasi obligés
entre le citoyen et ses institutions démocratiques, les partis politiques sont
les grands responsables du détournement de notre démocratie et de l’usurpation
du pouvoir par les groupes d’intérêts privés. »[1]
Roméo Bouchard met en évidence les nombreux
problèmes qui affectent ce type d’organisation, de manière structurelle et non
seulement occasionnelle : proximité entre les partis et l’argent
(collecteurs de fonds, collusion), ligne de parti, dictature de l’image,
absence de vision, électoralisme, etc. Si son analyse s’applique très bien au
fonctionnement des grands partis, son
propos oscille constamment entre une thèse forte qui souhaite une éventuelle
abolition des partis politiques comme tels, puis une thèse faible qui rejette
simplement leur monopole sur la vie démocratique : « Entendons-nous
bien: il ne s’agit pas d’empêcher des groupes politiques d’exister ni de contribuer
à la réflexion et à l’action politique. L’essentiel, c’est d’éviter qu’ils
soient les intermédiaires exclusifs entre les citoyens et leurs représentants
au Parlement. »[2]
D’un point de vue sociologique, il faut
privilégier la thèse faible car le système partitaire est non pas la cause première du détournement de la
démocratie, mais un facteur de détérioration parmi d’autres ; la crise de
légitimité des partis est plutôt l’effet
d’une corruption démocratique, issue de la double contrainte du capitalisme et
du parlementarisme. On peut à juste titre critiquer l’emprise des riches sur la
démocratie (oligarchie, capitalo-parlementarisme), et proposer d’introduire des
mécanismes de tirage au sort et de démocratie directe, la création d’une
assemblée constituante, le développement d’une économie citoyenne et
d’institutions à l’aune du principe de proximité ; mais toutes ces
réformes radicales ne sauraient être introduites sans une transformation de
l’État, et donc la conquête du pouvoir politique.
Tel est le paradoxe du livre Constituer
le Québec : pour établir un monde sans partis et délivré du monopole
de l’aristocratie élective (gouvernement représentatif), il faut encore un
parti en tant que « véhicule politique » et « outil de
transformation sociale ». La critique de l’idéologie du parti, essentielle
pour lutter contre la concentration du pouvoir, ne parvient pas pour autant à
éliminer le parti en tant que « nécessité pratique », c’est-à-dire comme moyen de
parvenir à instituer une société réellement démocratique.
Toute la question réside dans la forme
que doit prendre ce parti pour minimiser ses effets pervers. Celui-ci peut
exister sans pour autant verser dans une logique électoraliste et
parlementariste ; il n’est pas vrai que tous les partis sont également
anti-démocratiques. Néanmoins, il faut reconnaître qu’aucun parti n’est à
l’abri de la bureaucratisation. Si la « loi d’airain » de
l’oligarchie[3]
s’applique à toute organisation, citoyenne, municipale, syndicale, partisane ou
étatique, le seul mécanisme pour contrer cette « tendance lourde »
réside dans la démocratie interne des organisations, qui n’est jamais acquise.
S’il est possible de fonder une ville ou un État sur les principes de la
démocratie participative, pourquoi un parti ne le pourrait-il pas ?
Deux concepts de parti
Pour approfondir la réflexion sur les
formes possibles d’organisation politique, l’analyse originale d’Antonio
Gramsci permet de distinguer deux significations du concept de parti :
« 1) Le parti en tant qu’organisation pratique (ou tendance pratique),
comme instrument pour résoudre un problème ou un groupe de problèmes de la vie
nationale et internationale. […] 2) Le parti en tant qu’idéologie générale,
supérieure aux divers groupements plus immédiats. »[4] Pour
illustrer cette différence, prenons pour exemple Québec solidaire qui
correspond à la première signification du parti. Cette « organisation
pratique » qui a pour fonction de prendre le pouvoir afin de résoudre un
groupe de problèmes à l’échelle du Québec, constitue un regroupement parmi une
foule d’organisations comme l’Institut de recherche et d’information
socio-économique (IRIS), la Fédération des femmes du Québec, la coopérative
Molotov Communication, le réseau Alternatives, etc., qui forment ensemble un
vaste réseau organique au sein de la société civile, un grand « parti
idéologique ».
Le parti politique, au sens étroit du terme
(1), possède un caractère ambivalent qui provient de sa double nature ; il
est à la fois contraignant et créateur. Sur le plan négatif, Gramsci note
qu’ « il est difficile d’exclure qu’un parti politique quel qu’il
soit (des groupes dominants mais aussi des groupes subalternes) ne remplisse
aussi une fonction policière, c’est-à-dire de tutelle d’un certain ordre
politique et légal. Si cela était démontré formellement, il faudrait poser la
question en d’autres termes : à savoir, de quelle façon et dans quelle
direction une telle fonction s’exerce. Est-ce un sens répressif ou expansif,
c’est-à-dire de caractère réactionnaire ou progressiste ? […] Quand le
parti est progressiste, il fonctionne « démocratiquement » (au sens
d’un centralisme démocratique), quand le parti est régressif, il fonctionne
« bureaucratiquement » (au sens d’un centralisme bureaucratique).
Dans ce dernier cas le parti est un pur exécutant, non délibérant : il est
alors techniquement un organe policier, et son nom de parti politique est une
pure métaphore de caractère mythologique. »[5]
Cette remarque montre qu’un mode
d’organisation basé sur la démocratie participative et délibérative représente
le seul moyen de lutter contre la tendance au parti politique à se transformer
en police politique. Il faut être conscient de cette dérive potentielle et
rester vigilant, non pas tant via l’observation méticuleuse des règles
d’organisation interne (attitude qui peut elle-même aggraver le
« procéduralisme », étouffer le débat, accélérer la
professionnalisation politique, la séparation de la base et de la direction, et
donc la bureaucratisation), mais par un fonctionnement ouvert, inclusif,
collaboratif, le développement de nouvelles pratiques discursives et
militantes, bref des formes de discussion et de décision qui limitent les
asymétries structurelles de pouvoir. De plus, l’innovation politique dans la
forme organisationnelle pourra elle-même libérer le potentiel créateur du
« parti idéologique », en tant qu’incubateur d’idées et de nouvelles
valeurs.
« Il faut mettre en relief
l’importance et la signification que revêtent dans le monde moderne les partis
politiques quand à l’élaboration et à la diffusion des conceptions du monde,
dans la mesure où ils élaborent pour l’essentiel l’éthique et la politique qui
sont conformes à celles-ci, c’est-à-dire où ils fonctionnent pour ainsi dire
comme des « expérimentateurs » historiques de ces conceptions. Les
partis sélectionnent individuellement la masse agissante, et la sélection se
produit aussi bien dans le champ pratique que dans le champ théorique, avec un
rapport d’autant plus étroit entre théorie et pratique que la conception est
plus vitalement et plus radicalement innovatrice et en lutte avec les vieilles
façons de penser. C’est pourquoi on peut dire que les partis sont les
élaborateurs des intellectualités nouvelles et intégrales, autrement dit le
creuset de l’unification de la théorie et de la pratique entendue comme procès
historique réel. »[6]
De la contradiction politique
au web 2.0
Si
l’activité créatrice du parti se mesure dans sa capacité à sélectionner de
nouveaux éléments par un projet politique en lutte avec les vieilles façons de
penser, sa vision du monde doit elle-même correspondre à de nouvelles pratiques
qui dépassent les vieilles façons de s’organiser. Ce qui est frappant de nos
jours, ce n’est pas tant la fameuse contradiction
économique relevée par Marx entre les rapports de production (capital) et
le développement des forces productives (travail), c’est la contradiction politique entre les
anciens modes d’organisation dérivés des institutions étatiques héritées de la modernité,
et le déploiement de forces politiques émergentes qui sont elles-mêmes liées au
développement des nouvelles technologies. Sans sombrer dans un matérialisme
vulgaire, il est important de constater le contraste énorme entre la forme
archaïque du gouvernement représentatif et le modèle désuet du parti sur
lequel il est calqué, et les capacités énormes dont nous disposons pour créer
de nouveaux rapports socio-politiques, comme l’illustre bien Roméo
Bouchard :
« Ce
qui est en cause avant tout, c’est la capacité de notre démocratie dite représentative
à exprimer la souveraineté du peuple, à produire un gouvernement du peuple,
par le peuple et pour le peuple. Malgré le développement extraordinaire des
moyens de communication, nos institutions démocratiques font très peu de place
à la participation directe et permanente des citoyens aux décisions. À l’heure
où le monde est branché sur son téléphone intelligent, l’Assemblée nationale et
la Chambre des communes perpétuent des rituels datant du Moyen Âge. »[7]
En
explorant la dialectique du développement technique et politique, nous pouvons
faire un parallèle avec l’évolution du web. Dans sa première phase de
développement (années 1990), le flux d’informations demeure largement top-down ; chaque organisation crée
son site web afin de faire connaître son existence et ses produits sur le
« marché virtuel » que constitue la toile. Les interactions entre les
individus et les organisations sont essentiellement limitées à la recherche en
ligne et au commerce, même si des rapports horizontaux peuvent se créer via des
espaces privés (courrier électronique, messagerie instantanée) ou publics
(forums de discussion). Or, l’arrivée du web 2.0 popularisa des interfaces où
les internautes ayant peu de connaissances techniques pouvaient alors
s’approprier de nouvelles fonctionnalités du web. Cette deuxième phase de
développement, basée sur le partage et la collaboration, se caractérise
notamment par la création de contenus variés : l’usager ordinaire passe du
statut de simple consommateur d’information à celui de producteur d’idées,
d’images, de vidéos, etc.
Le
développement de blogs, de wikis, de réseaux sociaux et de nouveaux logiciels
d’échanges permet aux individus et aux groupes de s’organiser, de partager des
savoir-faire, de convoquer des événements, etc. Le web 2.0 représente donc une
évolution vers l’interactivité, où la complexification interne de la
technologie numérique permet paradoxalement la simplification de l’usage des
outils, les connaissances relatives à la programmation n’étant plus essentielles aux
internautes pour assurer une activité créatrice. Bien que la concentration du
pouvoir informatique par les firmes multinationales, la guerre sur la propriété
intellectuelle et la surveillance généralisée des États impérialistes rend plus
actuelle que jamais la « lutte des classes dans le cyberespace », il
n’en demeure pas moins que le web 2.0 contribue également, au moins
tendanciellement, à la socialisation et à la démocratisation des moyens de
production intellectuelle.
Le risque de la pseudo-démocratisation
Pour
revenir à la sphère politique et au rôle des partis, il est important de
remarquer que la plupart d’entre eux ont emprunté le virage numérique sans pour
autant explorer toutes les possibilités du web 2.0. Cette tendance se
manifestera tôt où tard, même si la manière d’effectuer cette transition sera
plus ou moins démocratique selon les cas. Tout dépend de la remise en question
des rapports de pouvoir à l’intérieur de l’organisation, qui déterminera si
l’usage de la collaboration implique la modification de la structure même du parti, ou si elle cherche plutôt à compenser une crise de légitimité et de représentation par une plus
grande « inclusion » des membres en période de crise. On peut
anticiper que ce sera cette forme bâtarde de modernisation qui prévaudra la
majorité du temps, surtout pour les grands partis accrochés à de vieilles
conceptions du monde. Voici un exemple :
« Le
Parti québécois doit se moderniser en permettant à tout militant de soumettre
ses idées directement à la Commission politique du parti sans passer par les
associations locales. C’est ce que soutient le député de Lac-Saint-Jean,
Alexandre Cloutier, qui voit là une façon de stimuler l’engagement des
militants, en particulier des jeunes. « C’est un peu sur le modèle de
l’iPhone. N’importe qui a envie de créer peut le faire », a-t-il
comparé dans une entrevue accordée au Devoir. « Force est de
constater qu’au fil des ans, le militantisme a évolué », estime
Alexandre Cloutier. « On n’est plus à une époque où les gens ont
nécessairement envie de se faire élire dans des exécutifs locaux ou régionaux
pour pouvoir participer directement à la vie démocratique du parti ou pouvoir
proposer des idées. » Le passage obligé des propositions par le filtre
des associations de circonscription, puis par celui des associations
régionales, avant qu’elles aboutissent à l’exécutif national est un long
processus qui freine l’initiative, croit le député. »[8]
Si
cette petite réforme n’est pas mauvaise en soi, elle ne pourra pas renverser la
bureaucratisation inhérente à une organisation contrôlée par des politicien.nes
professionnels. De plus, la réflexion collective ouverte momentanément par le
départ de Marois sera refermée dès l’élection d’une nouvelle tête dirigeante,
car la forme du parti qui vise d’abord à bien gouverner doit être moulée aux
institutions parlementaires britanniques qui donnent au premier ministre un
rôle central. C’est pourquoi il faut éviter de considérer le potentiel
libérateur du web par rapport au système politique de manière univoque et
abstraite, c’est-à-dire comme un phénomène isolé d’un contexte plus large
traversé par de multiples rapports de pouvoir.
Par
ailleurs, l’usage actif des réseaux sociaux par Option nationale témoigne déjà
d’une adhésion plus naturelle et spontanée de l’idéologie souverainiste aux
nouvelles capacités technologiques, bien qu’une contradiction partielle demeure
entre une ancienne vision du monde et les nouveaux moyens de la diffuser. Il
faut certes reconnaître que Jean-Martin Aussant a eu l’intelligence
d’actualiser l’idée d’indépendance en l’adaptant au langage « cool »
du web et au « format clip », le vidéo youtube de Catherine Dorion
ayant fait des ravages lors de l’élection 2012. Cet ajustement du discours
politique à l’air du temps explique d’ailleurs la forte et rapide popularité
d’ON auprès de la nouvelle génération de souverainistes, que le parti a lui-même
créée par son existence et son activité militante.
Mais la structure traditionnelle du parti,
centré d’abord sur le pouvoir charismatique du chef et quelques arguments
simples, a rapidement montré les limites d’ON et du discours souverainiste qui
attend à être réellement renouvelé. Le web 2.0 a été d’abord utilisé comme un
moyen de propagande sur les réseaux sociaux, et non comme une forme
radicalement nouvelle d’organisation du parti. Le style est essentiel en politique,
mais l’absence d’une vision du monde, de nouvelles valeurs et d’un véritable
projet de société marque une certaine immaturité politique. Tout se passe comme
si l’idéologie de ce parti n’était pas à la hauteur des moyens techniques de la
nouvelle génération indépendantiste et du public qu’il a créé.
La remarque inverse vaut probablement pour
Québec solidaire : la forme du
parti, son style et son mode d’organisation, n’a pas encore atteint le
potentiel de son contenu, c'est-à-dire de son
projet politique. Le projet de transformation sociale de la gauche doit prendre
acte du potentiel de transformation des méthodes d’organisation qui l’ont
jusqu’ici structurée, afin que le véhicule politique soit lui-même
annonciateur de la société à venir. Comme l’affirme Marshall McLuhan, « le message,
c’est le médium ». Quels sont les nouveaux médias politiques, apparus
récemment sur la scène internationale, qui pourraient servir de sources
d’inspiration pour le contexte québécois et canadien ?
À suivre.
À suivre.
[1] Roméo Bouchard, Constituer le Québec. Pistes de solution pour une véritable démocratie,
Atelier 10, Montréal, 2014, p.40
[2] Ibid., p.45-46
[3] Robert Michels, Les Partis politiques. Essai
sur les tendances oligarchiques de la démocratie, Flammarion, Paris, 1914.
https://archive.org/details/lespartispolitiq00michuoft
[4] Antonio Gramsci, Guerre de mouvement et guerre de position, La Fabrique, Paris,
2011, p.84-85
[5] Ibid., p.238
[6] Ibid., p.115
[7] Roméo Bouchard, Constituer le Québec, p.23
[8] Robert
Dutrizac, Alexandre Cloutier propose un
accès direct au parti pour les militants, Le Devoir, 23 juin 2014