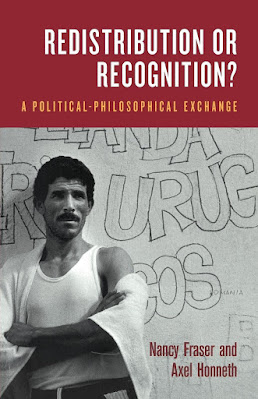Depuis quelques temps, la querelle sur les « wokes » bat son plein dans l’espace public. D’un côté, la droite s’en donne à cœur joie pour discréditer, diaboliser et trainer dans la boue les fameux « wokes » qui incarneraient la menace « totalitaire » de l’« Empire du politiquement correct ». En réponse, cette soi-disant « gauche diversitaire » multiplie les prises de parole pour dénoncer les systèmes d’oppression dans les universités, les milieux culturels et autres sphères de pouvoir, via un nouvel arsenal théorique, critique et militant composé de notions comme intersectionnalité, positionnalité, privilèges, savoirs hégémoniques, fragilité blanche, etc.
Loin de faire l’unanimité au sein de la gauche, les débats fusent dans les milieux libertaire, féministe, antiraciste, socialiste, indépendantiste et solidaire. Certaines figures de la gauche anticapitaliste comme Marc-André Cyr et Pierre Mouterde formulent une critique féroce de la « gauche postmoderne » et des impasses de la « rectitude politique », en appelant à délaisser l’obsession pour les « identités » particulières au profit de l’« universalisme » et d’une réhabilitation de la lutte de classes comme foyer de convergence politique. Cela ne va pas sans susciter des réactions en chaîne, comme en témoigne le dernier texte de Mouterde sur la « chasse aux sorcières » contre les wokes, lequel a généré deux répliques cinglantes de Francis Dupuis-Déri et Rosa Pires sur le média Presse-toi à gauche.
Ces débats sur la « question identitaire », loin d’être nouveaux, ont été récemment réactivés suite aux controverses sur le « mot en n », la liberté académique, la cancel culture, de même que la dénonciation de la « pensée postcoloniale » et de « l’islamo-gauchisme » dans le milieu universitaire. Comme les raccourcis, amalgames, dénonciations à l’emporte-pièce, insultes et accusations ad hominem sont devenus la norme aussitôt qu’on souhaite aborder ces enjeux, plusieurs préfèrent garder une saine distance et éviter de se lancer dans la mêlée de peur de se faire envoyer paître sur les médias (a)sociaux. Outre cette judicieuse prudence qui permet de préserver un minimum de santé mentale – mise à mal par la pandémie et le climat toxique qui règne dans plusieurs milieux militants –, je crois qu’il est nécessaire, malgré tout, d’avancer certaines réflexions sur ces épineuses questions.
Tout d’abord, pour dépasser l’opposition entre la « gauche identitaire » et la « gauche universaliste » centrée sur la lutte des classes, il est primordial de dégager une troisième position : celle d’une « gauche synthétique » capable de fédérer les multiples luttes pour l’émancipation. Pour ce faire, nous devons d’abord présenter et critiquer les deux principales visions qui se font entendre aujourd’hui. La première conception, axée sur les luttes pour la reconnaissance et les injustices dans la sphère culturelle, a tendance à négliger les enjeux d’économie politique et les rapports de classe. La seconde vision, centrée sur les luttes pour la redistribution, a tendance à considérer les luttes contre le racisme, le sexisme et le colonialisme comme des combats « identitaires » et « culturels », et donc des luttes « minoritaires » à reléguer au second rang. Nous souhaitons montrer que ces deux perspectives, si elles renferment une part de vérité, demeurent largement insuffisantes; elles doivent ainsi être critiquées et dépassées par une stratégie politique capable d’articuler une dialectique entre « commun » et « différences », combinant la critique impitoyable des systèmes d’oppression et les nécessaires alliances pour renverser le capitalisme.
Cette complexe articulation, qui représente sans doute la « quadrature du cercle » des discussions de la gauche contemporaine, sera donc l’objet du présent texte qui vise à esquisser une voie pour sortir des impasses actuelles.
Marxisme vulgaire, gauche identitaire, même combat
Disons d’emblée que chaque grande théorie critique comporte ses versions simplifiées, caricaturales et « vulgaires ». Il en va ainsi pour la pensée de Marx, qui a d’ailleurs affirmé jadis « je ne suis par marxiste » pour se distinguer des interprétations douteuses de sa philosophie qui se réclamaient de son nom à son époque. Il en va de même pour les perspectives intersectionnelles mainstream qui génèrent leur lot d’interprétations dogmatiques dans les milieux militants aujourd’hui. Avant de rentrer dans la critique de « l’intersectionnalité vulgaire », commençons par signaler que plusieurs choses qui sont reprochées à la gauche « woke », « diversitaire » ou « identitaire » – notamment son moralisme, son dogmatisme et son sectarisme –, ne sont pas le simple résultat d’une mauvaise théorie ou idéologie, qu’elle soit postcoloniale, postmoderne, intersectionnelle ou autre. Les principales dérives dénoncées renvoient plutôt à la forme particulière de certaines pratiques militantes, issues d’une application doctrinaire et rigide de principes érigés en vérités absolues.
Pour donner un exemple concret des dérives moralisatrices et dogmatiques qui menacent la gauche radicale, peu importe l’époque et l’idéologie dont certains groupes se réclament, il est intéressant d’aborder le bilan critique des expériences militantes des années 1970. Le principal fondateur et intellectuel de l’organisation En lutte!, Charles Gagnon, a fait un retour critique sur les dernières années de ce parti politique marxiste-léniniste qui a vécu plusieurs tensions internes avant de se dissoudre en 1982. Dans son livre posthume À la croisée des siècles. Réflexions sur la gauche québécoise (Écosociété, 2015), Gagnon décrit certaines pratiques qui avaient cours dans son parti à l’époque. Je le cite longuement ici, car les plusieurs phénomènes qu’il décrit se retrouvent encore aujourd’hui sous la bannière de nouvelles théories critiques en vogue.
« Tout comme la plupart des autres organisations de l’époque, En lutte! s’est progressivement transformée en un petit monde fermé sur lui-même, qui aspirait à préfigurer lui-même la société socialiste envisagée, un monde d’où devaient donc être bannies toutes les inégalités, sinon toutes les différences : entre les femmes et les femmes, entre les intellectuels et les manuels, entre les salariés et les sans-emploi, etc. […] Le souci démocratique d’En lutte! s’était progressivement enrichi de ce que j’appellerais son « moralisme primaire », sorte de puritanisme politique. Ce moralisme, presque inconcevable avec le recul du temps, était alors qualifié de « morale prolétarienne »; il avait pris forme par touches successives, de façon pratiquement insensible, inconsciente, sur la base de la conviction, pour le moins paradoxale, que l’organisation communiste doit vivre comme on vivrait sous le socialisme, dans la recherche constante, sur tous les plans, de l’égalité la plus poussée possible. […]
Cette propension à la morale dogmatique et sectaire avait donc fini par prendre beaucoup de place dans la plupart des organisations militantes de l’époque, subrepticement si on peut dire. L’appartenance à En lutte!, par exemple, avait atteint un tel niveau d’exigences diverses que, même sans les problèmes idéologiques évoqués antérieurement, son éclatement était sans doute inévitable. On imagine mal, quand on y baigne, combien la défense et la promotion d’une morale sociale et individuelle élevée peuvent générer des excès, des dérives inacceptables. Cela commence par l’étroitesse de vue : tout est traité selon des principes rigides, des formules dont sont bannies toutes les nuances, toutes les particularités. Cela débouche rapidement sur l’intolérance : tous les comportements « déviants » sont condamnés sans appel… Bref, c’est le triomphe du dogmatisme, le déferlement des accusations d’ouvriérisme, d’intellectualisme, d’opportunisme, de révisionnisme; c’est la voie royale vers le sectarisme. Parti à la conquête des masses qu’il s’agissait d’abord de convaincre […], voilà qu’on apprend à penser à penser et à agir suivant des principes de plus en plus rigoureux, rigides, qui s’imposent impérativement à soi et qu’on finit par chercher à imposer aux autres. […]
Par ailleurs, même s’il existe un lien évident entre la ligne politique marxiste-léniniste puis le dogmatisme et le sectarisme qui ont marqué à divers degrés toutes les organisations qui s’en réclamaient au cours des années 1970, l’affirmation suivant laquelle il s’agit là d’un phénomène singulier, propre au marxisme, d’une dérive inévitable qui lui soit liée, ne tient tout simplement pas. Bien des marxistes ne sont jamais tombés dans ces travers, d’une part. D’autre part, dogmatisme et sectarisme se sont allègrement retrouvés, et se retrouvent encore aujourd’hui, dans d’autres courants idéologiques que le marxisme. Cela n’est pas une excuse, mais permet d’éviter les condamnations simplistes qu’on entend trop souvent. »[1]
De nos jours, les comportements et propos « déviants » sont qualifiés de « problématiques » pour mieux écarter certaines personnes qui ne respectent pas les codes moraux en vigueur dans les milieux militants. Les accusations quelque peu démodées d’ouvriérisme, d’intellectualisme et d’opportunisme ont été remplacées par celles d’« hommes blancs cis », « femmes blanches privilégiées », « suprématistes », ou tout simplement de « dominants » qui devraient se « taire » ou « step back » pour s’auto-éduquer et déconstruire ses privilèges. Lorsque des personnes émettent certaines réserves à l’endroit de certains comportements agressifs de leurs camarades, on les accuse rapidement de faire du tone policing ou du gaslighting pour mieux s’immuniser contre la critique. Bref, les accusations entre camarades sur la base des privilèges relatifs en matière d’origine sexuelle, raciale ou autres prennent le relais des accusations sur la base des « privilèges de classe » qui étaient la norme dans les milieux marxistes de l’époque.
L’essentialisation de la positionnalité
Dans les deux cas, c’est la position sociale des interlocuteurs qui est pointée du doigt, non pas pour situer sa propre perspective de façon réfléchie et mieux entrer en débat sur les meilleurs moyens d’agir en fonction de nos regards différents sur le monde (ce qu’on appelle « point de vue situé » ou « positionnalité bien comprise »), mais pour délégitimer les propos d’autrui sur la base d’une positionnalité simplifiée, c’est-à-dire en réduisant l’autre à une catégorie sociale homogène qui invalide d’emblée sa perspective parce qu’elle appartiendrait à celle du « groupe dominant ».
Notons d’emblée que ce phénomène n’est pas propre à la « gauche identitaire » contemporaine, car la théorie critique et la pensée marxiste elle-même ont constamment rappelé que les « idées » ne viennent pas de nulle part; elles sont ancrées dans une réalité sociale dont elles reflètent en partie les intérêts. Marx disait ainsi : « ce n’est pas la conscience des hommes qui détermine leur existence, c’est au contraire leur existence sociale qui détermine leur conscience ». L’existence sociale se comprenait pour lui comme la position d’un individu ou d’un groupe au sein de rapports sociaux de production (et donc son appartenance de classe). Mais cette maxime vaut pour l’ensemble des rapports sociaux de genre, de « race » et autres, c’est-à-dire chaque fois qu’il y a des relations de domination au sein d’un système d’oppression spécifique qui différencie deux groupes aux intérêts antagonistes.
Dans son livre La Révolution féministe, Aurore Koechlin élabore sa critique de la « stratégie intersectionnelle » à partir d’une analyse de ce phénomène d’essentialisation des catégories sociales, « stratégie » qu’elle distingue bien des « théories intersectionnelles » qui ont représentées de réelles avancées en termes d’analyse des relations de domination. « La stratégie intersectionnelle est le fruit d’une adaptation politique en France dans les années 2000 et 2010 de l’intersectionnalité théorisée dans le milieu universitaire états-unien des années 1990. Cette greffe déforme parfois la théorie de l’intersectionnalité originelle. […] La première tâche est de caractériser cette stratégie et de voir en quoi, malgré des intuitions justes, elle demeure insuffisante. Surtout, certaines de ses dérives, qui ne sont pas systématiques et, il est important de le préciser, ne concerne pas l’ensemble du mouvement intersectionnel, peuvent devenir assez dangereuses pour le féminisme tout court. Néanmoins, je me positionne ici en dialogue avec les personnes qui se connaissent dans cette stratégie, parce que, sur beaucoup de points, nous avons des accords et parce que je viens moi-même de cette tradition politique. Je m’appuierais essentiellement sur ma propre expérience du milieu intersectionnel parisien de la première moitié des années 2010 pour développer mon argumentation. »[2]
Koechlin propose ainsi une « critique interne » de certaines pratiques se réclamant de l’intersectionnalité, avec un point de vue situé qui n’identifie pas certaines dérives avec une théorie monolithique qu’elle répudierait en bloc. « Il ne s’agit pas de faire le procès de l’intersectionnalité militante, mais d’interroger une certaine compréhension militante de l’intersectionnalité. » Il faut donc distinguer ce genre de critiques internes, formulées par des personnes se situant dans une certaine tradition militante, et faisant un retour réflexif sur celle-ci pour mieux mettre en relief ses angles morts, des « critiques externes » beaucoup plus grossières et basées sur une vision du monde complètement différente, qui rejetterait d’emblée tout élément se rapprochant de près ou de loin de cette « idéologie ».
Le principal problème de la « stratégie intersectionnelle », que nous qualifions pour notre part de « gauche identitaire », vient d’une certaine conception rigide des catégories sociales et des privilèges épistémiques qui découlent de celles-ci. Pour le dire autrement, le problème ne vient pas de notions comme « oppressions », « positionnalité », « expérience vécue » et d’autres éléments visant à valoriser la perspective des personnes concernées, mais d’une compréhension morale, individualisante et essentialisante de ces catégories. Nous citerons ici longuement la description des pratiques d’essentialisation qui découlent d’une application mécanique de l’analyse intersectionnelle.
« L’idée centrale est qu’il existe dans la société de multiples rapports d’oppression. Chacun de ces rapports est entièrement autonome des autres, également important, incommensurable et total. Chacun de ces rapports d’oppression définit une opposition nette entre dominant·e·s et dominé·e·s, coupure qui joue comme une sorte de ligne de démarcation sociale. […] Les dominant·e·s tirent de leur position dans les rapports d’oppression un certain nombre d’avantages, qui sont appelés « privilèges » et qui peuvent être de nature variée. […] La notion de privilège, imputant aux individus la responsabilité des structures, possède une connotation morale. Les privilèges effacent la structure : la question, c’est d’avoir des privilèges ou pas. […] En outre, selon cette vision, les dominé·e·s, du fait de leur position de dominé·e·s, sont les seul·e·s à avoir accès à la vérité de leur oppression. Parce que leur position sociale leur fait expérimenter la domination, elles et ils sont les seul·e·s à avoir la vérité de cette oppression et les moyens de s’en libérer. Dès lors, les dominant·e·s ne peuvent que les écouter et les soutenir. C’est ainsi qu’on définition la position de « bon·ne·s allié·e·s » : ils et elles doivent se mettre à la disposition des dominé·e·s, les suivre et œuvrer à être moins dominant·e·s en déconstruisant leurs pratiques et leur langage marqués par la domination. […]
La réception française de l’intersectionnalité repose sur la notion d’identité. En transposant la théorie à la pratique, elle a perdu les bases matérielles de l’oppression, qui étaient le plus souvent présentes chez les penseuses du black feminism. Il ne s’agit dès lors plus de combattre les dominations à un niveau structurel, mais à un niveau purement individuel : […] cela implique une sorte de réduction des structures aux individus, d’individualisation des rapports de domination. […] En conséquence, l’émancipation est conçue comme une émancipation individuelle. C’est la fin des grands mouvements collectifs, dans le cadre d’un néolibéralisme triomphant où disparaît l’espoir d’une transformation totale de la société. On n’essaiera pas de changer le système mais de changer, un par un, les individus qui le composent. Effort épuisant, infini et malheureusement vain. […]
Il en résulte une conséquence aussi regrettable qu’inattendue, venant d’une théorie féministe : le retour à une forme d’essentialisation des positions sociales. Les individus sont rangés en deux catégories essentialisées, celle de dominant·e et celle de dominé·e. S’il y a une certaine porosité entre ces deux catégories (du moins dans un sens : on peut ainsi facilement passer de la catégorie de dominé·e à celle de dominant·e), il n’y a pas d’intermédiaire entre les deux […]. Et quand un·e dominé·e bascule dans la catégorie de dominant·e, on relit son identité entière à travers ce prisme. […] Ces positions sociales essentialisées finissent par constituer des catégories dans lesquelles on range les gens, les individus devenant des types. On « est » alors là où l’on se situe socialement. Ce qui manque à cette typologie géographique, c’est la dynamique des rapports sociaux : les catégories sociales ne sont ni fixes, ni immuables. Surtout, elles interagissent entre elles et se recomposent mutuellement, notamment sous la pression de l’histoire. […] Comme on n’analyse plus les bases économiques, politiques, sociologiques, structurelles des dominations, mais qu’on ne les pense qu’en termes de « privilèges », c’est-à-dire très exactement de symptômes individualisés d’un surtout global (certains individus ont des privilèges que d’autres non pas), il n’est pas rare que de ce cette analyse découle une moralisation de la politique et une culpabilisation des individus. […]
Cette situation est alors particulièrement propice à des phénomènes d’emprise de certaines personnes sur d’autres : l’espace « safe » se réduisant de plus en plus, les personnes commettant des faux pas étant impitoyablement exclues, le groupe devient de plus en plus petit, de plus en plus radical, comme une secte. Le niveau de contrôle de soi, de peur de dire le mauvais mot, de faire le mauvais geste, devient immense. […] Cette approche débouche logiquement une politique de la purification, fondée, nous l’avons vu, sur la construction d’espaces « safe », mais aussi sur le call-out, qui consiste à mettre en place une tactique de l’interpellation permanente, c’est-à-dire à reprendre, à rappeler à l’ordre toute personne qui fera ou dira quelque chose de « problématique » politiquement, autrement dit qui reproduira la domination. […] L’action politique est ainsi souvent réduite à une action sur le langage. Comme si l’on vivait les « révolutions dans l’ordre des mots comme des révolutions radicales dans l’ordre des choses. ». Il faut interroger l’efficacité d’une telle méthode, car empêcher de dire n’est pas empêcher de penser. […] Cela ne veut pas dire que le langage n’est pas un enjeu politique : les mots sont importants, qui portent et reproduisent l’idéologie de la domination, et une lutte spécifique doit leur être consacrée (par exemple, par la féminisation du langage, par l’arrêt de l’utilisation d’insultes à caractère LGBTIphobe, raciste, sexiste, etc.). Mais cela ne doit pas être le combat central, voire unique. […]
L’autre déformation, importante par son influence sur les pratiques militantes, est le passage d’une théorie des points de vue situés – c’est-à-dire d’une critique féministe légitime de la possibilité d’une objectivité universaliste – à une théorie du privilège épistémologique absolu des dominé·e·s sur leur domination : toute personne, si elle est opprimée, détient la vérité incontestable de son oppression, donc la clé de sa libération. On ne peut contredire politiquement une personne opprimée si l’on n’est pas soit même opprimé·e sur le même axe. Le pendant de cela, c’est que mécaniquement les personnes les plus opprimées ont le plus de pouvoir politique et ainsi, on en revient insidieusement à un schéma de l’addition, où la personne la plus « intersectionnée » par les dominations est la plus opprimée, donc la plus légitime pour parler et imposer sa politique. Cela a aussi pour conséquence, à un niveau plus pratique, de provoquer dans les milieux militants féministe à une véritable « course aux dominations », précisément parce que la personne qui a le plus de légitimité est celle qui est la plus opprimée. On voit bien les manipulations et réécritures du réel que rend possible cette approche. D’un point de vue politique, déclarer l’infaillibilité des dominé·e·s, c’est encore une fois revenir à une forme d’essentialisation des positions sociales. »[3]
Critique du modèle identitaire
On voit d’emblée qu’Aurore Koechlin décrit une logique quasi implacable qui part d’une conception rigide de l’intersectionnalité et qui aboutit paradoxalement à des pratiques qui vont à l’encontre de cette même théorie : évacuation de la complexité, essentialisme, dogmatisme, modèle additif des rapports de domination, olympiades des oppressions, etc. Cela implique-t-il qu’il faille se débarrasser complètement du bagage théorique, critique et militant de l’intersectionnalité, des notions et pratiques liées à la positionnalité, la non-mixité de certains espaces, l’intrication des rapports d’oppression, le principe des premiers concernés, etc.? Cela veut-il dire qu’il est préférable de se concentrer sur les enjeux économiques et la lutte de classes, en considérant la question des privilèges, du sexisme et du racisme comme des questions morales, identitaires et privées? Bien sûr que non! L’important ici est de construire un modèle « non-identitaire » des rapports d’oppression.
Dans son texte Rethinking Recognition, Nancy Fraser nous invite à penser les relations de domination et les luttes pour la reconnaissance à travers une perspective non-identitaire. Tout d’abord, elle souligne que la vision selon laquelle la lutte de classes serait purement économique ou « matérielle » alors que les mouvements contre le sexisme et le racisme seraient purement culturels ou « symboliques » est erronée. Ainsi, des processus d’exploitation, de subordination, de normalisation, de marginalisation et de violence peuvent se jouer autant dans les rapports de classe, de sexe ou de « race ». Bref, il ne faut pas opposer mécaniquement la lutte de classe, à visée universelle, et les luttes contre les discriminations qui seraient intrinsèquement particularistes; des dimensions de « redistribution » et de « reconnaissance » peuvent toujours s’imbriquer à travers différentes luttes pour la justice sociale.
Or, Fraser souligne aussi que les enjeux de « reconnaissance » peuvent-être approchées de différentes façons. Elle décrit notamment comment une compréhension « identitaire » de ces luttes de reconnaissance peut amener deux problèmes : celui de l’évincement des luttes pour la redistribution et celui de la réification. Le modèle identitaire repose sur une conception de l’identité humaine basée sur un processus de reconnaissance mutuelle : le mépris ou le déni de reconnaissance causé par l’appartenance sociale de l’individu provoque une incapacité à développer une relation à soi réussie. L’appartenance à un groupe social dévalorisé par la culture dominante amène donc la perte d’estime de soi, le dénigrement, l’invisibilisation, et une plus grande exposition aux discriminations et violences de toutes sortes. Fraser reconnaît que ce modèle est utile pour prendre en compte les conséquences psychologiques du racisme, du sexisme, du colonialisme et de l’impérialisme culturel, mais que la compréhension des luttes de reconnaissance ne doit pas se limiter à ce modèle psychologique et identitaire.
D’un côté, Fraser souligne qu’une compréhension des luttes sociales axées sur l’identité a tendance à évacuer ou évincer les enjeux de redistribution et les bases matérielles de l’oppression. La non-reconnaissance est ainsi cadrée comme un enjeu de dévalorisation culturelle, basée exclusivement sur les discours et les normes. Souvent, la dimension économique ou les rapports de production sont ignorés, comme lorsqu’on fait de la figure du « white dude » ou de l’« homme blanc cis » l’archétype du « dominant », oubliant ou négligeant ainsi la variable de « classe » de l’équation. Et lorsque la classe est intégrée au sein de la politique identitaire (identity politics), Fraser remarque que celle-ci est réduite à une simple dévalorisation de l’identité culturelle des classes populaires. Tout se passe comme si le mépris de classe, les préjugés ou stéréotypes à l’endroit des classes défavorisées d’un point de vue économique (phénomène bien réel il faut le noter), expliquait ce dont il est question dans la domination de classe. On parle alors de « classisme » au lieu de parler d’exploitation économique, en faisant des relations de classe une simple question de discrimination ou de privilège de classe, limitant l’égalité d’opportunité des individus au sein d’une société. Fraser va même jusqu’à tracer un parallèle entre cette interprétation « culturaliste » des relations d’oppression et le « marxisme vulgaire » qui réduit tout phénomène social à sa seule base économique.
« In this way, culturalist proponents of identity politics simply reverse the claims of an earlier form of vulgar Marxist economism: they allow the politics of recognition to displace the politics of redistribution, just as vulgar Marxism once allowed the politics of redistribution to displace the politics of recognition. In fact, vulgar culturalism is no more adequate for understanding contemporary society than vulgar economism was. »[4]
Outre ce problème de l’évincement des enjeux de redistribution, le second problème du « modèle identitaire » est une certaine tendance à la réification des identités. Cela découle notamment d’un processus où les tentatives pour revaloriser des identités méprisées par la culture dominante amènent parfois une grande pression sur les membres d’un groupe minoritaire à se conformer aux normes de ce groupe. Au lieu de voir la formation des identités comme le résultat d’un processus social et dialogique complexe, c’est-à-dire comme un processus de reconnaissance mutuelle par deux parties (lequel peut être bien sûr traversé par des rapports de pouvoir), certains groupes sociaux vont tenter de s’auto-définir, dans une perspective de monologue interne, en se repliant sur des espaces safe immunisés contre la critique. Les phénomènes évoqués plus haut par Aurore Koechlin, comme l’infaillibilité épistémique des personnes dominées et la course à la radicalité, vont ainsi avoir tendance à créer des phénomènes d’entre-soi, à essentialiser et à réifier (c’est-à-dire chosifier, rendre stables, fixes et immuables) les identités sociales en évacuant leur complexité.
« Paradoxically, moreover, the identity model tends to deny its own Hegelian premisses. Having begun by assuming that identity is dialogical, constructed via interaction with another subject, it ends by valorizing monologism—supposing that misrecognized people can and should construct their identity on their own. It supposes, further, that a group has the right to be understood solely in its own terms—that no one is ever justified in viewing another subject from an external perspective or in dissenting from another’s self-interpretation. But again, this runs counter to the dialogical view, making cultural identity an auto-generated auto-description, which one presents to others as an obiter dictum. Seeking to exempt ‘authentic’ collective self-representations from all possible challenges in the public sphere, this sort of identity politics scarcely fosters social interaction across differences: on the contrary, it encourages separatism and group enclaves.
The identity model of recognition, then, is deeply flawed. Both theoretically deficient and politically problematic, it equates the politics of recognition with identity politics and, in doing so, encourages both the reification of group identities and the displacement of the politics of redistribution. »[5]
Les contre-publics subalternes : entre foyers de résistance et style de vie
Encore une fois, cela veut-il dire qu’il faille se débarrasser complètement du langage des identités, mettre de côté l’aspect culturel des injustices sociales, empêcher les groupes marginalisés de se réunir en espaces non-mixtes sécuritaires? Dans son célèbre article sur l’espace public, Fraser rappelait à ce titre l’utilité des « contre-public subalternes », c’est-à-dire « des arènes discursives parallèles dans lesquelles les membres des groupes sociaux subordonnés élaborent et diffusent des contre-discours, ce qui leur permet de fournir leur propre interprétation de leurs identités, de leurs intérêts et de leurs besoins »[6]. Fraser montre le caractère indispensable de ces espaces (qu’on nomme aujourd’hui safe spaces) qui permettent de construire une vision partagée de certains enjeux, l’échange d’expériences vécues, l’entraide et le soutien mutuel, mais aussi l’élaboration de contre-discours qui pourront ensuite revenir dans l’espace public mainstream afin de lutter contre les multiples formes de domination.
Or, il ne faut pas non plus voir ces espaces comme étant toujours exempts de relations de pouvoir. « Pour éviter tout malentendu, je précise que mon propos n'est pas d'insinuer que les contre-publics subalternes sont toujours et obligatoirement vertueux. En effet, certains d'entre eux sont malheureusement explicitement antidémocratiques et anti-égalitaires, et même ceux qui sont animés d'intentions démocratiques et égalitaires ne sont pas épargnés par des modes spécifiques d'exclusion et de marginalisation informelles. Pourtant, dans la mesure où ces contre-publics naissent en réaction aux exclusions au sein des publics dominants, ils contribuent à élargir l'espace discursif. Ils imposent en principe que les hypothèses qui ne faisaient l'objet d'aucune contestation soient publiquement débattues. La prolifération de contre-publics subalternes est en général synonyme d'un élargissement du discours contestataire, ce qui est positif dans les sociétés stratifiées.
Dans des sociétés stratifiées, les contre-publics subalternes ont un caractère dual. D'une part, ils fonctionnent comme des espaces de repli et de regroupement ; d'autre part, ils fonctionnent aussi comme des bases et des terrains d'essai pour des activités d'agitation dirigées vers des publics plus larges. C'est précisément dans la dialectique entre ces deux fonctions que réside leur potentiel émancipateur. Cette dialectique permet en effet aux contre-publics subalternes sinon d'éradiquer complètement, du moins de compenser en partie les privilèges de participation injustes dont bénéficient les membres des groupes sociaux dominants. Bien sûr, la contestation entre les publics concurrents présuppose une interaction discursive interpublics. […] Au total, mon propos n'est pas de faire l'apologie postmoderne de la multiplicité. Je défends plutôt, dans les sociétés stratifiées, l'existence de contre-publics subalternes formés dans des conditions marquées par la domination et la subordination. Dans le second cas, en revanche, je défends la possibilité de combiner égalité sociale, diversité culturelle et démocratie participative. » [7]
Ainsi, Fraser souligne que les safe spaces ou contre-publics subalternes ont un rôle important à jouer dans l’élargissement de l’espace public. Néanmoins, il ne doivent pas devenir des enclaves ou des fins en soi, mais des « moments » d’une lutte plus large où les groupes opprimés peuvent se réunir temporairement pour ensuite revenir au sein d’un espace public élargi. Fraser, tout comme bell hooks, sera ainsi critique des phénomènes de séparatisme au sein de certaines luttes sociales. Il faut envisager ces espaces comme des foyers de résistance, et non les concevoir selon une logique identitaire visant à créer un « style de vie alternatif » en marge de la culture dominante.
Ainsi, le principal piège du modèle identitaire consiste à concevoir la lutte comme une identité « prêt-à-porter », comme des espaces d’entre-soi qui se coupent progressivement de mouvements sociaux plus larges. bell hooks, qui est l’une des plus grandes représentantes du féminisme noir américain, célèbre pour ses critiques du féminisme blanc et sa conception fine des rapports de pouvoir, met en garde le mouvement féministe contre certaines dérives potentielles.
« Le féminisme est la lutte pour mettre fin à l’oppression sexiste. Son but n’est pas de servir uniquement un groupe spécifique de femmes, ni de femmes d’une race ou d’une classe particulières. Il ne privilégie pas les femmes par rapport aux hommes. Il a le pouvoir de transformer de manière significative nos vies multiples et différentes. Et, avant toute chose, le féminisme n’est ni un style de vie ni une identité toute prête ou un rôle qu’on peut endosser. […] En rejetant la notion de « style de vie » féministe alternatif qui peut émerger uniquement quand des femmes créent une subculture (que ce soit au sein d’espaces de vie ou même de cadres comme les women’s studies, devenus fermés et prestigieux sur de nombreux campus), et en insistant sur le fait que le combat féministe peut démarrer n’importe où se trouve une femme, nous créons un mouvement qui prend en compte notre expérience collective, un mouvement continuellement basé sur les masses. […]
Souvent, l’approche liée à l’identité et au style de vie est séduisante car elle créé l’impression d’être engagée dans une pratique. Cependant, au sein de n’importe quel mouvement qui vise à transformer radicalement la société, la pratique ne peut pas uniquement se résumer à créer des espaces au sein desquels des personnes supposées radicales expérimentent la sécurité en leur sein et le soutien. Le mouvement féministe pour mettre fin à l’oppression sexiste engage activement ses participant·e·s dans un combat révolutionnaire. Et un combat, c’est rarement safe et agréable. »[8]
Comme stratégie discursive, bell hooks propose d’ailleurs de mettre de côté les étiquettes identitaires comme « je suis » pour qualifier notre adhésion à certaines luttes, comme s’il s’agissait simplement d’identités politiques : je suis féministe, je suis antiraciste, je suis anticapitaliste, etc. Cela donne par exemple des débats complexes à savoir si un homme peut se qualifier de « féministe » (alors qu’il n’est pas une femme et ne fait pas l’expérience directe du sexisme), ou s’il doit se dire seulement pro-féministe, ou encore « allié » des luttes féministes (là encore, l’homme ne doit pas se dire lui-même allié, seules d’autres féministes pouvant lui attribuer cette appellation en fonction ses attitudes, ses gestes de solidarité et son pedigree militant). Bref, au lieu de s’enfermer dans les débats à savoir si des personnes blanches peuvent se dire antiracistes ou non, bell hooks nous invite à centrer notre attention sur les systèmes de domination.
« Pour mettre l’accent sur la lutte féministe en tant qu’engagement politique, nous pourrions éviter d’utiliser la phrase « je suis féministe » (une structure linguistique prévue pour se référer à un aspect personnel de l’identité et de l’autodéfinition), et pourrions plutôt déclarer « je prône le féminisme ». Dans la mesure où une insistance injustifiée a été portée sur le féminisme comme identité et style de vie, les gens ont souvent une vision stéréotypée du féminisme. Il est nécessaire de détourner l’attention des stéréotypes si nous voulons corriger notre stratégie et notre but. Je me suis rendu compte qu’en disant « je suis féministe », les gens m’étiquetaient souvent avec des idées préconçues sur mon identité, mon rôle, mes comportements. Alors que quand je dis « je prône le féminisme », els répondent généralement : « qu’est-ce que le féminisme? » Une phrase telle que « je prône » n’implique pas la forme d’absolutisme suggérée par « je suis ». Elle ne nous engage pas dans la pensée manichéenne dualiste qui est la composante centrale de tous les systèmes de domination dans la société occidentale. […] Le passage de l’expression « je suis féministe » à « je prône le féminisme » pourrait être une stratégie utile pour décentrer l’attention qui a été portée sur l’identité et le style de vie. »[9]
Par ailleurs, hooks souligne que les hommes peuvent contribuer à combattre le sexisme, tout comme les blancs peuvent contribuer à combattre le racisme, bien qu’ils se trouvent par ailleurs parmi le groupe des « dominants » ou « privilégiés ». Elle base notamment sur son analyse de la positionnalité des femmes noires qui ont souvent développé des liens de solidarité avec les hommes noirs alors que certaines féministes blanches de classes aisées de son époque invitaient à opposer les hommes et les femmes comme deux classes ou groupes distincts.
« Des assertions telles que « tous les hommes sont des ennemis » et « tous les hommes haïssent les femmes » ont mis tous les hommes dans une même catégorie, laissant ainsi penser qu’ils partagent tous l’ensemble des différents aspects du privilège masculin. […] Les positions anti-hommes ont éloigné de nombreuses femmes pauvres et de la classe ouvrière, et en particulier des femmes non-blanches, du mouvement féministe. Leurs vécus leur avaient prouvé qu’elles avaient plus en commun avec les hommes de leur groupe social et/ou racial qu’avec les bourgeoises blanches. Elles savaient à quelles souffrances et à quelles épreuves sont confrontées les femmes dans leur communauté; elles connaissaient aussi les souffrances et les épreuves vécues par les hommes et elles avaient de la compassion pour eux. Elles avaient lutté à leur côté pour une meilleure vie. Et cela est particulièrement vrai pour les femmes noires. […] Il y a un lien particulier qui unit les gens qui luttent ensemble pour l’émancipation. Les femmes et les hommes noir·e·s ont été uni·e·s par de tels liens. Elles et ils ont fait l’expérience de la solidarité politique. […] Cela ne veut pas dire que les femmes noires ne voulaient pas reconnaître le sexisme des hommes noirs. Mais cela signifie que pour beaucoup d’entre nous, ce n’est pas en attaquant les hommes noirs ou en y ripostant avec agressivité que l’on combattra le sexisme ou la haine des femmes. »[10]
On voit ici que l’imbrication des relations de domination n’amène pas forcément la fragmentation des luttes, que la référence à l’expérience vécue n’implique pas l’idée que chaque groupe social peut uniquement comprendre la réalité de son propre groupe, et que des relations de solidarité peuvent se constituer à travers différents rapports sociaux d’oppression en vue d’un combat plus large pour l’émancipation.
Éviter l’homogénéisation
Angela Davis, qui a étroitement théorisé les relations entre femmes, race et classe, nous invite également à éviter le phénomène d’essentialisation de certains groupes sociaux, c’est-à-dire en les catégorisant comme des groupes homogènes à combattre en bloc, ce qui a pour effet d’évacuer la complexité et l’imbrication des rapports de pouvoir. Dans son autobiographie, elle écrit :
« Puisque les masses blanches adoptaient des comportements racistes, notre peuple avait tendance à les considérer comme étant, elles méchantes. Et ils en oubliant d’accuser les formes institutionnalisées du racisme qui bien qu’inévitablement renforcées par des comportements teintés de préjugés, ne servaient fondamentalement que les intérêts des dirigeants. Quand le peuple blanc est sans discrimination, considéré comme l’ennemi, il est virtuellement impossible de mettre en place une solution politique. […] J’apprenais que, aussi longtemps que la réponse des Noirs au racisme resterait émotionnelle, nous n’irions nulle part. »[11]
À l’instar de Koechlin, Fraser et bell hooks, Davis critique ici le phénomène de réification des identités et de l’évincement, notamment des enjeux de redistribution et de classe, des luttes sociales pour l’émancipation. Cela veut-il dire qu’il faille embrasser une posture universaliste faisant primer la lutte de classes, en associant tout le langage du féminisme noir et des nouvelles théories critiques à une « novlangue issue de l’impérialisme culturel états-unien et qui leur est associée (intersectionnalité, fragilité blanche, cancel culture, etc.) », comme le souligne Pierre Mouterde?
Ce dernier a-t-il raison de souligner « ce à quoi l’on devrait d’abord penser : à tout ce qui pourrait nous unir et nous rassembler à l’encontre du système capitaliste global qui dans les faits ne cesse de ré-alimenter l’ensemble des discriminations et oppressions contre lesquelles on veut avec tant de raison lutter », comme si le principal enjeu ou la cause ultime de toutes les oppressions découlant d’un seul système domination?
Si Pierre Mouterde, Marc-André Cyr et d’autres ont raison de souligner certaines dérives moralisatrices et sectaires de la « gauche identitaire », leur diagnostic sur les causes de ces dérives (la « posture postmoderne ») et l’identification du remède (faire du prolétariat ou des classes populaires « les véritables victimes de l’injustice », en réhabilitant la contradiction primaire contre les luttes secondaires) vont-ils permettre nous faire sortir des polémiques spectaculaires qui opposent la gauche identitaire à la droite identitaire?
Dans la prochaine partie de cet article, nous montrerons qu’un « retour en arrière » visant à attribuer au capitalisme l’ensemble des maux et à faire de la lutte des classes une priorité stratégique nous semble une perspective erronée. Cela dit, nous proposons de reconceptualiser le capitalisme à travers son imbrication au sein de multiples rapports d’oppression, le capitalisme étant toujours et déjà un capitalisme racial, patriarcal et colonial. Celui-ci implique des luttes de classes, mais aussi des « luttes frontières » liées aux frontières institutionnelles qui séparent la sphère de la « production économique » de celles de la reproduction sociale, la nature et le domaine politique. Que nous nommions ce système « capitalisme racial, patriarcal et colonial », ou encore « patriarcat capitaliste suprématiste blanc impérialiste » comme le suggère bell hooks, il s’ensuit qu’il s’agit bien de s’opposer à un seul système, une « totalité sociale », laquelle étant constituée de rapports sociaux hétérogènes et néanmoins imbriqués.
En nous inspirant des travaux de Danièle Kergoat, nous analyserons de plus près le phénomène de consubstantialité et de coextensivité des rapports sociaux, cadre théorique plus à même de saisir l’imbrication des systèmes de domination que la métaphore des « intersections » préconisée par l’intersectionnalité, laquelle a ainsi une tendance à individualiser les relations de pouvoir et les privilèges en se concentrant sur l’échelle microsociale. Nous montrerons ainsi qu’il est non seulement possible mais nécessaire de lier les avancées théoriques du féminisme noir, de la pensée décoloniale et du marxisme critique contemporain, sans retomber pour autant dans les impasses de la « gauche identitaire » critiquée dans ce texte.
Cela signifie donc que la principale cause des dérives présentées ici ne renvoie pas à une grande théorie « postmoderne », « postcoloniale » et/ou « intersectionnelle » qui serait responsable de tous les problèmes de la « gauche woke ». Le problème vient plutôt d’une compréhension rigide des rapports sociaux de domination, d’une analyse dogmatique de la positionnalité et de ses privilèges épistémiques, et d’une certaine course à la radicalité qui mène certains groupes à s’enfermer, malgré eux, dans le sectarisme. De plus, en mobilisant les analyses de la militante juive et lesbienne Sarah Schulman, nous montrerons que le fameux phénomène de la « cancel culture » trouve ses racines dans des mécanismes psychosociologiques par lesquels le « conflit » est systématiquement évalué en termes d’« agression », le terme « violence » étant interprété de façon vague en évacuant toute forme de nuance, cette dynamique entraînant une escalade des hostilités, des dénonciations unilatérales, des logiques d’affrontement, d’exclusion et de bannissement au sein des milieux militants, qui ne permettent pas la résolution de problèmes, mais contribuent plutôt à envenimer nos relations humaines.
Ainsi, nous proposons de distinguer soigneusement les mécanismes psychiques responsables de la cancel culture (aux effets délétères et contre-productifs), d’une analyse fine et complexe des relations de domination susceptible de nourrir les solidarités et de renforcer les luttes pour l’émancipation. La question n'est donc pas de choisir entre redistribution et reconnaissance, entre gauche universaliste et gauche identitaire, mais de dépasser cet antagonisme par une théorie critique synthétique et des pratiques militantes génératrices d'entraide, de soutien et de renforcement du pouvoir d'agir collectif.
[1] Charles Gagnon,
À la croisée des siècles. Réflexions sur la gauche québécoise, Écosociété, Montréal, 2015, p. 155-157
[2] Aurore Koechlin,
La Révolution féministe, Éditions Amsterdam, Paris, 2019, p. 126.
[3] Ibid., p. 127-137
[4] Nancy Fraser, « Rethinking Recognition », New Left Review, vol. 3. No. 3, May/June 2000, p. 111
[5] Ibid., p. 112-113.
[6] Nancy Fraser, « 5. Repenser l'espace public : une contribution à la critique de la démocratie réellement existante », Emmanuel Renault (éd.),
Où en est la théorie critique ?. La Découverte, Paris, 2003, p. 103-134.
[7] Ibid. [8] bell hooks,
De la marge au centre, Éditions Cambourakis, Paris, 2017, p. 98 à 101.
[9] Ibid., p. 101-102.
[10] Ibid., p. 155-156.
[11] Angela Davis, extrait de son autobiographie citée dans Angela Davis,
Magazine Légende, No. 2, septembre 2020, p. 33.