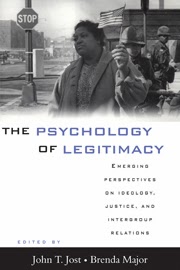Dans une brève réflexion portant sur
les raisons pour lesquelles les indépendantistes ne votent pas pour le même
parti[1],
le chef d’Option nationale, Sol Zanetti, émet des hypothèses pour expliquer les
divergences idéologiques et stratégiques qui distinguent sa formation politique
du Parti québécois et de Québec solidaire. Comme nous partageons sa critique du
péquisme, notamment sur la question de l’électoralisme et de l’attentisme, nous
souhaitons plutôt déconstruire certaines idées reçues procédant d’une mauvaise
lecture des « nationalistes » à l’endroit des solidaires.
Tout d’abord, Zanetti pointe le talon
d’Achille de la stratégie d’accession à l’indépendance de Québec solidaire, qui
« promet
de faire un référendum, dans un premier mandat, pour ratifier la constitution
que la population aura écrite. Le problème, c'est qu'ils refusent de garantir que cette constitution contiendra une
déclaration d'indépendance. Donc, ce référendum promis pourrait déboucher sur
une simple proposition de réforme du fédéralisme, une proposition de
constitution qui demeurerait soumise au cadre fédéral canadien. À quoi cela
servirait-il? Fouillez-moi. »
Or,
Québec solidaire n’a jamais « refusé » de garantir que cette
constitution contiendra une déclaration d’indépendance du Québec ; le
programme est tout simplement vague sur le sujet. S’agit-il d’un flou délibéré,
d’une position d’ouverture visant à chercher une majorité électorale ?
Est-ce plutôt le résultat d’une imprécision programmatique qui pourrait être
clarifiée ultérieurement, à la manière de la stratégie du LIT dont
l’articulation concrète n’est pas précisée ? Est-ce que les solidaires
présupposent tout simplement le résultat du processus, cette stratégie menant
forcément à poser la question de l’indépendance au peuple québécois lors du
référendum ?
L’électoralisme
et les fédéralistes de gauche
Pour
expliquer ce qui semble être un « compromis », le chef d’Option
nationale fait l’hypothèse qu’il s’agit une stratégie électoraliste visant à
consolider la « base électorale fédéraliste » de Québec solidaire.
Cette observation découle de l’analyse de sondages montrant qu’une bonne partie
des électeurs et électrices de ce parti de gauche ne sont pas d’emblée convertis
à l’idée d’indépendance du Québec. Malgré tout, ces personnes sont-elles pour
autant des fédéralistes convaincus qui voteraient assurément contre
l’indépendance le jour du référendum ? Permettez-nous d’en douter.
D’une
part, cette explication suppose que cette base électorale fait un compromis,
faute d’un parti fédéraliste de gauche pour lequel elle irait voter massivement
lors de sa création. L’arrivée imminente d’un NPD-Québec viendrait alors gruger
la moitié des appuis à Québec solidaire, celui-ci passant de 10% à 5% dans les
intentions de vote par exemple. Ce scénario n’est pas réaliste, car l’arrivée
d’un tel parti aurait un effet diffus sur l’ensemble de la scène politique
québécoise, allant davantage empiéter sur la base électorale du Parti libéral
du Québec qui, pour la plupart, ne voteraient jamais pour un parti ouvertement
indépendantiste.
D’autre
part, est-il raisonnable de supposer que les « fédéralistes de
gauche » sont si confiants que la démarche d’assemblée constituante
pourrait facilement ne pas inclure de déclaration d’indépendance, et ce dans un
contexte de mobilisations sociales où un gouvernement solidaire ferait
activement la promotion d’une République sociale, démocratique, écologique et
indépendante ? La question ne se résume pas au type de membres qui
composeront l’assemblée constituante, car il faut tenir compte des rapports de
forces qui auront mené au pouvoir un parti de gauche indépendantiste, et la
lutte féroce qui accompagnera ce grand processus démocratique basé sur une
souveraineté populaire qui rompt de facto
avec le régime fédéral canadien.
Le parti
de la diversité
Par
ailleurs, le mythe des « fédéralistes de gauche » présents au sein de
Québec solidaire, ou constituant une base majeure de son électorat, semble
reposer sur une opposition rigide deux catégories : les indépendantistes
militants et « les autres ». Si nous regardons de plus près, Québec
solidaire représente une large constellation, réunissant des syndicalistes,
écologistes, citoyennes, féministes, indépendantistes, socialistes,
républicains, artistes, jeunes et moins jeunes qui partagent une déclaration de
principes dans laquelle la souveraineté joue un rôle déterminant. Nous pouvons
donc supposer que la base électorale de ce parti multidimensionnel est encore plus diversifiée, tout en
endossant les valeurs et le projet de société solidaire qui inclut
l’indépendance du Québec.
C’est
dans cet esprit que doit être interprétée cette citation de Françoise
David : « On n'a pas besoin d'être mal à l'aise si on n'est pas
complètement convaincu de la souveraineté et qu'on veut être membre de Québec
solidaire, dit-elle. C'est pour cela que notre nombre de membres a doublé
depuis un an.» (La Presse, 23 octobre 2012) ». Le fait d’inclure des
personnes non convaincues et de les amener progressivement à adopter une
nouvelle culture politique représente-t-il une force, plutôt qu’une faiblesse,
pour un parti indépendantiste ? Si Québec solidaire est capable d’aller
chercher des personnes a priori
hostiles ou indifférentes à la culture souverainiste traditionnelle, en les
ramenant à endosser son projet de pays, n’est-ce pas là la preuve d’une
certaine efficacité qui ne passe pas directement par une pédagogie nationaliste
militante ? La division du travail politique entre Québec solidaire et
Option nationale ne serait-elle pas le signe d’une complémentarité dans les
manières d’accrocher des diverses parties de la population à la lutte de
libération nationale ?
Le
fait que plusieurs personnes non complètement
convaincues par l’indépendance appuient un parti de gauche indépendantiste montre
plutôt que celles-ci sont d’accord avec une démarche démocratique, participative
et inclusive, permettant de débattre d’un projet de pays qui ne se résume pas à
un Oui ou Non référendaire. Une assemblée constituante offre l’occasion
historique d’élaborer collectivement les principes, les valeurs, les
institutions et la répartition des pouvoirs d’un nouvel État, créant par le
fait même une vaste mobilisation, une dynamique sociale nécessaire pour obtenir
un appui massif à l’indépendance. Ce faisant, le peuple ne donne pas pour
mandat au gouvernement de faire l’indépendance à sa place ; c’est le
gouvernement qui donne aux citoyens et citoyennes les outils pour prendre
eux-mêmes en charge leur propre émancipation populaire. C’est la toute la
différence entre l’indépendance solidaire et le nationalisme traditionnel du
Parti québécois et Option nationale : la souveraineté « par le
bas », et non par le haut.
Une
stratégie souterraine
De
plus, la stratégie d’accession à l’indépendance de Québec solidaire ne se
limite ni à une simple procédure démocratique, ni à un débat technique et
constitutionnel visant à découvrir, par le biais d’un calcul politique et
utilitariste, une méthode « infaillible » pour réaliser ce vaste
projet. Les nationalistes, et même les solidaires, oublient trop souvent que
l’assemblée constituante ne représente que l’apogée d’une stratégie plus
profonde, prenant racine dans les mouvements sociaux et de larges pans de la
société civile. En gros, il s’agit d’amorcer dès maintenant une démarche constituante reposant sur la
souveraineté populaire, qui servira alors de tremplin pour prendre le pouvoir
et instaurer une rupture avec l’ordre
canadien. La lecture de cette partie de programme est souvent négligée :
« Parler d’Assemblée constituante, ce
n’est pas poser abstraitement un nouveau chemin vers la souveraineté du Québec.
C’est proposer de discuter, de la manière la plus démocratique et la plus large
possible, des mécanismes essentiels pour assurer la défense du bien commun,
pour articuler le projet d’indépendance politique et les revendications
sociales. Québec solidaire fera, dès les prochains mois, connaître largement ce
projet par une vaste campagne d’éducation populaire. Il s’agira aussi de son
axe d’intervention au Conseil de la souveraineté.
Québec solidaire visera graduellement à
construire une alliance démocratique, sociale et nationale pour regrouper
l’ensemble des forces syndicales, populaires, féministes, étudiantes,
écologistes et les partis souverainistes autour de la reconnaissance de la
souveraineté populaire qui se concrétisera par l’élection d’une Assemblée
constituante. La stratégie de Québec solidaire consistera à mettre en route et
développer une véritable démarche citoyenne afin que toutes et tous soient
associés à la détermination de notre avenir collectif.
La popularisation de l'idée de constituante
devra être préparée par la mise sur pied, aux niveaux local ou régional à la
grandeur du Québec, d’une démarche de démocratie participative. Cette démarche
permettra aux citoyennes et aux citoyens de s’exprimer et de discuter ensemble,
de manière à ce que se constitue peu à peu un large appui au sein de la
population. Une telle démarche peut s’amorcer avant l’élection d’un gouvernement
proposant l’élection d’une constituante et elle devra se poursuivre après cette
élection tout en étant soutenue financièrement par ce gouvernement.
Pour être légitime, le processus devra être
profondément démocratique, transparent et transpartisan. La campagne électorale
qui mènera un parti ou une alliance fondée sur l’Assemblée constituante au
pouvoir devra mettre de l’avant l’obtention d’un mandat pour l’élection d’une
Assemblée constituante qui représente pour Québec solidaire le moyen d’accession
à l’indépendance et de transformation de la société, processus dont cette
campagne ne sera qu’une première étape.
L’élection d’une Assemblée constituante est
donc un acte démocratique par excellence, un acte à la fois de rupture avec le
statu quo du régime fédéral canadien et un acte réellement fondateur. En ce
sens, c’est une suspension des mécanismes de la réforme constitutionnelle
prévue par l’Acte de l’Amérique du Nord britannique. »
Une radicalité pragmatique
En replaçant l’assemblée constituante dans
un contexte plus large, reposant sur une vision dynamique de l’action
collective et non sur un calcul électoraliste étroit, il n’est pas
déraisonnable de constater que la stratégie solidaire, malgré les apparences,
est sans doute la plus radicale du mouvement indépendantiste. Elle se concrétise
déjà en partie au sein de la phase II des États généraux sur la souveraineté,
du Nouveau mouvement pour le Québec et de divers groupes de la société civile.
Cette perspective participe d’un processus de convergence des forces sociales
en faveur de l’indépendance, où les partis politiques jouent un rôle
secondaire.
D’ailleurs, cette radicalité n’est pas
idéologique mais pragmatique ; il ne s’agit pas de propager la « foi
souverainiste » par l’application de la bonne pédagogie, mais de faire
émerger les conditions qui rendront possible et effectif un véritable mouvement
de libération populaire. Il peut certes être utile de faire la promotion active
de l’idée d’indépendance, en favorisant une prise de conscience par le biais
d’arguments économiques (Aussant-financier) ou en misant sur les passions
(Aussant-artiste). Cela peut aller rejoindre un public différent et non
convaincu, et même représenter une condition nécessaire à la diffusion de ce
projet ; mais c’est largement insuffisant pour élire un gouvernement qui
souhaite établir une rupture avec l’ordre établi.
Pour ce faire, il faut développer un
rapport de force, c’est-à-dire une vraie volonté collective de changement qui
ne se fera pas sans réaction des élites politiques et économiques. L’élément
souvent négligé du mouvement souverainiste, qui était pourtant un facteur
déterminant dans l’émergence des forces indépendantistes des années 1960 et
1970, c’est la nécessité vécue par une majorité sociale de transformer ses
conditions matérielles d’existence. Le mouvement souverainiste se développait
comme le fruit d’une révolution, tranquille mais profonde néanmoins,
c’est-à-dire d’un changement social, économique, politique et culturel lié à
l’instauration d’un État-providence permettant de renforcer les capacités
d’auto-détermination du peuple québécois.
Autrement dit, l’objectif souverainiste était
en quelque sorte d’achever un large processus de transformation sociale qui
avait déjà eu lieu en bonne partie. C’est pourquoi il est faux de dire
« qu’avant d’être de gauche ou de droite, il faut d’abord
être » ; la société québécoise s’était profondément transformée à
partir de forces progressistes qui ont permis de rompre avec un ordre
économique et culturel conservateur. La société était de gauche avant, ou plutôt pendant qu’elle aspirait à se réaliser pleinement par la
constitution d’un État indépendant. La question nationale et sociale ne sont
donc pas séparées, mais enchevêtrées ; elles ne doivent pas être articulées
par un avant et un après, mais en même temps. Voici
pourquoi.
Le mythe du commencement
absolu
Un mythe nationaliste consiste à croire que
le débat gauche/droite aura un sens après l’indépendance, celle-ci représentant
le véritable commencement. Or, cette lutte aura lieu avant, pendant et après le
processus d’accession à l’indépendance. S’il est vrai que la lutte de gauche
que mène Québec solidaire ne se terminera pas le jour de l’indépendance, que la
constitution sera élaborée démocratiquement et pourra donc être plus ou moins à
gauche, au centre ou à droite, on ne peut pas déduire logiquement que le combat
pour l’émancipation sociale ne pourra « commencer pour vrai »
uniquement après avoir obtenu l’indépendance. S’il est vrai que « ce n'est qu'en étant
politiquement indépendants, en contrôlant l'ensemble de nos lois, de nos impôts
et de nos traités, que nous aurons les coudées franches pour faire du Québec de
demain le reflet de ce que souhaite sa population », il n’en découle pas
que le gouvernement provincial aujourd’hui n’a aucune marge de manœuvre pour favoriser ou non le passage à un
« Québec inc. » et un État pétrolier. Au contraire, les gouvernements
souverainistes ont largement contribué à la diffusion de l’idéologie
néolibérale et à la négociation active
notre dépendance économique au nom d’un intérêt général qui favorisait en fait
les classes dominantes.
Tout
se passe comme si l’indépendance, politique ou économique, était une affaire de
tout ou rien ; non pas une différence de degré, mais un saut ontologique,
comme si nous pouvions être soit totalement opprimés et sans marge d’action
(aujourd’hui), soit totalement libres de faire ce que nous voulons. Cette idée
repose sur une mauvaise conception de la liberté politique, et sur une faible compréhension
du fonctionnement des institutions, des forces sociales et économiques, bref
des rapports de pouvoir qui sont à l’œuvre constamment à chaque moment de
l’histoire. C’est pourquoi nous ne pouvons excuser notre présent gouvernement
de faire des mauvais choix concernant l’austérité, le nationalisme conservateur
et l’exploitation pétrolière parce que nous ne sommes pas encore 100%
indépendants politiquement.
Un projet national vraiment rassembleur ?
La conception de l’indépendance comme
processus permet d’écarter la fausse opposition entre « projet national
rassembleur » et « projet de classe diviseur ». Il est clair
qu’il faut rallier une majorité de la population et unir le plus grand nombre
de groupes sociaux pour obtenir un pays. Or, pourquoi ne pas essayer justement
de construire un mouvement populaire d’opposition à l’élite économico-politique
qui ne veut aucun changement dans l’ordre des choses ? Si plusieurs
aiment souligner que des hommes d’affaires comme Pierre-Karl Péladeau peuvent
être souverainistes, ce qui n’est pas incohérent en soi, est-ce qu’une majorité
d’entre eux ont intérêt à appuyer
l’indépendance du Québec ? Par ailleurs, que doit-on entendre par
« milieu des affaires » ?
Bien que plusieurs soulignent que
l’économie québécoise est principalement composée de PME, ce ne sont pas elles
qui dirigent la finance, le grand capital et l’orientation générale des
investissements, la production, la consommation et la distribution et de biens
et services au Québec. Une analyse de classes plus fine permet de discerner une
division entre les petits entrepreneurs et l’élite économique, même si les deux
peuvent être idéologiquement « à droite ». Les premiers ont sans
doute intérêt à faire l’indépendance, contrairement aux seconds. À ce titre, il
faut relire la Lettre aux indépendantistes d’Amir Khadir :
« Le patronat québécois a été historiquement l’adversaire
le plus farouche et le plus efficace de la souveraineté économique et politique
du Québec. Nombre d’indépendantistes persistent cependant à entretenir l’espoir
qu’une partie de l’élite économique donnera à nouveau un jour, comme en 1995,
son feu vert à ceux qui comme la direction du PQ attendent son autorisation
avant de solliciter le peuple au rendez-vous avec son avenir. Force est de
constater que les choses ont bien changé. Le segment nationaliste formé par
certains barons du Québec Inc. tend à être de plus en plus ténu et isolé. Au
cours des 15 dernières années, l’élite économique dominante du Québec a été si
bien intégrée à celles de Bay Street et de Wall Street, qu’elle en épouse tous
les grands desseins politiques. Il n’y a à mon avis aucune convergence possible
entre cette élite et le projet indépendantiste. »
Le but n’est donc pas de faire une alliance
avec la grande bourgeoisie canadienne et américaine qui contrôle l’économie
québécoise, ni même avec le patronat québécois qui représente notre bourgeoisie
nationale, mais de créer une coalition entre les travailleurs, précaires,
étudiantes, paysans, classes moyennes, petits entrepreneurs, c’est-à-dire une
majorité sociale contre le 1% pour résumer simplement. Ce qu’il nous faut,
c’est une sorte de populisme de gauche et indépendantiste, qu’il faut opposer
au populisme conservateur, identitaire et autonomiste que le Parti québécois
est en train de créer de paire avec les élites économiques.
La collaboration de classes
Cela nous amène à déconstruire un autre
mythe, celui d’une nécessaire « collaboration de classes » étant
donné l’ordre « naturel » du système économique, afin de domestiquer
le capitalisme pour servir le projet national. Il faut reprendre à ce titre une
citation de Sol Zanetti : « Le milieu des affaires au Québec est constitué
principalement de PME et les entrepreneurs québécois auront un grand rôle à
jouer dans la construction du Québec. Ce sont eux qui, en collaboration avec
l'État, développeront l'économie durable vers laquelle nous devons cheminer
pour survivre au XXIe siècle. À moins de vouloir étatiser l'ensemble
de l'économie, nous devons nous en faire des alliés, dans la mesure du
possible, et les inciter à agir avec nous dans l'intérêt supérieur de la nation
québécoise. »
Le sophisme consiste à créer un faux
dilemme entre une économie mixte (État et régulation du marché) et une économie
socialiste centralement planifiée, comme si elles représentaient les deux
seules alternatives au néolibéralisme (libre marché). Le modèle coopératif,
l’économie plurielle, le socialisme démocratique et décentralisé et la
planification démocratique de l’économie sont ainsi des options évacuées du
champ des possibles. Évidemment le nationalisme social-démocrate considère
souvent qu’il n’y a pas d’autre façon de s’opposer au fédéralisme
libéral ; mais il serait intéressant de dépasser cette dichotomie afin de
libérer notre imagination économique, politique et stratégique.
Le projet nationaliste consiste à mettre en
parenthèses les intérêts particuliers (individuels ou de groupes sociaux) pour
se concentrer sur l’« objectif
commun » de la Nation. Il faut certes créer une grande solidarité entre
diverses forces sociales pour réaliser l’indépendance, mais il est absolument
essentiel d’identifier les groupes
susceptibles d’amener le changement et d’adhérer au projet. On ne peut
simplement appeler à une grande union magique entre l’élite et le peuple, du
moins sans avoir recours à l’idéologie, la manipulation, l’invisibilisation des
rapports de domination et un « partenariat » qui ne fera que
consolider l’intérêt des groupes privilégiés. S’il faut mettre un terme à
l’oppression du peuple québécois et lui donner les moyens de se libérer, il
faut reconnaître que celui-ci est dominé non seulement par l’État fédéral, mais
par l’impérialisme américain, les multinationales et l’élite
politico-économique nationale qui ne représentent en rien « le bien commun ».
Une révolution par le bas
Il ne s’agit pas ici de récuser tout modèle
de « révolution démocratique-bourgeoise » et de prôner une
« révolution économique » qui mettrait un terme au système
capitaliste. Il s’agit plutôt de montrer que le combat pour l’indépendance et
la « lutte des classes » ne doivent pas être réduites l’une à
l’autre, ni être complètement séparées, mais qu’elles doivent être articulées
dans leurs différences et leur synergie. De plus, il faut reconnaître que
l’accession à l’indépendance politique du Québec ne sera pas une petite réforme
en douceur, mais une véritable révolution politique qui amènera un grand
changement social, d’une manière ou d’une autre. On peut certes s’inspirer des
modèles de la révolution américaine ou française, mais il faudrait également
regarder du côté des luttes de décolonisation, de libération nationale en
Amérique latine, ou encore vers la Catalogne où tout ne se joue pas simplement
via le un mode de scrutin proportionnel, mais dans la rue.
Ainsi, c’est par les luttes citoyennes,
syndicales, étudiantes ou écologistes, contre les injustices sociales,
économiques, politiques et environnementales, que le peuple prend conscience de
l’ampleur du combat à mener ; à travers la résistance et l’action, la solidarité
et l’adversité, il réalise qu’il n’est pas maître chez lui et que ses propres
représentants ne défendent pas ses intérêts, voire qu’ils menacent même ses
conditions d’existence et l’avenir des générations futures. C’est pourquoi il
absolument essentiel de laisser tomber le souverainisme de concertation pour
embrasser un indépendantisme de combat, qui pourra ensuite conscientiser des
parties beaucoup plus larges de la population même si cela amène une certaine
polarisation par la mise en évidence des antagonismes sociaux.
Il faut envisager l’accession à
l’indépendance comme un mouvement social, une véritable lutte de libération
nationale, et non comme une affaire que nous pourrions diriger par le haut. Le
corollaire pratique de cette perspective est qu’il n’est pas possible de mettre
de côté les différents mouvements sociaux au nom du grand projet national
rassembleur, car la lutte pour l’indépendance représente un des mouvements sociaux, et non le seul. Il doit donc s’articuler
aux autres causes et arrêter de réclamer sa suprématie, comme le marxisme et le
souverainisme des années 1970 qui ont souvent considérer le féminisme comme un
mouvement secondaire qui viendrait seulement après la révolution sociale ou
l’indépendance, selon l’idéologie.
Pour terminer, il est intéressant d’amener
la critique de Rosa Luxemburg à l’endroit de la social-démocratie allemande de
son époque en faisant un parallèle avec la question nationale au Québec, le
souverainisme officiel versant toujours plus dans la bureaucratisation et
l’arrivisme. Ce phénomène n’est pas seulement le fait du Parti québécois (bien
qu’il en soit responsable en bonne partie), mais de la vision du monde qui
sous-tend une indépendance dirigée par des politiciens professionnels, les
urnes et l’art de gouverner. Il s’agit de dégager des pistes de recherche pour
élaborer une stratégie indépendantiste par le bas, menée sous la forme d’un
combat de libération populaire. « Les erreurs commises par un mouvement [de
libération] vraiment révolutionnaire sont historiquement infiniment plus
fécondes et plus précieuses que l’infaillibilité du meilleur comité central ».
[1]http://quebec.huffingtonpost.ca/sol-zanetti/pourquoi-les-independantistes-ne-votent-ils-pas-tous-pour-le-meme-parti_b_4747747.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/sol-zanetti/pourquoi-les-independantistes-ne-votent-ils-pas-tous-pour-le-meme-parti_b_4791899.html