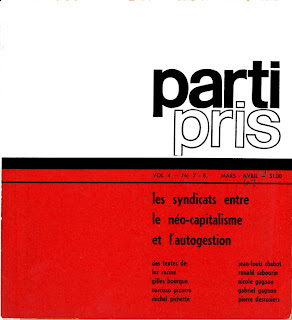Entre stratégie et
concept d’autodétermination
La querelle de la constituante
fait un bout chemin ! Bien que notre principal interlocuteur, Pierre
Mouterde, insiste d’abord sur la question stratégique et le contexte réel dans
lequel serait situé un gouvernement solidaire, celui-ci semble enfin admettre
que le mandat de l’Assemblée constituante devra être « clarifié »,
tout en restant ouvert afin que l’indépendance ne soit pas un projet clef en
main, mais le fruit d’un « instrument démocratique puissant ».
« C’est ainsi que le gouvernement du Québec pourrait donner
à la constituante le mandat d’élaborer la constitution d’un Québec indépendant qui serait par la suite soumis à un
référendum de ratification, mais sans présumer du résultat final, puisque c’est
précisément à cette assemblée constituante (composée dans le projet de QS d’environ
500 députés constituants) qu’il revient d’écrire cette nouvelle constitution,
de devenir ainsi le lieu même ou s’exerce "en acte" la souveraineté
populaire, en somme où commencera à s’exercer cette nouvelle et véritable
souveraineté populaire à l’encontre du carcan existant de la constitution
canadienne. »
Le fond de la question est ici de
conjuguer démocratie participative et indépendance, souveraineté populaire et
lutte de libération nationale. Avant de s’attaquer à la conjoncture politique dans
laquelle serait éventuellement plongée l’Assemblée constituante, il faut tout
d’abord répondre sérieusement à l’argument des opposants de la clarification du
mandat : le fait de déterminer à l’avance la résolution de la question
nationale (en demandant de rédiger la constitution d’un Québec souverain)
dénaturerait le processus de démocratie participative, en confisquant la
souveraineté populaire au profit d’un projet imposé par le haut. Cette
objection non négligeable ouvre ainsi un débat herméneutique sur
l’interprétation du concept d’autodétermination.
Exercer la
souveraineté populaire
« Comme tous les peuples du
monde, celui du Québec a le droit de disposer de lui-même et de déterminer
librement son statut politique. En ce sens, il est souverain, peu importe la
manière dont il décide d’utiliser cette souveraineté. C’est ce que Québec
solidaire appelle la souveraineté populaire, le pouvoir du peuple de décider en
toute démocratie de son avenir et des règles qui régissent sa propre vie,
incluant les règles fondamentales, comme l’appartenance ou non à un pays, ou la
rédaction d’une constitution. »
http://www.quebecsolidaire.net/wp-content/uploads/2012/08/Programme-ENJEU_1-Democratie.pdf
http://www.quebecsolidaire.net/wp-content/uploads/2012/08/Programme-ENJEU_1-Democratie.pdf
Les adeptes de l’ouverture insisteront sur le
fait que la souveraineté populaire serait niée par l’imposition de la rédaction
d’une constitution du Québec souverain, parce que l’Assemblée nationale
déciderait alors, en amont, de son statut politique, c’est-à-dire de
l’appartenance à un pays. Or, comme c’est l’Assemblée constituante qui doit
décider des valeurs et des institutions de la constitution ainsi que de
l’inclusion ou non d’une déclaration d’indépendance, et ce « sans
ingérence de l’extérieur », aucun mandat précis ne peut lui être imposé
sans menacer de facto son autonomie.
Cette interprétation, évidente en apparence, est
néanmoins fallacieuse parce qu’elle identifie
la souveraineté populaire et l’Assemblée constituante. Or, c’est bien le peuple
québécois dans son ensemble, et non les quelques membres élus sur l’Assemblée
constituante, qui est l’ultime titulaire de la souveraineté populaire !
Autrement dit, l’Assemblée constituante n’est qu’un « instrument démocratique
puissant » qui permettra au peuple québécois d’exercer sa souveraineté
populaire, ce dernier demeurant le seul véritable détenteur de ce pouvoir. La
question est donc de savoir s’il est possible qu’une Assemblée constituante au
mandat « ouvert » confisque le droit d’autodétermination au peuple
québécois. La réponse est malheureusement « oui ».
Les
périples de la constituante
Essayons d’imaginer le contexte réel dans lequel
serait situé le processus d’accession à l’indépendance. « Impossible en effet
d’imaginer l’arrivée de QS au gouvernement (avec par exemple 33 ou 35% des
votes et une étroite majorité de députés) sans déjà préalablement de premières
polarisations politiques, et donc d’importantes mobilisations sociales et
populaires existant en arrière-plan, en somme sans une ébullition sociale et
une fièvre collective de changements marquée. Ébullition sociale et fièvre de
changements néanmoins encore insuffisantes pour obtenir une véritable majorité
permettant d’aller de l’avant en termes d’indépendance : obtenir au moins
et si possible beaucoup plus que 50% des suffrages. »
Devant l’élection des membres de l’Assemblée
constituante au suffrage universel, il est raisonnable de croire qu’une foule
de groupes de pression, souverainistes comme fédéralistes, se mobiliseront pour
faire partie du processus constitutionnel. Si plus de la moitié de la
population n’est pas encore convaincue de la nécessité de l’indépendance au
moment de cette élection, alors il y a de bonnes chances qu’une majorité de ses
représentant(e)s défendent les idées fédéralistes et refusent tout simplement
de présenter une constitution souverainiste à la fin du processus. Il ne s’agit
pas de faire confiance ou non à la « démocratie participative », mais
de remarquer que cela consiste à faire reposer le droit d’autodétermination du peuple québécois sur une
élection de 30 jours, tout comme Option nationale.
C’est précisément ce piège que Québec solidaire peut
éviter en clarifiant le mandat de l’Assemblée constituante. Le but n’est pas de
déterminer à l’avance les valeurs et les institutions qui seront inscrites dans
le projet de constitution, mais de garantir que le peuple québécois pourra
s’exprimer sur la question nationale, par démocratie directe, lors du
référendum qui entérinera cette constitution. Autrement dit, il s’agit de
s’assurer que l’Assemblée constituante ne confisquera pas le droit
d’autodétermination du peuple québécois, et qu’elle demeurera un
« instrument démocratique puissant » qui ne sera pas susceptible
d’être saboté par des intérêts puissants dans le cas d’un mandat « ouvert ».
Cet argument du sabotage ne présente pas qu’un
simple risque qu’il faudrait accepter par respect démocratique ; il
éclaire plutôt un véritable problème stratégique dans la formulation actuelle
de l’Assemblée constituante. Mais il ne s’agit pas non plus d’un détail
empirique relevant de la spéculation politique, car l’interprétation
« ouverte » ne respecte même pas le principe de souveraineté
populaire sur lequel elle repose ! Ceux et celles qui ne veulent pas
exiger la rédaction d’une constitution d’un Québec indépendant commettent donc
une erreur conceptuelle, basée sur une mauvaise compréhension du principe
d’autodétermination.
La
rupture démocratique
Selon la « Déclaration
relative aux principes du droit international touchant les relations amicales
et la coopération entre les États conformément à la Charte des
Nations-Unies », le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes peut
seulement s’exercer selon les modalités suivantes : 1) la création d’un État
souverain et indépendant ; 2) la libre association ou l’intégration avec un
État indépendant ; 3) l’acquisition de tout autre statut politique
librement décidé par un peuple.
Même
si les adeptes du mandat « ouvert » veulent laisser l’Assemblée
constituante décider entre ces trois options, il faut d’abord reconnaître que la
souveraineté de l’État québécois est un prérequis à toute autre mesure. En
effet, pour s’associer librement ou s’intégrer à un État indépendant comme le
Canada, il faut déjà être indépendant ! Ensuite, si le Québec désire
acquérir un autre statut politique librement décidé par le peuple, il faut
d’abord qu’il s’émancipe de la tutelle de l’État canadien.
C’est ici qu’intervient l’Assemblée constituante, qui a pour rôle
de rédiger une constitution, c’est-à-dire le texte fondamental d’organisation
des pouvoirs publics d’un pays. Il
est vrai qu’il est possible d’avoir une constitution sans souveraineté, comme
la constitution de la Colombie-Britannique qui reste subordonnée à la
constitution canadienne. Malheureusement, nous sommes loin de l’option 3, qui
suppose le droit de choisir et de développer librement son système politique,
social, économique et culturel. Aucune des trois modalités du principe
d’autodétermination ne peut donc être respectée dans le simple « cadre
provincial », et c’est pourquoi l’Assemblée constituante suppose une
rupture démocratique qui enclenche le processus de le libération nationale, la
souveraineté populaire s’exerçant en suspendant le « cadre
canadien ».
 « L’élection d’une Assemblée constituante
est donc un acte démocratique par excellence, un acte à la fois de rupture avec
le statu quo du régime fédéral canadien et un acte réellement fondateur. En ce
sens, c’est une suspension des mécanismes de la réforme constitutionnelle
prévue par l’Acte de l’Amérique du Nord britannique »
« L’élection d’une Assemblée constituante
est donc un acte démocratique par excellence, un acte à la fois de rupture avec
le statu quo du régime fédéral canadien et un acte réellement fondateur. En ce
sens, c’est une suspension des mécanismes de la réforme constitutionnelle
prévue par l’Acte de l’Amérique du Nord britannique »
Le
projet de pays
Contre toute attente,
l’élément le plus subversif du programme de Québec solidaire ne réside pas dans
son projet social ou ses engagements de gauche, mais dans son projet de pays
incarné par l’Assemblée constituante ! Celle-ci est la seule qui soit à
même de déclencher une révolution
politique, c’est-à-dire un renversement institutionnel et légal des
rapports de domination avec l’État canadien, capable d’instaurer un nouvel
ordre politique librement décidé par le peuple québécois. Le plus grand
avantage de l’Assemblée constituante par rapport aux deux autres référendums
(manqués ou volés), réside dans le fait que la population ne votera pas les
yeux fermés pour une souveraineté sans contenu, mais pour un projet de pays
qu’elle aura elle-même élaboré.
 Tel est le sens de la
précision du mandat de l’Assemblée constituante qui devra rédiger la constitution
d’un Québec indépendant ; cela ne limite pas la souveraineté populaire,
mais la rend possible. Cette interprétation donne une tout autre signification
à ce passage du programme : « Tout au long
de la démarche d’Assemblée constituante, Québec solidaire défendra son option
sur la question nationale québécoise et fera la promotion de ses valeurs
écologistes, égalitaires, féministes, démocratiques, pluralistes et pacifistes,
sans toutefois présumer de l’issue des débats. » Cette option sur la
question nationale ne renvoie pas à la simple souveraineté du Québec (la
constituante ayant le loisir de rédiger la constitution d’une province), mais à
un projet de pays particulier qui implique des valeurs républicaines,
écologistes, égalitaires, féministes, démocratiques, pluralistes et pacifistes.
Tel est le sens de la
précision du mandat de l’Assemblée constituante qui devra rédiger la constitution
d’un Québec indépendant ; cela ne limite pas la souveraineté populaire,
mais la rend possible. Cette interprétation donne une tout autre signification
à ce passage du programme : « Tout au long
de la démarche d’Assemblée constituante, Québec solidaire défendra son option
sur la question nationale québécoise et fera la promotion de ses valeurs
écologistes, égalitaires, féministes, démocratiques, pluralistes et pacifistes,
sans toutefois présumer de l’issue des débats. » Cette option sur la
question nationale ne renvoie pas à la simple souveraineté du Québec (la
constituante ayant le loisir de rédiger la constitution d’une province), mais à
un projet de pays particulier qui implique des valeurs républicaines,
écologistes, égalitaires, féministes, démocratiques, pluralistes et pacifistes.
Un
gouvernement solidaire devra alors faire la promotion de la « République
du Québec », tout en préservant l’indépendance de l’Assemblée constituante
en ce qui a trait à l’élaboration de la forme définitive de la constitution. Le
pays du Québec est déjà présupposé dans le processus constituant, et c’est
pourquoi il s’agit de clarifier la formulation de l’Assemblée constituante, et
non de la dénaturer. L’interprétation qui voudrait laisser la question de la
souveraineté « ouverte » est ainsi déjà implicitement exclue par les
principes de souveraineté populaire et d’autodétermination sur lesquels repose
l’Assemblée constituante. L’interprétation ouverte n’est pas donc pas plus
démocratique ou inclusive que la version clarifiée, car elle laisse planer une
ambiguïté sur la possibilité d’une constitution provinciale qui fermerait
l’éventail des possibles.
La révolution québécoise
Québec
solidaire est-il pour autant le parti de la « révolution
québécoise » ? Si on regarde sa stratégie d’accession à
l’indépendance, alors on constate qu’il met de l’avant la démarche la plus
radicale au sens de Mouterde, « c’est-à-dire la seule qui prend les choses à la racine en
cherchant à mettre en place les conditions concrètes qui permettraient de
déboucher effectivement sur l’indépendance du Québec ». De plus, cette
démarche ne se limite pas à une simple élection d’élites chargées de faire la
souveraineté, ni à une brève consultation publique déformée par les médias de
masse accouchant sur un vote en faveur d’un « oui » ou un « non »
indéterminé. Il s’agit au contraire de l’enclenchement d’un véritable processus
de libération nationale.
« D’où
l’intérêt du processus constituant qui en prenant le temps de faire participer
démocratiquement la collectivité du Québec à l’élaboration de la constitution
du pays qu’elle désire bâtir, permet non seulement de réfléchir au pays que
nous voulons (en mettant à l’ordre du jour la question de l’indépendance), mais
encore de le définir, constitutionnellement parlant, ici et maintenant, et
ainsi d’en faire apercevoir pour de larges secteurs de la population, tous les
côtés avantageux (en termes de droits collectifs, de droits des femmes, des
travailleurs, de principes écologiques, etc.), défaisant au passage la barrière
entre question sociale et question nationale ; barrière à laquelle
tiennent tant par ailleurs le PQ et Option nationale. D’où le côté rassembleur
et mobilisateur, mais aussi émancipateur d’un tel exercice ». http://www.pressegauche.org/spip.php?article13403
Cette révolution politique serait-elle suivie d’une révolution économique et sociale, comme l’entend le
projet de société de Québec solidaire ? Nul ne peut répondre à cette
question, même si nous pouvons espérer que la rupture démocratique enclenchée
par la constituante ouvrira le champ des possibles et donnera peut-être le goût
au peuple québécois de son émancipation sociale. Le socialisme n’adviendra pas
sans indépendance, mais l’indépendance sera amorcée
par l’Assemblée constituante qui aura pour rôle d’élaborer collectivement un
projet de pays. C’est pourquoi la souveraineté populaire représente l’exercice
démocratique de l’indépendance en marche, qui mènera peut-être à la libération totale du peuple québécois. Détournons l’expression de Khadir pour lui donner plus de mordant :
« L’indépendance nécessairement, la révolution sociale si
nécessaire ! »