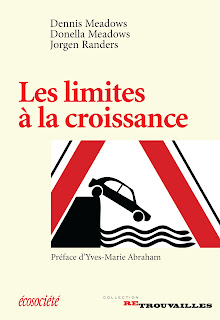Préambule
 Ce texte, beaucoup trop long pour
un billet de blog, forme l’ébauche de ce qui pourrait devenir un projet de
livre sur la crise sociale du Québec. En prenant pour fil conducteur l’évolution
de l’État-providence et la trajectoire vacillante du Parti québécois au sein
des transformations du capitalisme avancé, cette analyse politique cherche à
mettre en garde contre l’important virage à droite des principaux partis
québécois. Mais l’interprétation de ce tournant idéologique ne doit pas être limitée
à une critique superficielle du « néolibéralisme », dont
l’alternative serait la restauration du « modèle québécois » comme
régime consensuel de centre-gauche. Ce fameux modèle est en panne depuis les
trente dernières années, et n’existe qu’à l’état de mort-vivant aujourd’hui. La
quasi-totalité des partis politiques, à l’exception de Québec solidaire,
endossent les présupposés du néolibéralisme de manière plus ou moins implicite,
et n’offrent pas de solution réelle à la crise économique, politique,
culturelle et écologique qui continuera d’affliger notre société.
Ce texte, beaucoup trop long pour
un billet de blog, forme l’ébauche de ce qui pourrait devenir un projet de
livre sur la crise sociale du Québec. En prenant pour fil conducteur l’évolution
de l’État-providence et la trajectoire vacillante du Parti québécois au sein
des transformations du capitalisme avancé, cette analyse politique cherche à
mettre en garde contre l’important virage à droite des principaux partis
québécois. Mais l’interprétation de ce tournant idéologique ne doit pas être limitée
à une critique superficielle du « néolibéralisme », dont
l’alternative serait la restauration du « modèle québécois » comme
régime consensuel de centre-gauche. Ce fameux modèle est en panne depuis les
trente dernières années, et n’existe qu’à l’état de mort-vivant aujourd’hui. La
quasi-totalité des partis politiques, à l’exception de Québec solidaire,
endossent les présupposés du néolibéralisme de manière plus ou moins implicite,
et n’offrent pas de solution réelle à la crise économique, politique,
culturelle et écologique qui continuera d’affliger notre société.
Le récent virage à droite du
Parti québécois ne relève donc pas du libéralisme économique (qu’il soutient
depuis l’échec du premier référendum), mais du conservatisme socioculturel. Voilà
l’angle mort de la critique habituelle des mouvements progressistes et
souverainistes, qui considèrent à tort que le problème essentiel du principal
parti de la Révolution tranquille serait d’insister trop sur le libre-échange
et de ne pas être assez faire la promotion de la souveraineté. Bien que ces
deux constats soient valides, ils sont en fait la manifestation d’une mutation
plus profonde du Parti québécois : l’abandon définitif du projet de
société lié à l’émergence de l’État-providence par la réaffirmation du
nationalisme conservateur comme réponse à la crise identitaire québécoise.
Sur le
plan de la scène politique, le Parti québécois et la Coalition avenir Québec,
bien que distincts actuellement en tant que partis, forment une unité objective
en devenir. Son foyer de convergence se manifeste par la formation d’un nouveau
bloc social qu’il s’agit maintenant d’analyser afin de mieux le contrer sur le
plan pratique. Si la première partie de cette enquête se veut d’abord une
critique du front nationaliste conservateur émergent, la deuxième partie
élaborera une stratégie politique ayant pour centre l’hégémonie de la gauche
sur la question nationale, afin de créer un nouveau front populaire capable de
renverser l’ordre économico-politique établi dans une perspective
d’émancipation sociale et nationale. Seule cette alternative permettrait de
relancer, par un acte de rupture, le processus amorcé par la Révolution
tranquille.
La prospective
Cet article représente une
tentative de prospective politique québécoise. Il ne s’agit pas de prévoir
l’avenir à la manière d’un prophète ou d’un futurologue, mais de concevoir des
scénarios d’évolution des configurations politiques en fonction d’une approche
globale et d’une analyse des tendances lourdes de l’histoire en cours. Le but
de cette démarche consiste à replacer l’analyse de conjoncture politique dans
le temps long en articulant 1) un bilan historique ; 2) l’explicitation de
forces émergentes ; 3) leur prolongation imaginative au cours des
prochaines années. Le cadre théorique utilisé dans cette prospective politique
ne s’appuie pas sur une approche mécanistique ou positiviste, mais sur une perspective
historico-compréhensive liée à l’analyse générale du capitalisme. Matérialisme
historique et critique discursive seront donc les principaux leviers permettant
de réunir des fragments d’observations dans un tout cohérent.
La prospective, pour être
efficace, doit être à la fois humble et audacieuse. Elle doit d’abord reconnaître
son caractère incertain, expérimental et inachevé ; elle constitue des
hypothèses de recherches devant être corroborées par des faits ou corrigées le
cas échéant, dans un processus d’auto-correction permanent. Ensuite, elle doit
laisser place à l’intuition et l’exagération. L’intuition relève moins du
sentiment subjectif approximatif que d’une certaine attention portée sur les
événements, d’une perspicacité permettant d’amener des pistes devant être
approfondies par la logique et la recherche empirique. Enfin, l’exagération
consiste à grossir certains traits de la réalité afin de déceler des tendances
encore imperceptibles. L’exagération représente ainsi une méthode possédant une
valeur épistémologique, à la manière du philosophe Günther Anders :
« Les exposés qui vont
suivre, du moins certains d’entre eux, donneront une impression
d’« exagération ». Et cela pour la simple raison que ce sont effectivement des exagérations. Je
donne naturellement à ce terme, puisque je le conserve malgré tout, un sens
différent de son sens habituel : un sens heuristique. Qu’est-ce que cela
signifie ? Qu’il y a des phénomènes qu’il est impossible d’aborder sans
les intensifier ni les grossir, des phénomènes qui, échappant à l’œil nu, nous
placent devant l’alternative suivante : « ou l’exagération, ou le
renoncement à la connaissance ». La microscopie et la télescopie en sont
les exemples les plus immédiats, qui cherchent à atteindre la vérité au moyen
d’une image amplifiée. » Günther Anders, L’obsolescence de l’homme. Sur l’âme à l’époque de la deuxième
révolution industrielle, L’encyclopédie des nuisances, Paris, 2002, p.29
Entre anticipation
et répétition de l’histoire
Cette démarche combinant la
critique historique, l’analyse matérialiste et l’exagération n’a pas une simple
fonction théorique, parce qu’elle vise à guider la pratique via l’élaboration
d’une stratégie. Si la stratégie doit se baser sur la compréhension du passé et
la prise en compte du contexte actuel, elle doit surtout anticiper les
transformations sociales à venir. L’hypothèse de départ de cette recherche
repose sur l’idée que nous traversons une époque de fragilisation du statu quo,
annonçant ainsi la fin d’une période hégémonique, le retour en force de la
coercition, de la bipolarisation, des ruptures révolutionnaires et
contre-révolutionnaires. Le processus de mondialisation néolibérale et la
croyance en un marché autorégulateur reproduisent une dynamique analogue à
celles des années de l’entre-deux-guerres, telle que décrite par Karl Polanyi
dans son livre magistral La Grande
transformation.
 Le retour en force du fascisme et
du socialisme, dans certains pays dont la Grèce représente le meilleur exemple,
constitue le symptôme d’une crise générale qui affectera plusieurs sociétés
dans les deux à dix prochaines années. Cela ne signifie pas que la gauche
radicale et l’extrême-droite se tirailleront les haillons du Québec dans un
avenir rapproché. Plus précisément, une nouvelle polarisation de l’espace
public et politique déclenchée par le dernier printemps érable n’est pas sur le
point de se résorber, bien au contraire. L’échec du modèle québécois, représenté
par la décomposition de l’État-providence, la crise de confiance démocratique
et l’irrésolution de la question nationale, constitue un cocktail explosif pour
les mouvements révolutionnaires et conservateurs. De plus, la logique
néo-impérialiste de l’État canadien, combinée à la fragilité de l’économie financière
et la crise écologique, ajoutent des éléments déclencheurs dont les
répercussions sont difficilement prévisibles.
Le retour en force du fascisme et
du socialisme, dans certains pays dont la Grèce représente le meilleur exemple,
constitue le symptôme d’une crise générale qui affectera plusieurs sociétés
dans les deux à dix prochaines années. Cela ne signifie pas que la gauche
radicale et l’extrême-droite se tirailleront les haillons du Québec dans un
avenir rapproché. Plus précisément, une nouvelle polarisation de l’espace
public et politique déclenchée par le dernier printemps érable n’est pas sur le
point de se résorber, bien au contraire. L’échec du modèle québécois, représenté
par la décomposition de l’État-providence, la crise de confiance démocratique
et l’irrésolution de la question nationale, constitue un cocktail explosif pour
les mouvements révolutionnaires et conservateurs. De plus, la logique
néo-impérialiste de l’État canadien, combinée à la fragilité de l’économie financière
et la crise écologique, ajoutent des éléments déclencheurs dont les
répercussions sont difficilement prévisibles.
Nous entrons dans une importante phase
de transition. Elle ne reproduira pas mécaniquement l’histoire passée, mais
risque tout de même d’engendrer certains phénomènes sociopolitiques sensibles
aux contextes de crise. « Si
l'histoire ne se répète pas, les comportements humains se reproduisent »,
comme le rappelle Michel Godet.
La métamorphose du
Parti québécois
Bien qu’il soit impossible de
refaire l’histoire du Parti québécois, nous pouvons constater l’écart important
qui sépare le projet de souveraineté-association initié par René Lévesque et la
gouvernance souverainiste pilotée par Pauline Marois en 2013. La différence
entre ces deux moments historiques n’est pas simplement quantitative, comme si
la cause souverainiste avait été diluée par le temps, ou par le manque de
volonté de ses dirigeants. Il s’agit avant toute d’une transformation
qualitative, car le contenu même de la souveraineté a été modifié par les nouvelles
influences économiques et idéologiques de la société civile depuis l’échec du
deuxième référendum. Pour comprendre cette métamorphose du Parti québécois,
nous ferons appel au bilan critique de Bernard Rioux qui analyse l’évolution de
cette formation politique comme un bloc historique réunissant diverses classes
sociales.
« Le PQ s’est construit
comme un bloc social regroupant des secteurs organisés des masses populaires
jusqu’aux classes tenant de l’appareil d’État, lesdites couches
technocratiques. Cette coalition s’est mise en place à la fin de l’onde longue
expansive du capitalisme 45-75 (les Trente glorieuses) où le modèle
d’accumulation fordiste était marqué par un élargissement du pouvoir de
consommation des masses et la mise en place d’un État-providence. Au Québec, ce
modèle de concertation sociale trouvait son aboutissement utopique dans la
souveraineté-association qui condensait tant l’espérance de la consolidation de
cet État-providence que celui de l’émancipation nationale. » http://www.lagauche.com/lagauche/spip.php?article3204
L’entrée dans les années 1980 fut
pénible pour le Parti québécois : échec du premier référendum, stagnation
économique et chômage de masse, répression du Front commun en 1982, beau risque
de René Lévesque, affirmationnisme de Pierre-Marc Johnson et putsch de Jacques
Parizeau, etc. Malgré tout, l’échec de l’accord du Lac-Meech en 1987 suscita un
regain de vitalité pour le projet souverainiste, qui engendra la création du
Bloc québécois et la quasi-victoire du Oui en 1995. Mais le traumatisme
collectif de ce deuxième échec se soldat par l’entrée en force de la logique
néolibérale de Lucien Bouchard, le mythe des « conditions
gagnantes », l’imposition du déficit zéro, les lois spéciales contre les
syndicats, et le long règne de Jean Charest qui dura de 2003 à 2012.
« Ce projet de la
souveraineté péquiste a été porté par un bloc interclassiste dominé par la
petite bourgeoisie québécoise cherchant à rallier une partie des classes
populaires. Aujourd’hui, le néolibéralisme domine le discours et la pratique de
la bourgeoisie comme de la petite bourgeoisie. Les classes populaires sont
attaquées dans leurs acquis et dans leurs droits. La bourgeoisie québécoise
dans son ensemble n’a jamais soutenu le programme souverainiste et elle
l’affirme de plus en plus ouvertement. Le projet Legault est l’affirmation
ouverte de cette orientation. Le projet néolibéral qui traverse le PQ rend son
alliance avec les classes ouvrières et populaires de moins en moins possibles. » http://www.lagauche.com/lagauche/spip.php?article3204
Deux nouvelles
formations politiques
L’échec historique du Parti
québécois est double. Sur le plan social, la publication du Manifeste pour un
Québec lucide rédigé par Lucien Bouchard, Joseph Facal, André Pratte et
compagnie fit déborder le vase de la gauche ; le retard économique, le
fardeau de la dette publique, le déclin démographique et la « menace asiatique »
devaient nous résigner au dégel des frais de scolarité, la hausse des tarifs
d’électricité pour rembourser la dette, la privatisation et la tarification des
services publics, etc. En réponse à cette offensive néolibérale, un nouveau
parti politique réunissant l’Union des forces progressistes du Québec et Option
citoyenne fut créé. Québec solidaire naquit en 2006, et continue sa montée
depuis.
Sur le plan national, la crise du
Parti québécois de 2011 fut déclenchée par la ligne de parti concernant la
question controversée du financement de l’amphithéâtre Labeaume/Pierre-Karl
Péladeau. Cette crise occasionna le départ de Pierre Curzi, Louise Beaudoin et
Lisette Lapointe pour des raisons de légitimité démocratique, puis le départ de
Jean-Martin Aussant qui saisit l’opportunité pour montrer son désaccord au
projet autonomiste de la gouvernance souverainiste de Pauline Marois. La
déconfiture du Bloc québécois aux élections fédérales de 2011 marque également
l’effondrement du bloc interclassiste sur lequel reposait la stratégie
souverainiste. Les classes moyennes et populaires se tournèrent spontanément
vers le Nouveau parti démocratique, non pas pour renouer avec le fédéralisme
canadien ni à cause du charisme du défunt Jack Layton, mais pour rompre avec
l’attentisme souverainiste aboutissant au statu quo. Enfin, la création
d’Option nationale en 2011 symbolise l’échec du Parti québécois en matière
d’indépendance.
Malgré la faible popularité du
Parti québécois jusqu’à la toute fin du règne de Jean Charest, ce parti réussit
tout de même à se hisser au pouvoir lors des dernières élections provinciales
en surfant sur la vague de mécontentement du précédent gouvernement. Le manque
de crédibilité de la Coalition avenir Québec et le vote stratégique auront
permis au Parti québécois de récupérer la vague de contestation et la volonté
de changement grâce à certaines promesses sociales et environnementales.
Évidemment, les personnes qui auront été encore bernées par le mirage
social-démocrate de ce parti réalisent maintenant que sa structure
organisationnelle ne diffère guère des autres partis de droite, qui n’hésitent
pas à collaborer avec les milieux d’affaires au détriment des réformes
sociales, économiques et politiques qui amélioreraient les conditions de vie du
peuple québécois.
Pour résumer, le virage à droite
du Parti québécois et sa stratégie de gouvernance souverainiste sont
responsables de la création de Québec solidaire et d’Option nationale. Ces deux
formations politiques ne sont pas que des « excroissances » du même
parti, qui attendraient passivement de revenir au bercail ou de créer une
alliance électorale avec lui. Elles constituent des réponses originales et dynamiques
qui tentent de combler l’espace politique délaissé par les élites économiques
et politiques québécoises, afin de donner un nouveau souffle au projet
d’émancipation sociale et nationale. Ces deux partis sont en phase avec les
récentes mobilisations de la jeunesse politisée, la gauche rejoignant surtout les
mouvements féministes, écologistes, étudiants et altermondialistes des quinze dernières
années, le courant indépendantiste allant chercher de nouvelles recrues chez
les militant-es peu expérimentés et les personnes déçues par le Parti
québécois.
La genèse du modèle
québécois
Il serait superficiel de limiter
notre analyse politique à la scène électorale québécoise, d’autant plus que les
séismes ressentis à sa surface sont généralement causés par le mouvement lent,
mais certain des plaques tectoniques de la structure économique,
institutionnelle et culturelle de la société. La principale structure sur
laquelle repose la configuration des forces politiques peut être résumée par
l’expression du « modèle québécois ». Ce modèle renvoie à la
modernisation politique du Québec initiée par la Révolution tranquille, de 1960
à 1966, par le biais de la création d’un État-providence et d’un modèle de
gestion néocorporatiste, qui allie la concertation entre l’État, le patronat et
les grands syndicats. Le Québec n’a jamais été une réelle
« social-démocratie » à la manière des pays scandinaves, bien que son
État-providence mélange des traits des régimes social-démocrate et corporatiste
selon la typologie de Gosta Esping-Anderson dans The Three Worlds of Welfare Capitalism (1990). http://www.erudit.org/revue/rs/1998/v39/n2-3/057210ar.pdf
 L’État-providence québécois n’est
pas apparu pas subitement, ex nihilo,
par l’élection du gouvernement libéral de Jean Lesage. Sa lente genèse résulte
plutôt des multiples pressions de l’industrialisation, l’urbanisation, et l’apparition
de nouvelles classes sociales comme les ouvriers urbains, la petite bourgeoisie
francophone issue des collèges classiques et des professions libérales. Plus
précisément, les premières manifestations de l’État-providence remontent
d’abord aux nombreuses réformes sociales du gouvernement progressiste d’Adélard
Godbout (1939-1944) : droit de vote des femmes, éducation obligatoire jusqu’à
quatorze ans, gratuité scolaire au primaire, code du travail (droit syndical),
nationalisation de l’électricité à Montréal par Hydro-Québec, etc.
L’État-providence québécois n’est
pas apparu pas subitement, ex nihilo,
par l’élection du gouvernement libéral de Jean Lesage. Sa lente genèse résulte
plutôt des multiples pressions de l’industrialisation, l’urbanisation, et l’apparition
de nouvelles classes sociales comme les ouvriers urbains, la petite bourgeoisie
francophone issue des collèges classiques et des professions libérales. Plus
précisément, les premières manifestations de l’État-providence remontent
d’abord aux nombreuses réformes sociales du gouvernement progressiste d’Adélard
Godbout (1939-1944) : droit de vote des femmes, éducation obligatoire jusqu’à
quatorze ans, gratuité scolaire au primaire, code du travail (droit syndical),
nationalisation de l’électricité à Montréal par Hydro-Québec, etc.
Cette métamorphose structurelle
fut stoppée par le régime de Duplessis, qui tenta de freiner l’entrée du Québec
dans la modernité urbaine. Mais l’exode rural, l’émergence des classes moyennes,
l’apparition de la télévision, la création d’un espace public au sens
harbermassien (ex : la revue Cité libre), la montée du syndicalisme et les
nombreuses transformations sociales, culturelles et artistiques dans les années
d’Après-guerre auront eu raison du patronage, du conservatisme et de la
collusion entre les élites politiques, économiques et religieuses du régime
Duplessis.
La Révolution tranquille peut
être décrite comme la poursuite de l’État-providence qui avait été amorcé durant
la Seconde Guerre mondiale et retardée par l’obstination d’une
« superstructure féodale », avant que celle-ci succombe aux pressions du
capitalisme et de ses classes sociales montantes. Il s’agit en quelque sorte
d’une révolution démocratique bourgeoise au sens de Marx, mais syncopée par la
contre-révolution duplessiste. La phase 1960-1966 correspond au processus de
modernisation politique proprement dit, avec la création de nouvelles
institutions publiques comme la Société générale de financement, la Régie des rentes
du Québec, la Caisse de dépôt et placement du Québec, puis l’achèvement de la
nationalisation de l’électricité dans l’ensemble de la province.
 L’établissement du réseau des
cégeps et des universités du Québec, la Régie de l’assurance maladie, la Charte
de la langue française, l’assurance automobile, la Commission de la santé et la
sécurité du travail, représentent toutes des réformes sociales qui n’ont fait
que prolonger l’élan initial de la Révolution tranquille. « À chaque
époque, en effet, la constitution légale est un simple produit de la
révolution. Si la révolution est l’acte de création politique de l’histoire de
classe, la législation n’est que l’expression, sur le plan politique, de
l’existence végétative et continue de la société. Le travail légal de réformes
ne possède aucune autre forme motrice propre, indépendante de la révolution ;
il ne s’accomplit dans chaque période historique que dans la direction que lui
a donné l’impulsion de la dernière révolution, et aussi longtemps que cette impulsion
continue à se faire sentir ou, pour parler concrètement, seulement dans le
cadre de la forme sociale créée par la dernière révolution. Nous sommes là au
cœur du problème. »
L’établissement du réseau des
cégeps et des universités du Québec, la Régie de l’assurance maladie, la Charte
de la langue française, l’assurance automobile, la Commission de la santé et la
sécurité du travail, représentent toutes des réformes sociales qui n’ont fait
que prolonger l’élan initial de la Révolution tranquille. « À chaque
époque, en effet, la constitution légale est un simple produit de la
révolution. Si la révolution est l’acte de création politique de l’histoire de
classe, la législation n’est que l’expression, sur le plan politique, de
l’existence végétative et continue de la société. Le travail légal de réformes
ne possède aucune autre forme motrice propre, indépendante de la révolution ;
il ne s’accomplit dans chaque période historique que dans la direction que lui
a donné l’impulsion de la dernière révolution, et aussi longtemps que cette impulsion
continue à se faire sentir ou, pour parler concrètement, seulement dans le
cadre de la forme sociale créée par la dernière révolution. Nous sommes là au
cœur du problème. »
La crise du modèle
de l’État-providence
L’arrêt du mouvement de la
Révolution tranquille est causé par la dislocation du projet social et de la lutte
d’émancipation nationale après le mur référendaire de 1980. La série de crises
de cette décennie, tant au niveau économique, social que politique, freina la
vague de réformes et la construction de l’État-providence pour laisser place aux
partenariats public-privé, au libre-échange et à la morosité morale, culturelle
et intellectuelle bien entrevue dans le film Le déclin de l’empire américain de Denys Arcand en 1986. Malgré le
sursaut souverainiste engendré par l’échec de l’accord du Lac-Meech, la
conjonction de la stagnation économique, l’État-providence en panne et le
nationalisme libre-échangiste du Parti québécois ne parvinrent pas à relancer
le projet de la Révolution tranquille.
 L’exemple le plus criant de la
crise du modèle québécois fut la création de l’Action démocratique du Québec en
1994. Le but explicite de cette formation politique était de « réformer »
le modèle québécois en réduisant la taille de l’État social et en donnant une
plus grande liberté de choix aux individus. L’ADQ était simultanément
nationaliste et autonomiste, c’est-à-dire qu’elle préconisait le rapatriement
de plusieurs pouvoirs à l’Assemblée nationale tout en misant sur la relance
économique basée sur le principe d’accumulation privée. Si Mario Dumont appuya
la campagne du Oui en 1995, le traumatisme du deuxième échec référendaire remit
la résolution de la question nationale aux calendes grecques, de manière
analogue au Parti québécois de Lucien Bouchard.
L’exemple le plus criant de la
crise du modèle québécois fut la création de l’Action démocratique du Québec en
1994. Le but explicite de cette formation politique était de « réformer »
le modèle québécois en réduisant la taille de l’État social et en donnant une
plus grande liberté de choix aux individus. L’ADQ était simultanément
nationaliste et autonomiste, c’est-à-dire qu’elle préconisait le rapatriement
de plusieurs pouvoirs à l’Assemblée nationale tout en misant sur la relance
économique basée sur le principe d’accumulation privée. Si Mario Dumont appuya
la campagne du Oui en 1995, le traumatisme du deuxième échec référendaire remit
la résolution de la question nationale aux calendes grecques, de manière
analogue au Parti québécois de Lucien Bouchard.
À partir de ce moment, le principal objectif
n’était plus de faire la souveraineté pour relancer et compléter le projet de
société amorcé par la Révolution tranquille, mais de démanteler
l’État-providence tenu pour responsable de la stagnation nationale. L’idée des
« conditions gagnantes » et la monomanie de « la croissance
économique d’abord, le référendum ensuite », doivent être comprises dans ce
cadre hégémonique. L’ADQ comme le PQ offraient pour ainsi dire le même projet
de société, c’est-à-dire la révolution culturelle du néolibéralisme par la mise
entre parenthèses de la souveraineté. Le populisme de droite n’est donc pas
antinationaliste ; il est précisément nationaliste parce qu’il répond à la
crise du modèle québécois par le rejet du « mythe » du progrès social
qui lui est associé. La crise de l’État-providence, sur lequel est fondé
l’ensemble la structure institutionnelle de la société québécoise, amène donc une
crise d’identité collective. Pour le nationalisme identitaire, celle-ci ne
pourra être résorbée que par le double mouvement de l’abandon de la justice
sociale et de la réaffirmation de l’identité nationale. Ainsi doit se
comprendre l’émergence d’une vague nationaliste conservatrice, basée sur
l’obsession de l’identité, l’accumulation et la relégation de la
redistribution.
(Partie 1 de 4)