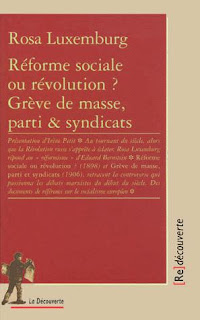Le Plan vert constitue la pierre angulaire du projet de société de
Québec solidaire. Une lecture attentive de ce projet permet de cerner les
forces et les limites de la vision actuelle du parti. Celle-ci n’est pas achevée,
mais en construction perpétuelle, d’où l’expression de parti-processus. Le signe de cette ouverture réside dans la
pluralité d’interprétations possibles du Plan vert, notamment celles élaborées
par Alexandre Leduc et Andrés Fontecilla sur leur blogue respectif. Cet article
cherchera à montrer en quoi différentes visions se distinguent et se
rejoignent, tout en montrant que le projet actuel de Québec solidaire n’offre
pas une réponse satisfaisante à l’ampleur de la crise écologique. Après avoir
fait une analyse critique du Plan vert, trois visions seront dégagées afin
d’articuler les rapports entre capitalisme et écologie : la
social-démocratie verte, l’écosocialisme et la décroissance conviviale.
Le Plan vert constitue la pierre angulaire du projet de société de
Québec solidaire. Une lecture attentive de ce projet permet de cerner les
forces et les limites de la vision actuelle du parti. Celle-ci n’est pas achevée,
mais en construction perpétuelle, d’où l’expression de parti-processus. Le signe de cette ouverture réside dans la
pluralité d’interprétations possibles du Plan vert, notamment celles élaborées
par Alexandre Leduc et Andrés Fontecilla sur leur blogue respectif. Cet article
cherchera à montrer en quoi différentes visions se distinguent et se
rejoignent, tout en montrant que le projet actuel de Québec solidaire n’offre
pas une réponse satisfaisante à l’ampleur de la crise écologique. Après avoir
fait une analyse critique du Plan vert, trois visions seront dégagées afin
d’articuler les rapports entre capitalisme et écologie : la
social-démocratie verte, l’écosocialisme et la décroissance conviviale.
Une économie verte,
faible en carbone
Le Plan vert débute par le désir
de transformer l’économie du Québec.
En quoi consiste cette transformation ? S’agit-il d’une réorientation du
système actuel dans le sens du partage de la richesse et de la préservation
l’environnement, ou d’une transformation du mode de production, c’est-à-dire le
passage à une société postcapitaliste ? Modernisation ou
dépassement du capitalisme ? Si nous nous en tenons au discours de la
plateforme électorale, il semble que la première interprétation doit être
privilégiée. Le Plan vert se veut d’abord l’opposé du Plan Nord, parce qu’il
préconise la sortie de la dépendance au pétrole et le développement des
technologies vertes, la maximisation de la valeur des ressources naturelles
dans le respect de l’environnement, la multiplication des emplois verts,
durables et égalitaires (inclusion des femmes), ainsi que la démocratisation de
l’économie par le développement des entreprises collectives et coopératives.
 Chose certaine, le Plan vert est fondamentalement
opposé au capitalisme de libre marché, c’est-à-dire au néolibéralisme qui
préconise le démantèlement de l’État social, l’extractivisme, la croissance
infinie et la quête du profit maximal au-dessus de toute autre considération
sociale et environnementale. Pour reprendre les termes de Karl Polanyi, Québec
solidaire cherche à ré-encastrer
l’économie dans la société, afin que la première serve la deuxième, au lieu de
l’inverse. Mais le fait qu’un projet soit de gauche ne signifie pas pour autant
qu’il dépasse le cadre du capitalisme, du développement durable et de l’économie verte préconisée par le dernier
sommet de Rio+20. Il s’agit avant tout de proposer une alternative pragmatique
et progressiste au désastre du modèle néolibéral et du mode de vie
pétro-dépendant, afin de devenir un phare d’innovation éco-sociale au même
titre que les pays scandinaves. « Nous pouvons
ainsi devenir un modèle inspirant de par le monde, devenir ceux et celles qui
auront, par leur innovation et leur courage, développé un mode de vie à la fois
viable et enviable qui ne met pas en danger son environnement et qui conserve
des ressources pour les générations à venir. »
Chose certaine, le Plan vert est fondamentalement
opposé au capitalisme de libre marché, c’est-à-dire au néolibéralisme qui
préconise le démantèlement de l’État social, l’extractivisme, la croissance
infinie et la quête du profit maximal au-dessus de toute autre considération
sociale et environnementale. Pour reprendre les termes de Karl Polanyi, Québec
solidaire cherche à ré-encastrer
l’économie dans la société, afin que la première serve la deuxième, au lieu de
l’inverse. Mais le fait qu’un projet soit de gauche ne signifie pas pour autant
qu’il dépasse le cadre du capitalisme, du développement durable et de l’économie verte préconisée par le dernier
sommet de Rio+20. Il s’agit avant tout de proposer une alternative pragmatique
et progressiste au désastre du modèle néolibéral et du mode de vie
pétro-dépendant, afin de devenir un phare d’innovation éco-sociale au même
titre que les pays scandinaves. « Nous pouvons
ainsi devenir un modèle inspirant de par le monde, devenir ceux et celles qui
auront, par leur innovation et leur courage, développé un mode de vie à la fois
viable et enviable qui ne met pas en danger son environnement et qui conserve
des ressources pour les générations à venir. »
Transports
et énergie
 Québec solidaire
fonde son approche sur une analyse de classes : son plan de développement
économique ne vise pas d’abord la croissance, les investissements étrangers et
les grandes entreprises, mais la création d’emplois et le bien-être de la
population. Elle favorise le travail, et non le capital, bien que le secteur
privé puisse y trouver son compte. Le meilleur exemple du primat du travail est
l’insistance du Plan vert sur la création d’emplois comme justification
récurrente des réformes avancées : « le secteur des transports collectifs
crée trois fois plus d’emplois que le secteur automobile au Québec ». Le
vaste projet d’électrification des transports collectifs, qui comprend non
seulement des investissements massifs pour la modernisation des transports urbains,
mais également la construction d’un monorail haute vitesse entre Montréal et
Québec, cherche ainsi, à travers l’abandon de l’utilisation des énergies
fossiles d’ici 2030, à relancer une croissance économique juste et durable.
Québec solidaire
fonde son approche sur une analyse de classes : son plan de développement
économique ne vise pas d’abord la croissance, les investissements étrangers et
les grandes entreprises, mais la création d’emplois et le bien-être de la
population. Elle favorise le travail, et non le capital, bien que le secteur
privé puisse y trouver son compte. Le meilleur exemple du primat du travail est
l’insistance du Plan vert sur la création d’emplois comme justification
récurrente des réformes avancées : « le secteur des transports collectifs
crée trois fois plus d’emplois que le secteur automobile au Québec ». Le
vaste projet d’électrification des transports collectifs, qui comprend non
seulement des investissements massifs pour la modernisation des transports urbains,
mais également la construction d’un monorail haute vitesse entre Montréal et
Québec, cherche ainsi, à travers l’abandon de l’utilisation des énergies
fossiles d’ici 2030, à relancer une croissance économique juste et durable.
De son côté, le chantier
d’efficacité énergétique vise à aider les particuliers et les entreprises
locales en stimulant le secteur de la rénovation verte. Le Plan vert prévoit
également le développement massif des énergies renouvelables comme l’éolien, la
géothermie et la biomasse, afin de réduire les « émissions de gaz à effet
de serre (GES) d’au moins 40 % par rapport à 1990 d’ici 2020, et de 95 % d’ici
2050 ». Pour ce faire, Québec solidaire nationaliserait l’industrie
éolienne (Éole-Québec), puis chapeauterait la production, la distribution, ainsi
que la recherche et développement dans le domaine énergétique par la création
d’Énergie-Québec. Ceci n’est pas sans rappeler une sorte de Green New Deal, visant à relancer
l’économie après une période de crise, de stagnation ou d’austérité par le
biais d’investissements massifs de l’État. Il ne s’agit pas tant d’une sortie
du capitalisme qu’une refondation du système économique sur une base
néo-keynésienne, la réorganisation de l’État-providence par le biais de la
modernisation écologique.
Une telle solution
fut proposée notamment par Van Jones dans son livre The Green Collar Economy : How one solution can fix our two
biggest problems (2008), et reçut l’applaudissement de personnalités
célèbres comme Al Gore et Paul Hawken, auteur du livre Natural Capitalism : Creating the next industrial revolution
(1999). Cette stratégie vise à relancer le capitalisme sur une base durable et
équitable en créant des milliers d’emplois faiblement, moyennement ou hautement
qualifiés dans le domaine de l’efficacité énergétique (rénovation des
bâtiments) et des énergies alternatives (panneaux solaires). La nouvelle
économie ne serait plus seulement basée sur les cols bleus (travail manuel,
classe ouvrière) et les cols blancs (travail intellectuel, classe moyenne),
mais la classe émergente des cols verts.
D’après le Programme des Nations Unies pour l’environnement, les emplois verts
(green jobs) regroupent toute forme
de « travail dans le secteur de l’agriculture, manufacturier, recherche et
développement, et des services qui contribuent substantiellement à préserver ou
restaurer la qualité de l’environnement. Cela inclut spécifiquement, mais pas
exclusivement, des emplois qui aident à protéger les écosystèmes et la
biodiversité ; réduire la consommation d’énergie, d’eau et de matériaux à
travers des stratégies d’efficience ; dé-carboniser l’économie ; et
minimiser voire éliminer toute forme de déchets et de pollution. »
Contrôle des
ressources naturelles
 Au-delà du Green New Deal, Québec solidaire souhaite également rendre
l’industrie minière au service de la collectivité. Cela passe notamment par
l’augmentation substantielle des redevances minières, ainsi que la
nationalisation des ressources naturelles (participation majoritaire de l’État
ou nationalisation complète des secteurs stratégiques). Or, une telle mesure,
prise isolément, se limiterait à une sorte de Plan Nord solidaire, très
semblable au « Nord pour tous » du Parti québécois. Heureusement, le
Plan vert ne prévoit pas donner tout le pouvoir à l’État, mais défaire la
suprématie de la Loi sur les mines, octroyer le droit de veto aux communautés
locales concernant les projets de développement minier sur leur territoire,
ainsi que mettre en place des évaluations environnementales stratégiques en
amont de chaque processus. La décentralisation des décisions par la
consultation obligatoire des villes permettrait ainsi d’offrir au
contre-pouvoir à la domination de l’État, qui pactise souvent avec les
promoteurs industriels au détriment des citoyen-nes.
Au-delà du Green New Deal, Québec solidaire souhaite également rendre
l’industrie minière au service de la collectivité. Cela passe notamment par
l’augmentation substantielle des redevances minières, ainsi que la
nationalisation des ressources naturelles (participation majoritaire de l’État
ou nationalisation complète des secteurs stratégiques). Or, une telle mesure,
prise isolément, se limiterait à une sorte de Plan Nord solidaire, très
semblable au « Nord pour tous » du Parti québécois. Heureusement, le
Plan vert ne prévoit pas donner tout le pouvoir à l’État, mais défaire la
suprématie de la Loi sur les mines, octroyer le droit de veto aux communautés
locales concernant les projets de développement minier sur leur territoire,
ainsi que mettre en place des évaluations environnementales stratégiques en
amont de chaque processus. La décentralisation des décisions par la
consultation obligatoire des villes permettrait ainsi d’offrir au
contre-pouvoir à la domination de l’État, qui pactise souvent avec les
promoteurs industriels au détriment des citoyen-nes.
Par ailleurs, Québec solidaire
s’engage à interdire l’exploitation de l’uranium et de l’amiante, et à
instaurer un système de gestion démocratique des forêts (comités forestiers
locaux), permettant la planification collective et l’aménagement écosystémique
des forêts. Enfin, bien que le parti reconnaisse le droit à l’eau tel que
défini par les Nations Unies et souhaite éviter la marchandisation de l’eau, sa
proposition de réforme se limite à augmenter les redevances sur l’eau de
manière à fournir 1,48G$ à l’État. Autrement dit, le principe sous-jacent
suppose que l’eau ne devrait pas être une marchandise gratuite, et c’est pourquoi la réforme propose de taxer plutôt
qu’interdire son utilisation commerciale. La « gestion démocratique des
ressources naturelles » reste l’élément le moins transformateur du Plan
vert, mais représente une avancée remarquable par rapport aux propositions des
autres partis politiques dans ce domaine.
Coopératives,
services publics et sécurité sociale
La restructuration économique
préconisée par Québec solidaire représente la pierre de touche qui permet de
déborder le cadre de l’État-providence vert. La transition écologique ne vise
pas d’abord à renforcer le pouvoir de l’État et des entreprises privées au
détriment de la société civile, mais à offrir une occasion extraordinaire de
démocratisation et de relocalisation de l’économie. Ainsi, le fait de revoir le
mandat de la Caisse dépôt et de placement du Québec pour soutenir la création d’entreprises
collectives permettrait de limiter la financiarisation de l’économie tout en
créant davantage d’emplois ayant des finalités sociales et écologiques. La
généralisation du modèle coopératif assure le développement d’entreprises plus stables,
résilientes et démocratiques, que ce soit par la reprise coopérative des
grandes entreprises, ou la création d’incitatifs pour encourager l’économie
sociale, le logement social et abordable, les emplois dans le domaine du
logiciel libre, du tourisme, de la culture et des loisirs. Le modèle économique
sous-jacent au Plan vert est celui de l’économie
plurielle ou solidaire, qui permet de sortir du modèle de l’économie duale ou mixte
(public/privé) afin d’articuler quatre dimensions :
« a) Une économie sociale composée
d’entreprises à finalité sociale et à but non lucratif, mais aussi d’organismes
communautaires, collectifs ou coopératifs qui rendent d’innombrables services à
la population.
b) Une économie domestique essentielle qui
repose sur les services rendus dans la famille, par les aidantes et aidants
naturels (surtout des femmes), et plus généralement sur les services gratuits
ou bénévoles que nous voulons trouver le moyen de reconnaître socialement et de
comptabiliser à leur juste valeur.
c) Une économie publique, étatique et
paraétatique, dont l’importance et le rôle social, entre autres, dans la
dispensation équitable de services accessibles à toute la population, sur
l’ensemble du territoire, doivent être revalorisés.
d) Une économie
privée composée d’entreprises dont le but est de produire et de vendre des
produits et des services et qui acceptent de fonctionner dans le respect des
règles collectives (sociales, environnementales, etc.) que la société
québécoise se donne. »
Si nous dépassons le cadre strict
du Plan vert pour retourner à l’objectif ultime de Québec solidaire, soit la socialisation des activités économiques,
nous pouvons voir que le parti souhaite, à long terme, assurer la
réappropriation collective des moyens de production, c’est-à-dire instaurer le
socialisme. Or, il ne compte pas le faire par la voie révolutionnaire,
c’est-à-dire par le biais de la dictature du prolétariat, l’abolition de la
propriété privée et l’étatisation complète de l’économie, mais par une voie
réformiste. Le développement d’une économie publique forte (c) allant de pair
avec la promotion active de l’économie sociale et domestique (a,b), fournirait
un contrepoids important à l’économie de marché (d) qui serait davantage
régulée, en favorisant davantage les PME que les grandes entreprises.
Le développement de
Pharma-Québec, le renforcement de l’éducation publique, des CLSC et des CPE, de
même que le respect des principes d’accessibilité universelle et de gratuité,
sont tous des manifestations de cette volonté de freiner la privatisation et la
tarification des services publics. À long terme, Québec solidaire vise même à
remplacer l’économie de marché par une planification démocratique et une
gestion décentralisée de l’économie. « Aussi,
l’administration générale et la fixation d’objectifs particuliers de ces
entreprises devront avoir lieu au sein d’instances démocratiques régionales ou
nationales dont la composition assurera une représentation réelle de l’ensemble
de la société (salarié-es de l’entreprise, représentant-es de l’État, élu-es
régionaux, groupes de citoyen-nes, Premières Nations, etc.). Finalement, ce
n’est pas le gouvernement ou ses hauts fonctionnaires qui devront voir à
l’organisation du travail au sein de ces entreprises, mais les employé-es
eux-mêmes (autogestion). »
Évidemment, cet élément du
programme ne figure pas dans le Plan vert, ce dernier présentant une première étape dans un processus de
transformation globale de l’économie. Il en va de même pour le revenu minimum
garanti, qui figure timidement vers la fin de la section sur la sécurité
sociale. « Cette forme de sécurité du revenu
viendra progressivement remplacer l’aide sociale et d’autres programmes sociaux
pour permettre à toute personne adulte vivant au Québec de se voir garantir un
revenu minimum de 12 000 dollars par année. La déficience des présentes
politiques sociales impose le développement d’une politique sociale et
économique ambitieuse. Le niveau actuel de l’aide sociale est nettement insuffisant,
ce qui a pour conséquence d’enfermer les gens dans une spirale appauvrissante.
Celle-ci a un impact majeur sur la santé publique : la pauvreté entraîne la
maladie. »
Le fait de présenter
le revenu minimum garanti dans le cadre d’une lutte contre la pauvreté et les
inégalités masque le caractère radical d’une telle réforme, en lui donnant une
allure d’assistance sociale généralisée. Or, le revenu garanti assure la
dignité, l’épanouissement personnel et la liberté
réelle de l’individu, tout en permettant de donner un formidable coup
d’accélérateur à la dé-marchandisation de la vie sociale. En effet, il libère
le temps de la domination du travail, il contourne le joug du salariat en
donnant l’occasion de multiplier les initiatives individuelles et collectives,
les activités autonomes, culturelles et non-marchandes. L’interprétation du
revenu minimum garanti présentée dans le Plan vert semble renvoyer au
renforcement de l’État-providence, alors qu’il permet également l’émancipation
de l’individu de la tutelle de l’État et du marché par le déploiement d’activités
d’autoproduction.
La
social-démocratie verte
Pour résumer, le cadre général du Plan vert de
Québec solidaire renvoie à l’instauration d’une social-démocratie verte pour
répondre à la crise néolibérale et environnementale. Cela peut être résumé par
les points structurants du projet : 166 000 nouveaux emplois, moins de
voitures et plus de technologies vertes, plus de démocratie en entreprise et
inclusion des femmes, plus d’emplois stables, mieux payés et implantés dans nos
communautés, gestion démocratique des ressources naturelles, secteur public
fort et sécurité sociale. La réconciliation de l’économie et de l’écologie, le
passage de la gauche d’opposition à la gauche de proposition, puis la
rhétorique de la création d’emplois verts représentent l’interprétation valide,
mais minimale, du Plan vert.
« Ce Plan vert nous permet de sortir de la
fatalité des crises économiques et du marasme ambiant. Il replace l’économie du
Québec sur les rails et la propulse
vers une nouvelle voie. Il ne s’agit plus de la croissance pour la croissance,
mais bien de se servir de l’économie pour bâtir le Québec qu’on veut : un
Québec vert, solidaire et démocratique. Les idées sont là, et elles sont
portées par tout un tissu d’associations et de groupes citoyens. Pour qu’elles deviennent
réalité, il ne manque qu’un ingrédient essentiel : le courage politique pour
les mettre en place. »
Il s’agit d’une vision réformiste et
volontariste, qui opère le passage de la croissance en soi (capitalisme de libre marché) à la croissance en soi et pour soi (capitalisme vert
d’État), c’est-à-dire une nouvelle économie au service du peuple sans remise en
question des notions de travail abstrait (emploi), de marchandise, de progrès
technologique, d’industrialisation, de vitesse, etc. Cette conception opère
ainsi la synthèse du développement durable et du modèle keynésien, en
présentant la croissance verte et équitable comme l’alternative à l’austérité non-durable
et néolibérale. Dans cette perspective, il n’y a pas de dépassement du
capitalisme, mais une refondation de ce système à travers la « troisième
révolution industrielle » d’une économie postcarbone.
Or, cette stratégie est-elle à la hauteur des défis que nous présente la crise écologique ? Réponse à suivre…
Or, cette stratégie est-elle à la hauteur des défis que nous présente la crise écologique ? Réponse à suivre…